
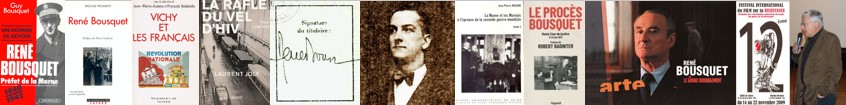 |
| René Bousquet > Le ralliement des notables marnais | |
| |
|
|
Le ralliement des notables marnais Les
parlementaires et les élus locaux ________________________________________________________________________________________________________________________ |
|
|
Les parlementaires et les élus locaux Les six parlementaires marnais qui avaient voté en juillet 1940 les pleins pouvoirs au maréchal PÉTAIN ont accepté de participer ainsi que la plupart des élus locaux à la reconstruction administrative du département aux côtés du préfet BOUSQUET. Cela a été d'autant plus facile que la Marne ne comptait aucun parlementaire, aucun conseiller général, aucun conseiller d'arrondissement ni aucun maire communiste, et que l'unique adjoint au maire et les treize conseillers municipaux communistes marnais élus avant-guerre avaient été déchus de leur mandat dès le début de l'année 1940. Il est vrai aussi qu'une fois mis à l'écart les communistes, contre lesquels s'est déchaîné l'esprit de revanche anti-Front populaire, sont devenus les boucs émissaires rendus responsables de la défaite. La réconciliation entre la gauche non communiste et la droite d'une part, entre radicaux et socialistes au sein de la gauche non communiste d'autre part, a été facilitée par le fait que les radicaux rémois avaient refusé d'adhérer au Front populaire, préférant dès avant-guerre nouer des alliances avec la droite. [Le 10 juillet 1940, 6 parlementaires marnais sur les 8 qui représentaient alors le département, ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain : L'anticommunisme est devenu le ciment d'une réconciliation nationale habilement négociée à l'ombre du régime de Vichy par BOUSQUET, qui a réussi à convaincre les notables marnais avec l'appui de son ami MARCHANDEAU et des radicaux, qu'il était en ces temps difficiles le meilleur garant de la sauvegarde des principes républicains et des intérêts des Marnais. [Paul Marchandeau est né le 10 août 1882 à Gaillac dans le Tarn. Docteur en droit venu s’installer à Reims après la Première Guerre mondiale, il était l'avocat du Syndicat général des vignerons, puis le bâtonnier de l'ordre des avocats. Franc-maçon initié par la Loge Orion de Gaillac en 1904, il était membre de la Loge La Sincérité de Reims et de l'Association franc-maçonne des journalistes. Rédacteur en chef du quotidien radical L’Éclaireur de l’Est, il en était devenu le directeur. Paul Marchandeau a été un personnage clé de la vie politique rémoise et marnaise jusqu’en 1942. Il a été élu successivement conseiller municipal en 1919, puis en 1925 maire de Reims à la tête d’une liste d’élus radicaux et socialistes sur laquelle figurait Marcel Déat, et conseiller général de la Marne. Il a conservé ses deux fonctions jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. En 1926, il a été élu député de la Marne à l'occasion d'élections partielles, en même temps que le socialiste Marcel Déat, sur une liste du Cartel des gauches. Tenant d’un néo-radicalisme révisionniste et participationniste, il a amorcé dès le début des années 1930 une dérive droitière qui l'a conduit à rechercher l’alliance de la droite républicaine et à accepter des postes de sous-secrétaire d’État et de ministre dans des gouvernements anti-cartellistes. Président de l'Association des maires de France et président de la Fédération de la Marne du parti radical, il s’est opposé vigoureusement à la montée du Front populaire. Lors des élections municipales de mai 1935, considérant qu’il n’avait pas d’ennemis à droite, il a conduit une liste d'« Union républicaine pour la défense des intérêts rémois », composée de radicaux, de républicains socialistes, de néo-socialistes, de membres de l'Alliance républicaine et de trois militants des ligues d'extrême droite, liste qui a été entièrement élue et il a été reconduit à la tête de la mairie de Reims à l'unanimité. Aux élections législatives de 1936, il a été réélu au second tour dans la deuxième circonscription de Reims face au candidat du Front populaire, le socialiste Claude Burgod, grâce à ses alliés de droite au sein du conseil municipal de Reims qui ont accepté de ne pas présenter de candidat contre lui. Aux élections cantonales de 1937, il a été réélu grâce au soutien de la droite, conseiller général de la Marne au second tour contre le candidat socialiste, et il a été porté à la présidence du Conseil général de la Marne, fonction qu'il a conservée jusqu'à la dissolution de ce Conseil par Vichy en 1940. En 1938, ministre des Finances dans le Cabinet Daladier, il a approuvé la déclaration gouvernementale qui entérinait les accords de Munich. Devenu ministre de la Justice, il a signé le décret-loi du 21 avril 1939 prohibant toute incitation à la haine raciale, et a donné sa démission le 1er septembre 1939, le jour même où le Conseil des ministres a décrété la mobilisation générale. Après avoir organisé l'évacuation de la ville de Reims, il a fermé sa mairie le 20 mai 1940, et s'est replié dans sa ville natale, Gaillac. Rentré dans la Marne en compagnie de René Bousquet le 30 juin, il a été chassé de sa mairie par les Allemands le 2 juillet 1940. L'intérim a été confié à un adjoint, Georges Hodin. Le 3 juillet 1940, il a déjeuné à Châteldon, à la table de Pierre Laval aux côtés du maréchal Pétain, président du Conseil, et d'Alibert, sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Le 8 juillet 1940, il est revenu à Reims pour négocier la reparution, sous contrôle allemand, de L'Éclaireur de l'Est dont il a confié la rédaction en chef à Lucien Vermersch-Robin. Le 10 juillet 1940, il a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain à Vichy. En octobre 1940, Paul Marchandeau a repris possession de sa mairie de Reims grâce à l'intervention de son ami Bousquet, mais le préfet de la Marne n'a cependant pas pu empêcher une perquisition de la police allemande à son domicile au 54, rue des Capucins à Reims, suite à une dénonciation. Des documents et objets maçonniques ont été saisis dont une plaquette en métal portant son nom, qui a été exhibée dans l’exposition antimaçonnique au Petit Palais à Paris au cours de l’automne 1940 et présentée dans la catalogue de l’exposition. Nommé par René Bousquet rapporteur de la Commission administrative de la Marne, il a été confirmé par Vichy en mars 1941 à la tête d'un conseil municipal remanié, sur proposition de son ami le préfet Bousquet. En avril 1942, lorsque Bousquet a été appelé au poste de secrétaire général de la Police à Vichy, Paul Marchandeau a présenté sa démission de maire, de conseiller municipal de Reims, et de membre de la Commission administrative de la Marne, mais il a conservé la présidence de l’Association des maires de France. Pressé par Bousquet, le chef du gouvernement, Pierre Laval, a demandé en vain à Paul Marchandeau de reprendre sa démission. Ce n’est que le 16 septembre 1942 et à la demande de l’Amiral Platon, secrétaire d’État chargé de la Police antimaçonnique, que l’appartenance à la franc-maçonnerie de Paul Marchandeau a été dénoncée au Journal Officiel. Poursuivi à la Libération comme PDG de L'Éclaireur de l'Est, journal suspendu le 30 août 1944, Marchandeau a échappé à la Cour de Justice de la Marne et a bénéficié, le 22 octobre 1947, d'un arrêt de classement aboutissant à un non lieu rendu par la Cour de Justice de la Seine. Quant à Lucien Vermesch-Robin a été condamné à 20 ans de réclusion et à la confiscation totale de ses biens par la Cour de Justice de la Marne. Paul Marchandeau s'est retiré de la vie politique, mais a négocié en 1953 avec Pierre Bouchez, ancien chef départemental des FFI, un compromis avec les dirigeants de L'Union – journal issu de la Résistance installé dans les locaux de L'Éclaireur de l'Est – qui ont accepté de lui verser 20 millions de francs. Paul Marchandeau est décédé en 1968 à Paris où il a été incinéré au cimetière du Père Lachaise. Ses cendres ont été ramenées ultérieurement à Reims au Cimetière du Sud dans une sépulture monumentale portant un médaillon de bronze à son effigie réalisé par Léon Margotin en 1930. À Reims, où une avenue porte son nom, un portrait non daté de Paul Marchandeau peint par Rousseau-Decelle, est exposé dans la galerie des anciens maires de Reims au premier étage de l’Hôtel de Ville.] En 1945, Richard POUZET, qui avait exercé la fonction de secrétaire général aux côtés du préfet BOUSQUET, a confirmé dans sa déposition adressée au juge d'instruction de la Haute Cour de Justice cette stratégie de continuité républicaine, prenant appui sur le maintien des élus d'avant-guerre : « La
Marne était restée républicaine et de tendance
radicale-socialiste. [Secrétaire général de la Marne, Richard Pouzet était en contact avec la résistance marnaise, et couvrait la fabrication à la préfecture de faux papiers d'identité destinés aux prisonniers évadés et aux réfractaires du STO, qu'il aidait à échapper aux réquisitions de main d'œuvre. Il a encouragé le préfet Bousquet, dont il était un des principaux collaborateurs à la préfecture, à protéger les élus républicains, les francs-maçons et les juifs. Mis en disponibilité par le gouvernement de Vichy en février 1944, il a été pressenti pour exercer les fonctions de préfet de la Libération dans la Marne. Arrêté le 4 août 1944 par la Gestapo pour son activité de résistant, il a fait partie d’un transport qui est parti de Pantin le 15 août 1944 et qui est resté bloqué dans un tunnel bombardé par l’aviation alliée. Les déportés ont été transférés dans un autre train que la résistance a essayé en vain de stopper le 17 août 1944 près de Dormans. Richard Pouzet a décrit dans le détail et avec émotion la traversée du département de la Marne. Arrivé le 20 août à Buchenwald, où il a reçut le matricule 77 061, il a ensuite été transféré à Dora, et a été affecté à des travaux de terrassement au kommando d’Ellrich. Au début d'avril 1945, il est évacué lors d'une marche de la mort à Ravensbrück, puis le 28 avril dans une baraque de l'usine d’explosifs chimiques de Malchow, où il a été libéré le 2 mai 1945. Rapatrié en France dans un état d'extrême faiblesse, il a été soumis à une longue convalescence avant de poursuivre sa carrière dans la préfectorale. En août 1945, alors qu'il se reposait chez lui à Rochefort-sur-Mer, il a été entendu comme témoin à la demande de René Bousquet inculpé devant la Haute Cour de Justice. Sa déposition, très favorable à l'ancien préfet de la Marne, dressait un tableau élogieux de l'action de Bousquet dans la Marne de 1940 à 1942. Après la guerre, il a repris du service, comme préfet de la Mayenne, préfet de la Sarthe, puis comme secrétaire général de la Seine, et il est devenu vice-président de l'assemblée du Corps préfectoral. Son témoignage, publié dès 1946 sous le titre Dora-Propos d'un bagnard à ses enfants, a reçu le prix Louis Paul Miller de l’Académie française en 1950.] S'agissant
des élus
et des fonctionnaires francs-maçons, parmi lesquels
il comptait beaucoup d'amis et qui se trouvaient menacés par
la législation antimaçonnique de Vichy, BOUSQUET s'est
efforcé de tout faire pour les protéger et y est assez
bien parvenu, suscitant la colère des ultras de
la collaboration. [Henri Martin est né le 15 février 1903 à Hautvillers. Viticulteur, gendre de Gaston Poittevin, militant socialiste, membre de la Loge n° 663 Anatole France de l’Orient d'Épernay et de la Loge La Bienfaisance châlonnaise de Châlons-en-Champagne, Henri Martin était avant-guerre maire d’Hautvillers, conseiller général socialiste du canton d’Aÿ et député du Front populaire élu dans la circonscription d’Épernay, et le seul député socialiste dans la Marne. Fondateur de la coopérative viticole d’Hautvillers et vice-président de la Fédération des coopératives viticoles, il animait la commission viticole de la SFIO. C’est à ce titre qu’il a présenté à l’Assemblée nationale une loi permettant la revalorisation et la garantie du prix minimum des vins, loi qui a été adoptée le 26 août 1936. Il est aussi avec Paul Lambin, député SFIO de l’Aisne, l’auteur du projet de loi présenté le 29 février 1939 concernant la création d’un Office régional du vin de Champagne. Le 10 juillet 1940 à Vichy, Henri Martin a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Avec l'accord des militants du Parti socialiste clandestin, il est entré au Comité interprofessionnel des vins de Champagne créé par le gouvernement de Vichy à l’initiative du préfet Bousquet. Après la promulgation de la loi du 11 août 1941 sur les sociétés secrètes, Bousquet a proposé de le maintenir à la tête de la mairie d’Hautvillers, mais Henri Martin a refusé. Son nom a figuré sur la liste des affiliés de la Loge Anatole France publiée au Journal Officiel du 19 août 1941, et il a été démissionné d’office le 31 octobre 1941 en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie, comme Gaston Poittevin son beau-père, conseiller municipal de Cumières, démis pour les mêmes motifs. Il a pu cependant compter sur la protection de René Bousquet jusqu’à l’automne 1943, époque où l’ancien préfet de la Marne, de plus en plus contesté au secrétariat général à la Police, qui se savait en sursis, a perdu de son influence. Arrêté le 30 septembre 1943 à Hautvillers par la Gestapo,Henri MAartin a été interné à Châlons-sur-Marne puis à Compiègne, et a été déporté avec Gaston Poittevin le 22 janvier 1944 à Buchenwald (matricule 41 580). Il a ensuite été transféré à Mauthausen où il est décédé quelques jours après la libération du camp, le 9 mai 1945, date et lieu retenus par le JO du 11 janvier 1995. La dépouille d’Henri Martin a été ramenée en France et ré-inhumée dans la sépulture familiale du cimetière d’Hautvillers le 21 décembre 1948. À Hautvillers, où une rue porte le nom d’Henri Martin, un monument honore sa mémoire sur lequel est gravé le numéro matricule 53 908 qui lui avait été attribué à Mauthausen. D’autres communes du vignoble ont donné son nom à une rue ou à une place : Aÿ-Champagne, Épernay, Champillon, Cumières, Mardeuil, Monthelon... Son nom est inscrit à Épernay sur la liste des déportés du monument aux martyrs de la Résistance, à Reims sur la stèle élevée au cimetière du Nord par le Parti socialiste SFIO, et à Châlons-en-Champagne sur la plaque 1939-1944 du Conseil général de la Marne. À Paris, son nom figure sur le monument commémoratif 1939-1945 de l’Assemblée nationale. Il est aussi inscrit sur le Livre d’Or « Aux Francs Maçons de la Grande Loge de France persécutés 1939-1945 », Livre d’Or édité in memoriam par la Grande Loge de France en 1947 et conservé 8, rue de Puteaux, et sur le Mémorial du Grand Orient de France 16, rue Cadet élevé « À la mémoire des Frères Maçons fusillés, déportés, morts au combat, victimes des nazis et de leurs alliés.»] [Gaston Poittevin est né le 15 juillet 1880 à Cumières. Vigneron dans cette commune, ancien combattant fait prisonnier pendant la Première Guerre mondiale, il a exercé durant l’entre-deux-guerres de nombreux mandats électifs et responsabilités professionnelles. Dignitaire de la franc-maçonnerie, il a été vénérable de la Loge La Bienfaisance châlonnaise de 1920 à 1940 et membre du conseil de l’Ordre du Grand Orient en 1939.À partir de 1919, il a été rédacteur de La Champagne Viticole et président du Syndicat général des vignerons de la Champagne délimitée. En 1935, il était membre de la Commission des appellations d’origine créée en 1935, alors que René Bousquet était directeur de cabinet du ministre de l’agriculture Pierre Cathala. Conseiller municipal de Cumières, conseiller général du canton de Châtillon-sur-Marne élu en 1919, battu en 1928 par le socialiste Léonce Bernheim, Gaston Poittevin a exercé quatre mandats de député de 1919 à 1936. Député radical-socialiste sortant, il n’est arrivé qu’en troisième position à l’issue du premier tour des élections législatives de 1936 dans la 1ère circonscription de Reims, et a refusé de se désister en faveur du candidat du Front populaire, Léonce Bernheim, contribuant ainsi à faire élire Pierre Pitois, candidat de la droite. De la Commission administrative au Conseil départemental Pour constituer
la Commission
administrative de la Marne, BOUSQUET a fait appel à des notables,
élus d'avant-guerre, responsables professionnels ou syndicalistes,
dont plusieurs étaient devenus ses amis, en réalisant
un savant
dosage entre les différentes sensibilités
politiques, religieuses, philosophiques, utilisant toutes les composantes
de la palette diversifiée du « notabilisme
de 1940 », pour reprendre l'expression utilisée
par Yves
DURAND (8). [Henri Patizel est né le 29 janvier 1871 à Charmontois. L’itinéraire de ce notable rural, pur produit de la Troisième République, illustre ce qu’a été l’attitude des élus marnais qui ont presqu’unanimement adhéré au régime du maréchal Pétain. Agriculteur, président de la Chambre d’agriculture de la Marne, maire de Givry-en-Argonne, conseiller général de Dommartin-sur-Yèvre depuis 1919, sénateur radical depuis 1932, Henri Patizel était président du conseil central de l’Office national du blé mis en place en 1936 par le gouvernement de Front populaire, initié dès 1935 par René Bousquet lorsque ce dernier était chef de cabinet du ministre de l’agriculture Pierre Cathala. Présent à Vichy le 10 juillet 1940, Henri Patizel a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. En 1940-1941, il a été désigné par le préfet Bousquet pour siéger à la Commission administrative de la Marne qui s'est substituée au Conseil général dissous, et pour présider la Commission de répartition du bétail et des céréales, ainsi que le Comité d’entente des organisations agricoles. En 1942, il était président d’honneur de l’Union régionale corporative agricole. En 1943, il a été placé à la vice-présidence du Conseil départemental nommé par le gouvernement de Vichy. À la Libération, Henri Patizel est tombé sous le coup de l'ordonnance du Gouvernement provisoire de la République française du 9 août 1944 qui privait du droit d'exercer une fonction publique les parlementaires ayant voté les pleins pouvoirs à Pétain. À partir d’octobre 1944, le comité cantonal d'épuration de Dommartin-sur-Yèvre a réclamé la dissolution du conseil municipal de Givry-en-Argonne, dissolution prononcée par arrêté préfectoral le 5 février 1945. Avant de se retirer, Henri Patizel a adressé une lettre de protestation à tous les habitants de sa commune, les seuls qui, selon lui, pouvaient le juger. Aucun habitant n'ayant accepté d'assumer le poste de maire, la délégation municipale installée en mars a été dissoute en avril, et la commune de Givry a été administrée jusqu'aux élections municipales par une délégation spéciale composée de fonctionnaires. En mai 1945, à l’issue des élections municipales, Henri Patizel, qui n’a été à aucun moment inquiété par l’épuration, et qui a été relevé de son inéligibilité, a retrouvé son poste de maire de Givry-en-Argonne, illustration de l’enracinement des notables dans le département de la Marne avant, pendant, et après le Seconde Guerre mondiale.] [Jean Jacquy est né le 27 juin 1875 à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire). Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, qu’il a terminée avec le grade de chef de bataillon, Jean Jacquy était un notable marnais appartenant à la droite républicaine. Agriculteur à Bouvancourt, commune dont il était maire depuis 1910, conseiller général du canton de Fismes depuis 1920, il a été élu député en 1924, a été battu aux législatives en 1928, puis il a siègé au Sénat à partir de 1933. Ami personnel depuis la bataille de Verdun du maréchal Pétain qu’il recevait dans sa propriété de Vaux-Varennes, Jean Jacquy est intervenu au nom des anciens combattants dans les manœuvres orchestrées par Pierre Laval qui ont abouti en juillet 1940 à la mise à mort de la Troisième République. Il a fait partie des six parlementaires marnais qui ont voté les pleins pouvoirs à Philippe Pétain le 10 juillet 1940 à Vichy. Sollicité pour rester à Vichy comme conseiller aux côtés du chef de l’État français, Jean Jacquy a récusé cette offre et il est rentré dans la Marne. Il est le seul Marnais parmi les membres désignés par Pétain pour siéger au sein du Conseil national créé en janvier 1941 par Vichy pour se substituer aux deux assemblées parlementaires dissoutes. En avril 1942, Jean Jacquy est intervenu avec René Bousquet qui venait d’être nommé secrétaire général à la Police à Vichy auprès de Joseph Bouvier, pour que ce dernier accepte de remplacer le maire de Reims, Paul Marchandeau, démissionnaire. L’objectif était de barrer la route au chef du Parti populaire français (PPF), le docteur Jolicoeur, un ultra de la collaboration. En 1943, Jean Jacquy a été désigné pour présider le Conseil départemental de la Marne qui a succédé à la Commission administrative provisoire mise en place au retour de l’exode par le préfet Bousquet pour remplacer le Conseil général dissous par Vichy. Dès la première séance de ce conseil, il a fait voter une motion de fidélité au maréchal Pétain. Il s’est efforcé de rallier les notables marnais à la Révolution nationale en les engageant à rejoindre les Amis du Maréchal, mais ce mouvement est passé bientôt sous le contrôle du PPF et Jacquy a tenté en vain de le rebaptiser en Amicale du Maréchal, Fidèles du Maréchal ou Compagnons français. En avril 1943, Jean Jacquy a participé à la conférence donnée sous l’égide du Groupe Collaboration par Philippe Henriot, chroniqueur de Radio-Paris, qui venait d’adhérer à la Milice. En février 1944, Jean Jacquy a été consulté par Justin Calmon, membre de l’état-major de la Milice, venu en mission d’inspection pour préparer l’implantation de la Milice en Champagne et qui recherchait un chef pour la Marne. À la Libération, fin août 1944, Jean Jacquy a été remplacé à la tête de sa mairie de Bouvancourt, mais n’a pas été inquiété. Il s'est retiré de la vie publique et il est décédé le 29 septembre 1954.] [Joseph Bouvier est né le 2 mai 1883 à Reims. Ancien combattant de 14-18, Joseph Bouvier était un chirurgien rémois réputé, professeur à l’École de médecine, directeur du Centre anticancéreux, fondateur de la clinique Foch. Lieutenant-colonel de réserve, il a été chargé par l’autorité militaire d’assurer le service médical de la place de Reims lors de l’offensive allemande de mai-juin 1940 et de l’évacuation de la ville. Il a été un des derniers Rémois à quitter Reims envahie par la Wehrmacht. Le 25 juillet 1940, il est rentré à Reims où il a repris ses activités de chirurgien. Dès le début de l’Occupation, il est intervenu auprès des autorités de Vichy pour maintenir à son poste son collègue juif Jankel Ségal, radiologue des Hôpitaux de Reims et du Centre anticancéreux. En novembre 1942, il a entrepris une démarche auprès de Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions juives, et a obtenu que le docteur Ségal soit exceptionnellement autorisé à exercer au titre du numerus clausus des médecins juifs instauré par le décret du 11 août 1941. Malgré le décret interdisant aux femmes juives d’accoucher dans les hôpitaux et cliniques, il n'a pas hésité à accueillir Sonia Nochimoswski dans sa clinique, où elle a mis au monde son fils Pierre. En avril 1942, lorsque Paul Marchandeau a démissionné de son poste de maire de Reims, le préfet Bousquet a fait appel à Joseph Bouvier pour le remplacer, avec l’appui de Jean Jacquy, unique membre marnais du Conseil national créé par le gouvernement de Vichy. Pour convaincre Joseph Bouvier d’accepter cette charge, Bousquet et Jacquy lui ont fait part de leur crainte de voir le poste tomber entre les mains du docteur Jolicœur, chef régional du PPF. En mars 1943, Joseph Bouvier a été nommé vice-président du Conseil départemental de la Marne mis en place par le gouvernement de Vichy. Cette instance succédait à la Commission administrative provisoire créée en 1940 pour se substituer au Conseil général dissous. Le 20 juillet 1943, Joseph Bouvier est intervenu auprès des autorités allemandes lors de l’arrestation de Jeanne Chatelin, infirmière, vice-présidente de la Croix-Rouge, et de son mari le docteur Philippe Chatelin, incarcérés à Reims puis à Fresnes jusqu’au 15 août 1943. Le 17 août 1943, très affecté par la mort brutale de son gendre et assistant, le docteur Lucien Stefani, Joseph Bouvier a démissionné de son poste de maire de Reims, a laissé la place à Henri Noirot, mais est resté membre du Conseil municipal. Lors de l’arrestation de Jankel Ségal et de son épouse Edla le 27 janvier 1944, il est intervenu en vain auprès des autorités allemandes et auprès du professeur Leriche, président des Médecins français et chirurgien en chef de l’Hôpital américain de Neuilly, qui avait eu le docteur Ségal sous ses ordres pendant la Première Guerre mondiale. Cette continuité
politique consensuelle qui
excluait les seuls communistes, avait été
facilitée par le fait que les responsables socioprofessionnels
et syndicaux du département, en particulier dans le monde agricole,
avaient pris conscience dès
les années 1930 dans le contexte de la crise, qu'ils
devaient s'unir malgré les vieux clivages qui opposaient
depuis plusieurs générations, chrétiens et laïcs,
droite et gauche. L'épreuve de l'exode, de la défaite,
puis de l'occupation, a accéléré
ce processus encouragé d'ailleurs par BOUSQUET lui-même, qui avait compris tout l'avantage qu'il pourrait en
tirer. [Robert Mangeart est né à Lavannes (Marne) le 24 septembre 1900. Agriculteur, père d'une nombreuse famille, formé dans les rangs de la Jeunesse agricole chrétienne (JAC), Robert Mangeart est une personnalité marquante de la paysannerie marnaise. Conseiller municipal de Lavannes avant-guerre, il a aussi été un militant du Syndicat agricole de Champagne, syndicat fondé en 1890, dont la devise était « Cruce et Aratro - Par la Croix et la Charrue ». Partisan d'un rapprochement entre ce syndicat chrétien et l'Union agricole, horticole et vinicole (UAHV), syndicat laïque d'inspiration radicale-socialiste animé par Albert Barré, il a défendu la création en 1938 de l'Union des organisations agricoles de la Marne, présidée par Albert Barré, qui est devenue le point de rencontre des dirigeants syndicalistes agricoles représentant les deux sensibilités, et l'expression d'une solidarité que l'épreuve de la guerre, de la défaite et de l'Occupation ont renforcée. Dès le retour de l'Exode et le début de l'Occupation, il a apporté sa collaboration à René Bousquet, secrétaire général de la Marne, dans la mise en place de responsables agricoles nommés dans chaque canton, pour faire face à la pénurie de main d'œuvre, d'engrais, de moyens de traction,pour assurer les récoltes et faire face aux réquisitions allemandes. Il a fait partie des sept membres de la Commission administrative choisis et nommés par René Bousquet, devenu préfet de la Marne, pour se substituer provisoirement au Conseil général de la Marne dissous à la fin de l'année 1940. En 1941, il a été reçu par le maréchal Pétain, a été nommé délégué général de l'Organisation corporative paysanne mise en place par le gouvernement de Vichy et il a siégé au Comité permanent ainsi qu'au Conseil national de la Corporation paysanne jusqu'en avril 1944, date de sa démission. En février 1942, à l'issue de l'assemblée générale constitutive de l'Union régionale corporative agricole, présidée par le préfet Bousquet, il en a été nommé syndic régional dans la Marne. En 1943, il a fondé à Reims une école d'agriculture qu'il a présidé jusqu'en 1968. La même année, il a été candidat au poste de syndic national de la Corporation paysanne, mais n'est arrivé qu'en seconde position derrière Adolphe Pointier qui a été élu. Dans le même temps il a été nommé par le gouvernement de Vichy membre du Conseil départemental appelé à prendre le relais de la Commission administrative créée par Vichy après la dissolution du Conseil général élu avant-guerre, et il en est devenu un des quatre secrétaires. À la Libération, il a comparu devant le Comité de Libération, et il a été déchu de son mandat de conseiller municipal ainsi que de ses droits civiques, mais il a participé en tant que délégué marnais au congrès constitutif de la Confédération générale de l'agriculture appelée à se substituer provisoirement à la Corporation paysanne dissoute en octobre 1944 par le gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle, et il en est devenu dès sa création un des quatre dirigeants. En mars 1945 il a été élu membre du conseil d'administration de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Marne, par l'assemblée générale constitutive de ce syndicat qui a remplacé la Corporation paysanne, et dont il est devenu ultérieurement le vice-président, puis le président. Réélu en avril 1945 conseiller municipal de Lavannes dès le premier tour sous l'étiquette Union républicaine démocratique, il a été invalidé en raison des responsabilités qu'il avait assumées sous le régime de Vichy au sein de la Corporation paysanne. Entendu comme témoin à la demande de René Bousquet traduit devant la Haute Cour de Justice après la guerre, Robert Mangeart a défendu l'action du préfet de Vichy dans la Marne. En 1946, il a participé au congrès fondateur de la Fédération des syndicats d’exploitants agricole (FNSEA), et à l’issue de ce congrès, il en a été nommé membre du conseil d’administration, et un peu plus tard secrétaire adjoint. En 1947, il a accédé à la présidence de La Providence agricole, une des plus importantes coopératives champenoises. Il a exercé de nombreux responsabilités sous la IVe et la Ve République comme président de La Providence agricole devenue Champagne Céréales et de la Coopérative sucrière de Bazancourt, comme membre du Conseil économique et social, et comme administrateur des hôpitaux, de la caisse départementale du Crédit agricole et de la Mutualité sociale agricole. Dans ses Souvenirs et réflexions publiés en 1982, il assume totalement son engagement au service de la politique agricole de Vichy qui, selon lui, n'a pas été une rupture ni une parenthèse dans son long parcours de responsable agricole marnais, mais au contraire une période d'opportunité qui lui a permis de réaliser « l'unité paysanne, l'unité du monde agricole ».] [Albert Barré est né le 19 février 1894 à Condé-sur-Marne (Marne). Maire de cette commune, maintenu à son poste par le gouvernement de Vichy en 1940, Albert Barré présidait avant-guerre l’Union agricole, horticole et vinicole, syndicat d’inspiration laïque, anticléricale et radicale-socialiste, rival du Syndicat agricole de la Champagne, syndicat d’inspiration chrétienne présidé par Robert Mangeart. Albert Barré présidait également l’Union des organisations agricoles de la Marne constituée en 1938, qui était une structure de concertation entre les responsables des deux syndicats. En juillet 1940, à l’instigation de René Bousquet, secrétaire général du département, qui n’était pas encore préfet, Albert Barré a accepté de fusionner son syndicat avec celui de Robert Mangart au sein d’un Comité d’entente des organisations agricoles de la Marne. Lorsqu’en 1942 le gouvernement de Vichy a créé la Corporation paysanne, il a été nommé Syndic régional adjoint aux côtés de Robert Mangeart. À partir de mars 1943, nommé par le gouvernement de Vichy, il a siégé au sein du Conseil départemental qui s'est substitué à la Commision administrative créée après la dissolution par Vichy du Conseil général élu avant-guerre. À la Libération, il a dirigé L’Union républicaine de la Marne, quotidien d’inspiration radicale-socialiste qui avait cessé de paraître sous l’Occupation. En septembre 1944, il a lancé dans ce journal avec Georges Bruyère, ancien maire de Châlons-sur-Marne nommé par Vichy et ami de Bousquet, une souscription pour l’érection d’un monument destiné à honorer la mémoire des fusillés. En mars 1945, il a présidé l’assemblée générale constitutive de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et il a été élu membre de son conseil d’administration. À l’issue des élections municipales d’avril-mai 1945, il a été réélu maire de Condé-sur-Marne. Entendu comme témoin, il a témoigné à sa demande en faveur de René Bousquet traduit devant la Haute Cour de Justice. Albert Barré est décédé le 2 février 1959 à Sézanne. Une rue porte son nom à Condé-sur-Marne.] En
février 1942, à l'issue de l'assemblée
générale constitutive de l'Union
régionale corporative agricole présidée
par René
BOUSQUET, Robert
MANGEART a été nommé syndic
régional et Albert
BARRÉ, syndic
régional adjoint. Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) Dès
le retour de l'exode, BOUSQUET et les responsables de la profession du champagne ont su habilement
tirer parti de l'intérêt porté par les Allemands
à ce produit de consommation de luxe très prisé,
pour relancer
opportunément l'activité de ce secteur, en l'organisant
de façon plus efficace et plus rationnelle, selon
les voeux des différents partenaires de la profession, et aussi
pour essayer de freiner les exigences allemandes.
À
Épernay, le 10 juillet 1941, BOUSQUET a assisté à l'assemblée générale annuelle
du Syndicat
général des vignerons présidé
par son ami Gaston
POITTEVIN. Devant 200
délégués de la Champagne viticole venus de la Marne, de l'Aube et de l'Aisne, le secrétaire général Maurice
DOYARD a annoncé la naissance du Comité
interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) créé
par la
loi du 12 avril 1941 signée par Philippe PÉTAIN. Ce comité était appelé, selon
lui, à devenir « la
représentation de tous les intérêts champenois »,
et il en a expliqué le fonctionnement. BOUSQUET a parlé de la mise en œuvre de la Charte
du champagne qui devait fixer les droits et les devoirs
de tous les éléments de la production et du commerce
: « Il
ne faut pas que la nouvelle organisation de la viticulture soit la
revanche de quelques hommes sur d'autres hommes, un retour à
des erreurs ou des égoïsmes passés [...] À
l'issue de cette assemblée générale, le Weinführer des vins de champagne Otto
KLAEBISCH et son adjoint MULLER ont fait leur entrée dans la salle et ont participé aux
libations d'usage (21).
[Maurice Doyard est né le 18 mai 1889 à Vertus (Marne). Vigneron dans cette commune, il y a racheté une exploitation viticole au lendemain de la 1ère guerre mondiale et y a fondé en 1927 la coopérative de vinification. En 1935, secrétaire du Syndicat général des vignerons présidé par Gaston Poittevin, il a siégé avec ce dernier au sein de la Commission nationale des appellations d’origine créée par Pierre Cathala, ministre de l’agriculture de Pierre Laval. Le directeur de cabinet de Cathala était alors René Bousquet, futur préfet de la Marne sous l’Occupation. Maurice Doyard a participé au comité d’experts qui, à son initiative, a élaboré et fait adopter le décret-loi du 28 septembre 1935. Ce décret-loi fixait des critères de qualité plus stricts liés à la réglementation de l’appellation « Champagne », et créait une Commission spéciale de la Champagne viticole, baptisée « Commission de Châlons », dont le secrétaire était Robert de Vogüé. Conseiller municipal de Vertus, Maurice Doyard a été candidat du Parti radical dans l’arrondissement d’Épernay face au candidat du Front populaire Henri Martin lors des élections législatives de 1936. Battu au premier tour, il s’est retiré au second tour en refusant d’appeler à voter pour Henri Martin. En août 1940, Maurice Doyard a participé avec Gaston Poittevin à la réunion de la Sous-commission des prix présidée à la préfecture par le secrétaire général René Bousquet, qui n’était pas encore préfet, en présence du sonderführer du champagne Otto Klaebisch. En novembre 1940, il a représenté les propriétaires-récoltants au Bureau de répartition du vin de Champagne institué par le gouvernement de Vichy. En décembre 1940, c’est à son initiative que le Syndicat général des vignerons s’est fondu dans la Corporation paysanne créé par le gouvernement de Vichy. Lorsqu’en avril 1941, le gouvernement de Vichy a créé le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), Maurice Doyard en a été nommé délégué général des vignerons aux côtés de Robert de Vogüé nommé délégué général des négociants. À partir de mars 1943, Maurice Doyard a siégé au sein du Conseil départemental créé pour se substituer au Conseil général élu avant-guerre qui avait été dissous dès le début de l’Occupation, et dont tous les membres étaient nommés par le gouvernement de Vichy. Il en était un des quatre secrétaires. À la Libération, Maurice Doyard dont on considérait qu’il avait bien servi les intérêts des vignerons n’a pas été inquiété. Il est décédé le 7 mai 1974 à Vertus.] [Robert-Jean de Vogüé est né le 3 août 1896 à Menetou-Salon (Cher). Notable reconnu, le comte Robert-Jean de Vogüé était l’archétype du vichysto-résistant dans la Marne. Négociant en vin de champagne, gérant de la maison Moët et Chandon d’Épernay depuis 1930, secrétaire de la Commission spéciale de la Champagne délimitée créée en 1935, Robert-Jean de Vogüé a été nommé par René Bousquet en 1940 membre de la Commission administrative provisoire, puis en 1941 du Conseil départemental, créés par le gouvernement de Vichy pour se substituer au Conseil général de la Marne dissous. En septembre 1940, il a fait partie du Bureau de contact composé de quelques représentants des négociants de champagne, qui a été institué pour entrer en rapport avec la puissance occupante. En novembre 1940, il a siégé au sein du Bureau national de répartition du vin de Champagne mis en place par le gouvernement de Vichy. En 1941, Robert-Jean de Vogüé a été nommé délégué général du Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), représentant du négoce, désigné par le secrétaire d’État, ministre de l’Agriculture. Président du Groupement interprofessionnel patronal d’Épernay (GIPER), Robert-Jean de Vogüé a participé dès l’automne 1940 à la création d’une Maison du travail destinée conformément à la politique corporative de Vichy à regrouper les organisations patronales et ouvrières. En 1942, il a été l’initiateur avec Fernand Muls, président de l’Union locale des syndicats ouvriers, du Centre interprofessionnel et social d’Épernay (CIS), un des premiers à voir le jour dans la France de Vichy pour promouvoir la Charte du travail promulguée en octobre 1941. En 1943, membre de Saule, sous-réseau d’Éleuthère dans la Marne, Robert-Jean de Vogüé a animé le le mouvement Ceux de la Libération (CDLL) à Épernay, aux côtés de son secrétaire Henri Fignerol, de Frère Birin et de Maurice Germain. Le 24 novembre 1943, il a été arrêté par la Gestapo dans le bureau d’Otto Klaebisch le « Weinführer du champagne » 3, boulevard Désaubeau à Reims. Le 29 novembre, Maurice Leflond, secrétaire du syndicat des cavistes a lancé un ordre de grève aux employés et ouvriers des sociétés vinicoles de Reims et d’Épernay pour protester contre cette arrestation. Incarcéré à la prison de Châlons-sur-Marne, Robert-Jean de Vogüé s'est confié à son voisin de cellule Robert Tritant, chef du mouvement Ceux de la Résistance (CDLR) à Châlons, sans se rendre compte que des micros étaient dissimulés dans sa cellule. Son procès, que les Allemands ont voulu public, a eu lieu en février-mars 1944 à Reims dans la salle des criées de la Chambre des notaires, cours Langlet et non pas à Châlons-sur-Marne où siégeait habituellement le tribunal militaire allemand. Condamné à mort, Robert-Jean de Vogüé a été gracié, bénéficiant de multiples interventions, dont celle de l'ambassadeur de Suède et celle du gouvernement de Vichy dont René Bousquet ne faisait alors plus partie. Ce dernier pouvait néanmoins encore plaider la cause du délégué du CIVC qu'il avait bien connu dans la Marne, auprès des autorités allemandes, auprès de Laval ou auprès de Pétain lui-même. Robert-Jean de Vogüé a été interné en France puis déporté comme résistant le 27 juin 1944 dans les prisons de Karlsruhe, de Rheinbach, de Ziegenhain, et de Rheinberg, où il a été libéré le 3 mai 1945. Deux résistants sparnaciens jugés et condamnés à mort en même temps que lui, René Herr et Léon Leroy, ont été fusillés, de même que Robert Tritant. Robert-Jean de Vogüé a été homologué FFC (Forces françaises combattantes) et il a reçu le titre est de Combattant volontaire de la Résistance (CVR), mention DIR (Déporté-interné-Résistant) ainsi que la Médaille de la Résistance. Après la guerre, lorsqu’à l’époque de la guerre froide la scission est intervenue au sein de l’association des anciens déportés, Robert de Vogüé a adhéré à la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP) aux côtés des anciens résistants d’obédience communiste. À Épernay, le nom de Robert-Jean de Vogüé, décédé le 17 octobre 1976, a été donné à une place de la ville où se dresse un buste honorant sa mémoire.] Ainsi,
le CIVC qui, aujourd'hui encore, joue un rôle très important dans
l'économie champenoise, est né curieusement de la rencontre entre la situation créée par l'importance
des prélèvements allemands, le souci des
professionnels de répondre
à cette demande, leur volonté de faire aboutir
une réorganisation
de la profession qu'ils réclamaient depuis longtemps
avec insistance, les projets
corporatistes et dirigistes des technocrates de Vichy,
et enfin la bonne
connaissance de ce dossier qu'avait acquise René
BOUSQUET, lors de son passage au ministère de l'Agriculture
aux côtés de CATHALA avant la guerre. Il a été
beaucoup plus difficile à René
BOUSQUET de faire adhérer les syndicalistes
ouvriers à la Charte
du travail promulguée par le gouvernement de Vichy en
octobre 1941, et qui a suscité d'emblée indifférence et scepticisme. Les confédérations
syndicales ouvrières (CGT, CFTC) et patronale
(CGPF) avaient été dissoutes en
novembre 1940 à l'échelon national,
mais les Uunions
locales ouvrières, plus ou moins tolérées, ont réussi
à se maintenir et ont refusé de se rallier à
la Charte du travail sauf à Épernay.
« Il
est certain que Bousquet dans les fonctions administratives qu'il
a occupées dans la Marne a suivi les directives de Vichy, notamment
dans la tentative de mise en application de la Charte du travail. À Épernay, en effet, avait été
constituée dès
l'automne 1940 la première Maison
du travail regroupant organisations patronales et ouvrières,
qui annonçait ce qu'allaient être en
1942 les Comités
sociaux préconisés par la Charte
du travail. Le Centre
interprofessionnel et social (CIS) d'Épernay est
né à l'initiative du Groupement interprofessionnel patronal
d'Épernay et de la région (GIPER) et de l'Union locale des syndicats ouvriers d'Épernay animés
respectivement par Robert
de VOGÜÉ et par Fernand
MULS (26). Ils avaient été nommés tous les deux par BOUSQUET membres de la Commission administrative de la Marne, et allaient
bientôt siéger au Conseil départemental. [Fernand Muls est né le 1er mars 1902 à Épernay (Marne). Il exerçait la profession d'employé de bureau au magasin d'approvisionnement général d'Épernay. Lors du congrès de la CGT en 1935, il y a représenté le syndicat des cheminots d'Épernay. Secrétaire de l'Union locale CGT confédérée et de la Bourse du Travail d'Épernay et conseiller général socialiste de la Marne avant la guerre, il s'est rallié à la Révolution nationale et a adhéré au Rassemblement national populaire (RNP) de Marcel Déat. Il a été nommé conseiller municipal d'Épernay et membre de la Commission administrative, puis du Conseil départemental de la Marne par le préfet de Vichy, René Bousquet. Dès l'automne 1940, secrétaire de l'Union locale des syndicats ouvriers d'Épernay, il a été l'initiateur, avec Robert de Vogüé, président du Groupement interprofessionnel patronal d'Épernay et de la région (GIPER), de la première Maison du travail qui regroupait organisations patronales et ouvrières. Ensemble ils ont mis ensuite en place le Centre interprofessionnel et social (CIS) d'Épernay, qui est devenu le laboratoire de la mise en œuvre de la Charte du travail. Le 3 septembre 1944 au lendemain de la Libération, se sentant menacé, Fernand Muls s'est présenté spontanément à la Gendarmerie. Traduit devant la Chambre civique de la Marne, il a été jugé tardivement le 21 juin 1945, et a bénéficié d'un verdict de clémence. La Chambre civique l'a relevé d'indignité nationale « pour participation active à la résistance », selon la formule consacrée pour blanchir les collaborateurs, sans appuyer ce verdict sur aucun fait précis. Ce verdict de clémence peut s’expliquer par le fait que Fernand Muls a caché des résistants recherchés par la Gestapo qui avaient été ses camarades au sein de la SFIO et de la CGT confédérée avant-guerre.] [Marcel Déat est né le 7 mars 1894 à Guérigny (Nièvre). Issu d'une famille modeste de petits fonctionnaires, il a fait de brillantes études secondaires au lycée de Nevers puis, grâce à une bourse, deux années de classes préparatoires au Lycée Henri IV. En 1914 il a été reçu à l'École normale supérieure et a adhéré au Parti socialiste SFIO. Mobilisé, il a terminé la Première Guerre mondiale avec le grade de capitaine. Reçu en 1920 à l'agrégation de philosophie, il a occupé d'abord le poste de secrétaire du Centre de documentation sociale de l'École normale supérieure, puis a été nommé professeur de philosophie au lycée de Reims en octobre 1922, un poste qu’il a occupé jusqu’à sa mutation en 1925 à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm à Paris. En 1924, il a épousé Hélène Buridan, fille de l’instituteur de Breny dans l’Aisne, qui avait été son élève au cours de l’année scolaire 1922-1923. C’est à Reims et dans le département de la Marne qu’il a fait « ses classes politiques ». Il y a milité activement, y a exercé des mandats électifs, et il a animé l'hebdomadaire de la fédération du Parti socialiste SFIO, Le Travail de la Marne, dont il a assuré la direction politique jusqu'en janvier 1933. En 1924, candidat malheureux aux élections législatives, il a figuré en deuxième position sur la liste présentée par le parti socialiste SFIO dans la Marne, derrière Jules Lobet député sortant, réélu au quotient. En mai 1925, il a été élu conseiller municipal de Reims sur une liste d'union conduite par le radical Paul Marchandeau qui est devenu maire de Reims, et il a refusé un poste d'adjoint. En novembre 1925, il a représenté la fédération de la Marne au Conseil national de la SFIO. En février 1926, colistier de Paul Marchandeau, il a été élu député socialiste de la Marne à la faveur d'élections partielles, alors que la commission administrative de la SFIO avait refusé de ratifier sa candidature, le suspectant d'être un révisionniste « participationniste ». En juin 1926, au congrès de la SFIO réuni à Clermont-Ferrand, il a été appelé à s'expliquer. Soutenu par Renaudel et Ramadier, il s'est contenté d'affirmer que depuis son élection, la fédération de la Marne était en pleine croissance et qu'elle saurait démontrer son attachement à la SFIO. Le 27 juin 1926 à Reims, il a participé à un meeting antifasciste réuni pour protester contre un rassemblement national du Faisceau présidé par Georges Valois et Marcel Bucard. En avril 1927, il a représenté la fédération de la Marne au congrès de la SFIO réuni à Lyon. Aux élections législatives de 1928, bien qu'arrivé en tête à l'issue du premier tour, il a été battu au second tour par un candidat investi par les radicaux d'Épernay, qui a refusé de se désister et a bénéficié du report des voix de la droite au second tour. Aux élections cantonales de 1929, il a été à nouveau battu dans les mêmes conditions qu'aux élections législatives de 1928.
En 1930, en publiant Perspectives socialistes, un ouvrage où il prenait ses distances avec le marxisme et développait des thèses participationnistes, il est devenu le chef de file des révisionnistes et le théoricien du néo-socialisme. En 1932, il a été élu député face au communiste Jacques Duclos dans le XXe arrondissement de Paris. En juillet 1933, au congrès extraordinaire de la SFIO réuni à la Mutualité, il a attaqué vigoureusement la direction du Parti socialiste, rendant la rupture inéluctable. En novembre 1933, le Conseil national de la SFIO a considéré que Déat et ses amis s'étaient mis hors du parti. Déat a créé alors le Parti socialiste de France-Union Jean Jaurès, dont il est devenu le secrétaire général et qui regroupait ceux qu'on a appelé désormais les néo-socialistes.
Après l'émeute du 6 février 1934, il a adhéré au Comité de vigilance des intellectuels antifascistes. En novembre 1935, le Parti socialiste de France a fusionné avec d'autres partis dissidents de la SFIO pour former l'Union socialiste républicaine. En marge de ce rassemblement, il a créé un Comité du Plan pour développer une réflexion sur les formules planistes d'« économie dirigée ».
En janvier 1936, il a été nommé ministre de l'Air dans le Cabinet Albert Sarraut. En mars 1936, lors de la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler, il a prôné la négociation et a pris position contre une intervention militaire. Aux élections législatives de mai 1936, il a été battu par le candidat communiste dans sa circonscription du XXe arrondissement de Paris. En 1938, il a été un partisan résolu de la négociation avec l'Allemagne hitlérienne et a défendu avec force les accords de Munich, dénonçant la « conjuration contre la paix » et se montrant partisan d'une politique extérieure d'apaisement. En avril 1939, candidat du Rassemblement anticommuniste dans une élection partielle, il a été élu député à Angoulême. Le 4 mai 1939, il a publié dans L'Oeuvre un article ayant pour titre " Mourir pour Dantzig ? ", dans lequel il affirmait : « Les paysans français n'ont aucune envie de mourir pour les Poldèves ». En septembre 1939, il a signé le tract de Louis Lecoin « Paix immédiate ». Le 10 juillet 1940, à Vichy, Déat a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, puis a défendu un projet de parti unique au service de la Révolution nationale, projet qui a échoué en raison de la création en zone non occupée de la Légion des combattants. Directeur de L'Oeuvre, devenu un des principaux journaux collaborationnistes, il est devenu très critique à l'égard du régime de Vichy, jugé trop mou. Il a été arrêté en même temps que Laval en décembre 1940, puis relâché peu après sur intervention de l'ambassadeur d'Allemagne, Otto Abetz. Au début de l'année 1941, Déat a fondé en zone occupée le Rassemblement national populaire (RNP), parti qui sous la pression des Allemands a fusionné avec le Mouvement socialiste révolutionnaire (MSR) d'Eugène Deloncle. Il est resté en relation avec d’anciens camarades socialistes et syndicalistes enseignants marnais qui l’ont suivi au RNP. Après l'invasion de l'Union soviétique par la Wehrmacht en juin 1941, il a été un des initiateurs de la Légion des volontaires français et a siégé à son Comité central. Victime en même temps que Laval, en septembre 1941, d'un attentat dont il a soupçonné Deloncle d'en avoir été l'instigateur, il a rompu avec le MSR et a réorganisé le RNP. Le 19 avril 1942, à Reims, au cours d'une réunion d'information organisée par le RNP, Déat a appelé son auditoire à soutenir le gouvernement formé par Pierre Laval qui venait de nommer René Bousquet au secrétariat général à la Police. En septembre 1942, Déat a tenté à nouveau, mais en vain, d'unifier les partis de la collaboration au sein d'un Front révolutionnaire national, dont était écarté son rival, le chef du Parti populaire français (PPF), Jacques Doriot. En 1943, Déat a appelé les membres du RNP à adhérer à la Milice. En mars 1944, il a été nommé ministre du Travail et de la Solidarité nationale, mais il est resté à Paris, refusant de s'installer à Vichy. En août 1944, il a fui Paris et a traversé la Marne pour gagner Nancy, puis Sigmaringen, avec les irréductibles de la collaboration. Condamné à mort par contumace par la Haute Cour de Justice le 19 juin 1945, Déat est parvenu à se cacher en Italie. Il a été accueilli et caché dans un couvent où il a rédigé ses Mémoires publiées en 1989 chez Denoël. Marcel Déat est mort le 5 janvier 1955.] « Sur
le plan syndical, nous n'avons pas eu à nous plaindre de monsieur
Bousquet aussi bien pendant la guerre qu'avant la guerre. Durant l'occupation allemande, l'activité
syndicale s'est trouvée très réduite, mais de
toute façon il n'a apporté aucune entrave à notre
activité. Les Allemands ayant occupé la Bourse du travail,
il a fait louer par la ville de Châlons-sur-Marne un local qui
a été mis à notre disposition. Je dois dire toutefois que monsieur Bousquet a essayé
de faire appliquer la Charte du travail promulguée par le gouvernement
de Vichy. Pour cela il a convoqué à Reims les
militants syndicalistes de la CGT et de la CFTC. Inquiété par les Allemands à la suite d'une perquisition à son domicile où furent découverts les archives de la Bourse du travail et les drapeaux rouges des syndicats châlonnais, DENIS a déclaré qu'il avait fait appel à BOUSQUET. Ce dernier serait intervenu auprès des autorités allemandes en sa faveur, et lui aurait proposé de mettre à l'abri, à la bibliothèque de Châlons, les documents et les bannières provenant de la Bourse du travail. Cette république
marnaise des notables, à laquelle radicaux et socialistes ont apporté leur caution, au moins dans un premier temps, s'organisait
aussi autour des nombreuses
visites, relatées régulièrement dans L'Éclaireur
de l'Est, que le préfet
BOUSQUET, homme
de terrain, effectuait dans son département : Le soutien de la hiérarchie catholique René BOUSQUET a aussi entretenu d'excellents rapports avec les prélats des diocèses de Reims et de Châlons-sur-Marne qui lui étaient reconnaissants d'avoir loyalement appliqué dans la Marne les mesures en faveur de l'enseignement catholique, et cela malgré ses origines radicales, ses amitiés franc-maçonnes et ses convictions laïques. De son côté, le préfet de la Marne, dans son rapport de janvier 1942 aux autorités de Vichy, s'était attaché à montrer le parfait loyalisme de l'archevêque de Reims envers le régime du maréchal PÉTAIN : « Monseigneur Marmottin, dont l'action ecclésiastique a toujours été importante dans la région, en réponse aux voeux qui lui avaient été exprimés par les associations et oeuvres catholiques de Reims, a précisé l'attitude que doivent adopter les catholiques à l'heure présente au point de vue religieux, social et civique. Sur le terrain civique en particulier, l'Archevêque de Reims invoque les plus hautes raisons doctrinales, affirme le caractère impérieux qui met la conscience en cause, de l'obéissance au chef de l'État le Maréchal Pétain et à ses représentants légaux, comme investis du pouvoir légitime reçu de Dieu. Toute cette partie de l'allocution de l'Archevêque de Reims recevra sans doute une publicité nouvelle dans un texte officiel, que non seulement les catholiques, mais tous les Français auront intérêt à connaître » (33). [Louis-Augustin Marmottin est né le 11 mars 1875 à La Neuville-au-Pont (Marne). Ordonné prêtre du diocèse de Châlons-sur-Marne en 1898, il a été nommé évêque de Saint-Dié en 1930, une fonction qu’il a exercée jusqu’à sa nomination à la tête de l’archevêché de Reims en août 1940 en remplacement du cardinal Suhard nommé archevêque de Paris. Dès le début de l’occupation allemande, Monseigneur Marmottin a accepté la défaite comme une sanction voulue par Dieu, et a témoigné constamment un parfait loyalisme à l'égard du régime de Vichy ainsi qu'une véritable vénération à l'égard de Pétain, déclarant notamment le 28 décembre 1940 :« Serrons-nous autour de la personne vénérée du chef que la France s'est donnée. Quelle grande et belle figure que la sienne ! Elle s'impose par sa pureté sans tache, par sa noblesse sans défaillance à l'admiration de l'Univers. Et nul ne peut, mieux que le Maréchal Pétain avec plus de sagesse et plus d'autorité, gouverner notre pays, refaire ses idées et ses mœurs, et lui rendre son prestige auprès des autres peuples. Au surplus, il est également le Chef de l'État français, auquel nous devons le respect, loyale obéissance et entier dévouement ». Un peu plus tard, il a condamné comme « péché mortel » la désobéissance au gouvernement de Vichy, et a dénoncé les résistants comme des « rebelles » au service de l'étranger : « Les fidèles qui n'obéissent pas au gouvernement légal de Vichy commettent un péché mortel. De même, ceux qui se rangent du côté des rebelles ou suivent les directives d'une puissance étrangère qui par ses appels les invitent à désobéir au gouvernement, commettent une faute grave envers la France et envers Dieu ». En 1941, il a exposé les conditions du redressement de la France, affirmant que « la neutralité scolaire, en privant de Dieu les jeunes âmes, avait été la première cause de ses récents malheurs », rappelant « les vrais principes de l'Éducation qui ne peut être que chrétienne », fustigeant « le mépris des divines lois du Mariage » ainsi que « les ravages causés par le divorce, l'union libre, l'adultère, la stérilité volontaire, l'avortement », pleurant sur « la famille française jadis si féconde », dénonçant « la dépopulation causée par l'immoralité » qui, selon lui, avait compté pour beaucoup dans « la défaite de notre pauvre pays », et présentant les prêtres comme « les artisans nécessaires et les plus puissants du relèvement français ». Le préfet de Vichy René Bousquet a entretenu d'excellents rapports avec l’archevêque de Reims qui lui a été reconnaissant d'avoir loyalement appliqué dans la Marne les mesures en faveur de l'enseignement catholique, et cela malgré ses origines radicales, ses amitiés franc-maçonnes et ses convictions laïques. De son côté, le préfet de la Marne, dans son rapport de janvier 1942 aux autorités de Vichy, s’est attaché à montrer le parfait loyalisme de Monseigneur Marmottin envers le régime du maréchal Pétain, relevant qu’il « affirme le caractère impérieux de l'obéissance au chef de l'État le Maréchal Pétain et à ses représentants légaux, comme investis du pouvoir légitime reçu de Dieu ». En janvier 1942, Monseigneur Marmottin, pressenti par le délégué régional de la LVF pour présider le comité d’honneur rémois de cet instrument de la collaboration militaire avec l’Allemagne nazie, s'est récusé en raison du caractère de sa fonction, mais a promis son appui et son aide. Lors des obsèques des victimes des bombardements alliés de mai 1944, il a fustigé les « oiseaux meurtriers » qui jetaient la « terreur et désolation » sur la « ville sainte de la patrie française », et il a manifesté sa « réprobation devant les méthodes de guerre qui ne respectent ni rien, ni personne, qui se rient des lois divines et humaines, qui font servir la science et le progrès à une destruction de la civilisation ». Il a magnifié l'« immolation collective » des victimes rémoises et les a associées aux « milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de France, de tout âge, massacrés tous les jours sans ménagement, sans pitié ». Le 11 juillet 1944, il ne s’est pas opposé à ce qu’un service religieux honore dans la cathédrale de Reims la mémoire du milicien Philippe Henriot exécuté par la résistance, en présence des miliciens et des collaborationnistes marnais, mais il n’y a pas participé. Après la Libération, Monseigneur Marmottin s'est rallié de bon gré à la résistance, et a participé officiellement à la célébration de la victoire alliée de mai 1945. Le 9 mai 1945, il a présidé dans sa cathédrale un Te Deum solennel à l’issue du défilé de la Victoire. Le 13 mai 1945, il a célébré la fête de Jeanne d’Arc en déclarant : « Que pouvait Hitler contre nos saints de France, ligués là-haut pour la protection d’une patrie que sauva d’un péril mortel la pure jeune fille que nous célébrons aujourd’hui, notre prodigieuse Jeanne d’Arc ? Une vision s’impose à nous en ce moment, celle de Jeanne d’Arc à genoux dans ce sanctuaire, les drapeaux des nations victorieuses sont à l’honneur aujourd’hui. Chacun d’eux implore pour le pays qu’il représente la guérison de ses blessures, la concorde de ses fils, un glorieux avenir ». Après la guerre, bien que figurant sur la liste des prélats susceptibles d’être inquiétés, monseigneur Marmottin a été épargné par l’épuration épiscopale, mais n’a jamais reçu le chapeau de cardinal traditionnellement attaché au siège archiépiscopal de Reims.]
|
|