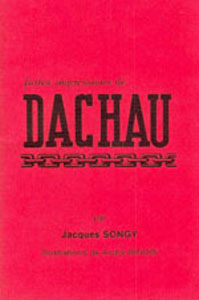|



|
|
||||
| Histoire et mémoire 51 > Histoire et mémoire de la déportation > Témoins 51 > Jacques Songy | ||||
| |
||||
Fortes impressions de Dachau par Jacques
Songy Jacques SONGY (1924-2008)
Jacques Songy en 2008 Jacques Songy est né le 12 juin 1924 à Châlons-sur-Marne. Étudiant, domicilié à Châlons-sur-marne, il rejoint en mai 1944 le groupe Melpomène animé par Jacques Degrandcourt au maquis de Marson. Il sert comme agent de liaison et participe au transport du ravitaillement et des armes. Incarcéré à Châlons-sur-Marne, il est déporté comme résistant le 19 août 1944 à Natzweiler-Struthof (matricule 22 837 ), puis il est transféré à Dachau où il est libéré le 29 avril 1945. Il rentre en France le 17 mai 1945. Dès son retour de déportation en mai 1945, Jacques Songy rassemble ses souvenirs de déportation dans Fortes impressions de Dachau, ouvrage publié en 1946 et réédité en 1985. Jacques Songy confie la maquette de la première édition à Guy Boisot, déporté au camp de Dora, et demande à André Binois, ancien camarade du collège de Châlons-sur-Marne, de réaliser quelques illustrations.
Le mémorial de Dachau su Cimetière du Père Lachaise Président de l'Amicale des déportés de Châlons, il est avec Jean Chabaud, président de l'Amicale des résistants de cette ville, à l'origine du Centre de mémoire aménagé 7, Cours d'Ormesson dans le sous-sol de l'ancien siège de la Gestapo, inauguré en août 1994.
Jacques Songy au pied du Mémorial de Natzweiler-Struthof en 19 Décédé en 2008, Jacques Songy est combattant volontaire de la Résistance, mention DIR, et titulaire de la médaille de la résistance. Il est inhumé au cimetière de l’Ouest de Châlons-en-Champagne où une rue porte son nom depuis mai 2009. __________________________________________________________________________________________________________________
Illustrations d'André Binois
Quelques
semaines après mon retour de Dachau, en mai 1945, j'écrivais
ces Fortes impressions, publiées en 1946, toutes
fraîches et parfois naïves, issues des souvenirs marquants
de l'expérience vécue de ma vingtième année. Par
ailleurs il y avait ces Notes consignées à
Dachau ramenées presque intactes. Voici le tout dans une nouvelle édition revue et annotée, réalisée en 1985 pour le 40ème anniversaire de la libération des camps de concentration, aujourd'hui épuisée. La
maquette de la 1ère édition était de Guy Boisot,
imprimeur, ancien du Camp de Dora.
Préface de l'édition de 1985 Au moment où j'écris ces lignes, quarante ans achèvent de s'écouler qui nous séparent de ce 29 avril 1945, date magique, mots-clés signifiant : « Libération du camp de concentration de DACHAU ». Ce
jour là, un militaire Américain debout dans une Jeep agitait
son bras gauche désespérément tandis que l'autre
bras brandissait une mitraillette. Un
garçon un peu chancelant se laissait bousculer au cinquième
ou sixième rang et malgré qu'il fit des efforts pour crier,
un son ridicule sortait de sa bouche. Dans les souvenirs, certaines images s'estompent avec le temps. Parfois il arrive qu'on en modifie les formes et les contours. Un scénario s'installe plus ou moins complaisant avec la vérité, qui change l'impression originale. Mais, ce 29 AVRIL 1945, tous ceux que la providence a permis qu'il revive dans leur mémoire d'anciens de Dachau, restera une image claire et pure que rien ne saurait modifier ni altérer. Pour
moi tout cela avait commencé par le réveil en sursaut
provoqué par le bruit caractéristique que produit le claquement
de porte d'une « traction-avant » au petit matin.
Je
ne puis que traduire l'angoissante réalité à mon
compagnon de maquis par ces mots : La Gestapo ! Nous étions deux,
coincés maintenant dans cette chambre de ferme tandis que des
cris et des imprécations venant de la cour ne couvraient pas
l'inquiétant martèlement de botte montant l'escalier. Quelques heures plus tard, une centaine d'hommes nus et rasés, l'air faussement détachés non loin d'une cabane triste, s'interrogeait sur ce qu'ils venaient de vivre et sur ce lieu entouré de barbelés ponctués de miradors. D'autres cabanes tristes s'étageaient strictement sur la pente de cette petite montagne, d'où l'on découvrait l'harmonieux paysage des Vosges. Un lieu nommé NATZWEILER-STRUTHOF. C'était inscrit en lettres gothiques au-dessus de l'entrée du Camp. Retrouver
ses camarades de maquis, de résistance, ses voisins de prison,
ses connaissances, ses « pays », se regrouper,
telles étaient les préoccupations de ces hommes nus attendant
les ordres des SS sous l'œil vide de quelques types habillés
d'étranges pyjamas rayés. La
dernière nuit. La dernière nuit passée dans ce
camp j'ai eu peur. Ceux qui se serraient contre moi pour regarder à
travers la fenêtre de la cabane ne disaient rien. Mais je sentais
leur inquiétude. Rien de pire que cette impression d'insécurité
collective… Des camions que nous distinguions à peine descendaient
vers le crématoire. Puis, on entendait des cris, des appels et
quelques coups de feu… Il a fallu s'éloigner de la fenêtre
à cause du chef de chambre et retourner sur les paillasses. On
percevait encore des grondements de moteurs, des ordres lancés… [Dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944, 107 membres du réseau Alliance ont été amenés de Schirmeck au camp de Natzweiler-Struthof. Ils y furent exécutés par les SS dans l'entrée du crématoire, installé sur la dernière plate-forme du camp]. « Songy
! c 'est toi ? » Celui qui m'interpelle me tend un mince
paquet de papiers que je reconnais aussitôt. « Tu sais
que tu n'as pas le droit d'écrire ici ? Fais attention ».
Il me rend les misérables feuillets pliés en quatre. Ce
chef de chambre parle très bien le français. C'est un
ancien des Brigades internationales. Malgré ses coups de gueule
énergiques, il y a quelque chose de franc et juste dans son attitude… Il distribuait presque toujours la soupe. Un jour, après avoir jeté un coup d'œil sur moi, il m'a versé une louche supplémentaire. La seule, l'unique ! En titubant un peu sur des jambes que je n'ose plus regarder, je regagne ma paillasse. Mon voisin de lit me souffle avec une pointe d'humour grondeur dans la voix qu'atténue un regard plein d'indulgence : « Écoutez mon petit Songy, je voudrais vous dire quelque chose : quand vous allez aux cabinets, vous devriez mettre votre pantalon, c'est plus digne ! ». Celui qui me parle ainsi d'un ton affectueux, paternel, se remet lentement comme moi du typhus. Il s'appelle Edmond MICHELET. Il connaît presque tous les Français du camp. Tous le connaissent. Avec lui l'espoir renaît. On franchit les barbelés, on retrouve une société juste et fraternelle. Il parle de dignité. L'univers concentrationnaire s'effondre. Le monde se remet en marche….
La
réponse est inscrite dans nos vies miraculeusement sauvegardées.
Nous avons consacré un peu de nous-même pour que l'essentiel
ne sombre pas dans l'oubli. Il n'y avait pas que la haine et la déchéance
dans les camps. Nous sommes sûrs maintenant que les chemins de
la Rédemption passent par la capacité de l'homme à
poursuivre jusqu'au bout le don de lui-même. Jacques
SONGY - Avril 1985
Ah ! Oh ! Vous êtes resté dans un camp de concentration... Où ? à Dachau ? Mon Dieu ! Et... Vous avez souffert ?... Dites voir mes camarades vous avez souvent entendu ça, n'est ce pas ? Et qu'avez-vous répondu ?... Si on a souffert ? Bien sûr qu'on a souffert ! Vous ne pouvez pas savoir : l'éloignement, les privations, les brutalités, etc... Oui, au début de notre rentrée en France, on sentait bien que toutes ces questions et ces réponses identiques devaient faire partie de notre programme, de notre « révolution ». Et puis on était si heureux, si tranquillement heureux, qu'on se prêtait à tout ; on pouvait bien se permettre de passer pour un modeste héros. Mais jamais on ne provoquait les questions qui, à la longue, commencèrent par nous fatiguer... Parfois, il nous arrivait de changer de trottoir ou de rue parce M. Untel venait d'apparaître et qu'il aurait encore fallut des : Oh ! Oui !, Oh non ! SS ... Brutes, Moral, Courage, Volonté... Cette fois, on commençait par en avoir plein le dos, surtout que, peu à peu, on a discerné les questions idiotes des questions intelligentes... Évidemment on ne peut leur en vouloir aux braves gens de poser des questions. Ils sont bien gentils les gens... Ils ont pensé à nous, qu'ils disent. Mais, qu'est-ce que vous voulez, à la longue on en devient fou... J'aime encore mieux ceux qui éludent le sujet en vous disant tout de go : « Alors mon gars, on a été faire un tour là-bas ? Il fait meilleur ici... Ah ! les salauds ! ». On se serre la main et c'est tout. Le temps passe et, peu à peu, on rentre dans la société, on n'émerge plus. On reprend ses habitudes, des mêmes habitudes de bourgeois, d'ouvrier... On se remet à table à la même place, on reprend la même cuiller, la même fourchette, et on mange de la même manière qu'avant… De temps à autre n'est-ce pas on en reparle bien de ces camps et de leurs horreurs à cause du frère d'Untel qui n'est pas rentré… On en reparle avec des gens dits « biens ». Ah ! Tiens ! Vous avez été déporté… Ah ! Et… pourquoi ? … Ah ! Ah ! avec un sous-entendu : (hein, petit voyou !). On a l'air d'être fautif comme un gosse qui est pris à faire l'école buissonnière. Et puis, il y a justement ce petit mot : « Pourquoi », dit sur un air qui tombe des nues. Comment peut-on avoir été déporté en Allemagne…. Résistance… Ah ! Résistance. C'est vrai, il y avait la Résistance, le maquis, les terroristes, les bureaux de tabac, les fermes assaillies par des « individus armés de mitraillettes »… « toute une jeunesse pervertie »… N'est-ce pas, braves gens qui nous traitaient de bandits ? N'est-ce pas messieurs les grippe-sous de certaine campagne qui réclamez maintenant des dommages-intérêts au camarade mort en Allemagne gratuitement ? Et maintenant, tous ces braves Français qui s'apitoient sur les horreurs, tous ces braves gens qui demandent parfois (Il en existe, si, cherchez bien, j'en connais), avec un peu de doute dans la voix : Mais… Vous avez vraiment souffert ? Enfin je veux dire… « Oui, ça va, on a compris ». Parce qu'on n'est pas « crevé » et que notre joie de vivre s'affiche un peu trop, on se demande si vraiment… Allons donc ! Oh ! après tout… Tout ça, qu'est-ce que ça peut nous faire. Dire que là-bas notre unité de Français avait paru si grande. Tenez, il y a des minutes où je suis sûr que tous les cœurs ont battu avec la même intensité, le même élan… Ces minutes d'angoisse, de désespoir, d'espoir, de joie… Que reste-t-il ? Quand nous retrouvons un camarade de captivité ce sont les mêmes mots qui reviennent aux lèvres… Des impressions, il nous reste des impressions. Et ce ne sont pas des impressions de journaliste ou de reporter. Les journalistes et tous ceux qui ont eu pour mission d'informer de l'horreur des camps ont consciencieusement accompli leur tâche. Tout le monde connaît maintenant l'homme de Buchenwald, Dora ou Dachau. Son crâne paraît difforme tant le corps est étonnamment maigre et ne ressemble plus qu'à un squelette. Dans ses yeux brille la suprême espérance de vie, mais ils reflètent encore la terreur passée. La vision d'horreur des charniers, des fours crématoires, etc… c'est aussi très connu… Enfin personne n'ignore les supplices et les tortures infligés aux détenus. Mais toutes ces visions sont du présent, ce qu'il faudrait connaître c'est l'atmosphère du passé que nous avons vécu. Je vais essayer, à la demande de plusieurs de mes camarades, de reconstituer l'atmosphère du camp de concentration…
Je suis resté neuf mois en Allemagne au camp de Dachau. Neuf mois, c'est presque un minimum pour la déportation. N'oublions pas que certains Résistants furent arrêtés en 1941 et 1942 ; ils sont restés trois ans et quatre ans dans les camps… J'en ai connu un qui sortait apparemment indemne après quatre ans de cette vie d'esclave… Mais, que l'on soit resté neuf mois, un an ou trois ans, les mêmes impressions resteront présentes à notre esprit. Dachau… (en allemand on prononce « Darao ») se trouve à 18 kilomètres au nord de Munich, sur un terrain marécageux. Climat très « germanique », très camp de concentration… : froid intense en hiver, neige, vent. Chaleur lourde et accablante en été. C'est avec des coups de bâton et des hurlements que les SS nous ont accueillis à notre descente de wagon dans la gentille gare fleurie du camp de Dachau… Nous arrivions du camp de Natzveiler. J'étais, comme beaucoup de détenus, épuisé par un début de dysenterie. Il fait beau, si beau, et je suis si malade, si malade que j'ai envie de pleurer. Je me suis raidi parce qu'on est passé devant des gosses qui jouaient à l'entrée du camp avec des mitraillettes en bois et de vrais couteaux… des gosses blonds qui nous ont regardé intensément avec quelque chose de drôle dans les yeux, comme un doute… Certains ont fait le geste de nous lancer des pierres… Et puis ce fut le camp… » Los, los, schnell, ab, ab, Mensch… » Le camp de Dachau est très grand… Il comprend une sorte d'école pour SS avec ateliers, salles de cours, des casernes et le camp des détenus politiques. Nous sommes 35 000 non compris les Kommandos extérieurs. Le camp fait à peu près 600 mètres de long sur 250 de large. Entouré d'une double rangée de barbelés électrifiés, d'un mur, d'un fossé, et même d'une rivière sur un côté, encadré de miradors, l'ensemble est bien gardé et aucune évasion n'est possible… Tous les magasins, cuisines, douches, administrations, etc.… sont regroupés et font face à une place immense, la place d'appel, d'exécution, et aussi de réjouissances puisqu'il y a même des « bois » pour jouer au foot-ball. Perpendiculairement aux magasins et à la place, part une grande rue, la « Strasse », bordée de petits peupliers, et de chaque côté quinze « blocks » numérotés soigneusement se font face. Un Block, c'est une grande cabane en bois et en carton, composée de quatre chambres. Chaque chambre doit contenir cent hommes, mais méprisant toutes les théories de l'espace vital, les SS nous y entassaient à 350 et même 400-300 était un bon minimum… Toute l'organisation du camp est confiée à des détenus… Objectivement, je dois dire qu'elle est remarquablement ordonnée. Les SS vérifient simplement… Les exécutions, les coups de bâtons, les expériences, le four crématoire, tout est très simple… Le «Lageraltester », en traduction littérale le plus vieux dans le camp est en quelque sorte le chef du camp parmi les détenus. Sa fonction est très importante. Il n'a qu'à « gueuler ». Sous ses ordres se trouvent les tout puissants «Capos » ou contre-maîtres chargés de la police, de l'ordre, de la discipline, de la surveillance des Kommandos. Ces gens-là ont le droit de vie ou de mort sur nous. Ils ont plutôt le droit de mort… Parmi les gens puissants, on peut compter les chefs de blocks, les chefs de chambre, les cuisiniers, les boulangers, les coiffeurs, etc. Qui
sont ces hommes ? La plupart du temps des étrangers, des Allemands
détenus, surtout des droits communs, des Polonais, des Russes,
etc… en général tous les plus anciens du camp. Les
Français rarement peuvent se permettre d'aussi belles places… Des « caïds » : en vérité on ne peut trouver d'expression plus juste. Un caïd a ses esclaves, ses favoris, on lui obéit au doigt et à l'œil, sa puissance règne partout. Il se croit l'Élu. Ainsi, ces hommes détenus comme nous pour soi-disant le même idéal de « démocratie » et de « liberté » exercent sur leurs compagnons de misère, un ascendant, non, le mot est trop beau, un despotisme sans égal. Quand on pense que la plupart de ces « types » avaient dans le civil un métier très peu défini et, en tous cas, jamais en rapport avec leur fonction de chef. Du reste, pour assommer des hommes et hurler, il ne faut que des compétences réduites. Dans l'enceinte du camp de Dachau, ceux qui travaillaient pouvaient se classer parmi les privilégiés, car le travail, pour dur qu'il soit, passe comme un dérivatif au cafard et il permet surtout, ou surtout, d'obtenir la sacro-sainte gamelle de « rab ». À noter que les travaux exécutés étaient nécessaires à la marche au camp (cuisine, boulangerie, etc…) et par là ils devenaient moins durs que les travaux forcés des Kommandos extérieurs, où des hommes de 35 à 50 kilos portaient des charges énormes, au pas de gymnastique sous les coups répétés des Capos et des SS. Les détenus qui travaillent sont groupés dans les blocks dits assez curieusement libres ; c'est-à-dire qu'en dehors de leurs heures de travail ils peuvent circuler dans le camp et rêver d'évasion à la vue des sapins mélancoliques et lointains du parc des SS… Tous ces gens se groupent le matin sur la place d'appel, au son d'une douce musique bien allemande et laborieusement rythmée par plusieurs grosses caisses. Oui, c'est curieux n'est ce pas, de la musique partout… De la musique pour le travail, n'oublions pas le slogan : « Le travail dans la joie ». De la musique pour les exécutions, les pendaisons, les scènes d'orgies sanglantes, etc… Un des impondérables de l'esprit de la « race des seigneurs ». Pour les autres, dont je faisais partie, l'appel se tient dans la cour du block – cour consignée. Car nous sommes dans les blocks « fermés », autrement dit, nous restons toute la journée dans une cour de 60 m de long sur 10 de large, les uns sur les autres, puisque notre effectif varie entre 1 200 et 1 500… Une des grosses questions obsédantes et lancinantes entre toutes, c'est la question du couchage, " Schlafen ". Il faut dormir à 200 ou 400 dans l'espace réduit d'une chambre faite pour 100 hommes. Les lits sont superposés sur trois étages. Chaque paillasse fait 90 centimètres. Le problème est complexe. Il ressemble un peu à celui « de l'âge du capitaine connaissant la hauteur du grand mât ». Autre difficulté : sur les 3 ou 400 types de la chambre, on n'en trouve pas 30 qui parlent la même langue. Mais, le seul langage compris intégralement et sans hésitation est celui des coups de bâtons. Il faut se coucher et dormir « Drei für ein Bett », trois par lit, tel est l'ordre… Et allez donc ! On se pousse, on s'engueule, on se groupe par nationalité. On expulse l'intrus qui veut absolument vous prendre pour un matelas alors que soi-même on ne se trouve pas trop mal sur le dos d'un brave copain. « Weg, Ab ! Mensch ! Espèce de... ». J'ai appris pas mal de mots russes, mais ils ne sont pas très distingués... les mots…. Les Russes non plus d'ailleurs. Inévitablement, on en vient aux poings ; quand on perche au troisième étage, l'assaillant se retrouve souvent par terre dans un grand fracas d'os… Donc trois par lit… C'est possible. On dort parfois très bien… Admettons qu'il soit 21 heures 30. Tout le monde est théoriquement entassé pour dormir ; l'atmosphère est irrespirable au troisième étage ; au second, elle est médiocre ; au premier, on crève de froid… Les fenêtres sont grandes ouvertes. On entend encore quelques hurlements, quelques pleurnichements de Russes : « Niet, niet ». Des ronflements sonores et agaçants s'élèvent… Et le combat commence. Le combat de la grosse bête maigre contre la petite bête grasse… On se gratte avec ardeur et constance pour déloger les poux, les puces et les punaises, bestioles compatissantes que nous transportons par centaines en signe de charité pour elles. Les poux dans le fond, c'est gentil, ça ne sent rien, ça se laisse attraper, mais les punaises non, c'est dégoûtant, ça sent et ça pique fort. Mais on peut s'endormir parfois après les formules d'usage : « Vos gueules », « La ferme », « Ruhe », « Halt deine Schaure ». (Je ne sais plus comment on dit ça en Russe)… La nuit ne manque pas de distractions ; il arrive régulièrement qu'un pauvre type atteint de l'éternelle dysenterie se relève rapidement pour courir aux cabinets ; quand il revient ses 30 centimètres de place sont forcément occupés et en les cherchant il ne manque pas de vous écraser la figure avec ses pieds malodorants… D'où jurons, coups de poings. L'ordre est vite rétabli par quelques volées de bâtons énergiques distribuées généreusement au hasard par notre chef de chambre, furieux d'avoir été réveillé par ces « schwein »… Au moment où l'on dort le mieux, c'est-à-dire quand l'abrutissement causé par l'atmosphère est le plus complet, vers cinq heures du matin, des hurlements prolongés nous tirent de notre torpeur. Gare à celui qui baille ou qui chausse lentement les claquettes de bois. Nouveau spectacle navrant : « On m'a volé ma culotte », « Wo, sind meine Schue »; « Salauds ». « Dégueulasses ». Hurlements divers dans diverses langues. Tant bien que mal, plutôt mal que bien à cause du bâton du chef de chambre et de ses acolytes, on s'éjecte hors de la chambre ; avec un peu de chance on peut attraper au passage la porte des cabinets attenant à la chambre et se faire une place sur un des sept sièges qui voisinent côte à côte… Ah ! Vous ne pouvez savoir comme on est bien dans les cabinets… C'est en quelques sorte le salon où l'on cause ; et puis, il fait chaud… On discute librement… On trouve des occasions. On apprend les « bouteillons » (bobards en langage français du camp…). On rencontre des personnalités (Évidemment, puisque tout le monde passe un petit moment par là ). — Tiens, bonjour mon Général ! — Pardon Monseigneur, je ne vous avais pas vu !… Et puis brusquement les hurlements du chef de chambre s'exaspèrent : « Alles raus », « Aber schnell ». « Schwein ». « Antreten », « Alles raus »… Bon ça va, on a compris, tout le monde dehors pour l'appel…
Les privilégiés des cabinets hésitent. La porte des cabinets est obstruée par une foule de types qui tombent les uns sur les autres, bousculés par derrière. La porte de sortie sur la cour du block ressemble à un portillon de métro… « Après tout » se disent ceux des cabinets « on ne peut pas sortir » ... « Attendons » ... Dans le petit vestibule attenant à la sortie, c'est la grosse pagaïe… Le chef de chambre emploie alors les grands moyens… il dispose toujours d'un petit seau dans sa petite chambre personnelle… Vlan !… Les pauvres types du vestibule viennent de se faire rafraîchir. Ils s'ébrouent et sortent vivement en poussant des cris... Les petits malins du cabinet ricanent un peu, pas longtemps. Ils ont droit à une douche aussi. Nouvelle ruée vers la sortie. Même le plus malin, caché derrière la porte ; celui-là, il va s'aplatir dans la boue de la cour et les autres l'engueulent… Maintenant les commandements jaillissent, déchirent les oreilles. On est ahuri dans la glaciale nuit grise de l'aurore ; on se serre, on se tient chaud mutuellement, on grelotte. Chacun met sa gamelle sur sa tête. La gamelle : on ne se sépare jamais de sa gamelle. On l'entretient avec amour : c'est la gamelle qui reçoit la soupe ! Elle nous sert aussi d'oreiller et de vide-poche. Mais on vient d'apporter des bouteillons de soi-disant café… C'est souvent de l'eau chaude au goût douteux d'herbes infusées ; tout le monde se précipite vers les bouteillons… Le sous-chef de chambre qui fait la distribution rétablit gaillardement l'ordre avec quelques coups de louches bien placés. Alors on se met à la queue, et pour changer on s'engueule, on se vole les places, et puis on avale satisfait la mixture tiède… Il y en a qui se rincent les dents avec et qui recrachent par terre. Mais on n'a pas le temps de beaucoup s'appesantir sur la façon d'employer le " café " car : « Antreten » « los », – ça va, ta gueule, pousse pas comme ça, espèce de « fumier ». Quelle brute ! Quoi ? Moi, je t'emmerde, tu comprends ? Merde, « versthen » ? Merde… Mais l'homme chargé de mettre en rang ne comprend pas. Son poing voltige… Il est fort, il mange plusieurs gamelles de soupe, plusieurs rations ; c'est un « Stubedienst », ce qui signifie service de chambre. Gros emploi intéressant. Pour l'instant plusieurs « Stubedienst » se chargent de faire mettre les êtres pâles et abrutis en rang par dix, et par groupe de cent. Comme cela, le SS va très vite pour vérifier si tout l'effectif de la chambre est là. Mais on l'attend le SS ! Et il faut déjà se mettre en rang. Malgré les coups de schlag c'est une chose que les détenus n'ont pas encore bien compris. « Antreten » – rassemblement – Appel. « Antreten » c'est le mot haï du camp – le mot qui fait frémir… Les heures sous le vent, la pluie, la neige, les hommes qui tombent morts, ceux qui ont des crises de folie… " Ein, zwei, drei,… zehn… gut ! Un, deux, trois, quatre... dix, bon ! " Allons, mettez-vous en rang les gars ! — On gèle ; Regarde voir celui-là… Eh ! " komm hier " – idiot, crétin ! ça y est... Il faut recommencer… Le Chef de chambre, bien emmitouflé dans un manteau de fourrure paraît à ce moment sur le pas de la porte. Il promène le regard hautain et dominateur d'un homme habitué à mater des foules. On s'efface devant lui. On se fait petit. Mais, lui s'énerve. Il fait un discours maintenant, traduit dans toutes les langues par un type calé : … « Discipline » … « Ordre » … « Sanctions » toute la journée dehors ! Accueillis par des mouvements divers… toujours la même chose… Malgré tout on se réveille… Et, nous voici en rang. Il rit, maintenant, le chef de chambre, à quelque grosse plaisanterie facile… – Il m'énerve à la fin, ce chef de chambre ; et puis il y a ce type devant moi qui crache tout le temps et se mouche dans ses doigts… On attend. On tape de la semelle ; et puis on se bat les flancs. Admettons qu'on soit en décembre avec un pantalon et une chemise d'été, et une veste sur le dos. Il faut dire que nous ne sommes pas tous en « rayés » ; certains sont affublés des vieux vêtements hétéroclites et râpés. Des vêtements volés un peu partout dans l'Europe. Les vêtements de ceux qui s'en vont par la cheminée du four crématoire, là-bas dans le fond… « Eh, dis donc ! Vise un peu les flammes ; ça donne à fond en ce moment » … dit un petit gars près de moi – « crocher, pas vrai ? » « Tus », voilà le « Dodore » – SS, SS, SS, S… « Achtung » – « Mützen ab ! « — Attention ! Enlevez vos casquettes !... On enlève ses chapeaux, bérets, bonnets, casquettes, képis, calots, haut-de-forme, melon, etc… Le SS passe devant nous et compte d'un air morne et préoccupé. Il va vers le chef de chambre, regarde le cahier d'effectif et s'en va ... Qu'est-ce qu'il « fout » ? « Mützen auf » – (Remettez les casquettes) — Au « poil ». « Bleiben sthen » – (Restez sur place) … Bousculades... L'horizon rougit – le jour se lève – il fait plus froid que tout à l'heure… Et on attend. Ceux des autres chambres en font autant. Nous sommes au block 21-23 ou 25… Vous vous souvenez mes camarades… vraiment il ne fait pas chaud. Quelles têtes nous avons ! Blancs, nez rouges, yeux cernés, rides, joues creuses et avec ça le dos bien rond, les mains dans les poches (surtout les Français !), et quelle allure ! Une veste trop courte, un pantalon trop long, des « claquettes – percées aux pieds… Bon sang ! Voilà une espèce de neige fondue qui dégringole. On voudrait bien rentrer dans la chambre puisqu'on n'a rien à faire de la journée… Mais, on nettoie la chambre ; les « stubedienst », les garçons de chambre, s'y mettent avec ardeur ; ils pensent à leur gamelle de « nachshlag » (rab). Mais, nous, on s'en « fout » bien que la chambre soit propre, il y a toujours autant de vermine. On veut rentrer, on a froid. « Ils vont nous faire crever ». Évidemment… Tout à coup l'ordre retentit : « Toilette ». Et en attendant, on va se laver… Oui – C'est prévu aussi… Il y a un cabinet de « toilette » pour 600 types. Deux pierres circulaires avec pas mal de petits robinets souvent bouchés nous permettent de rapides ablutions – Il faut se laver – Dans certaines chambres, pour obliger les hommes à se laver, des chefs de chambre avaient imaginé de donner un ticket à ceux qui s'étaient lavés et, avec ce ticket, ils pouvaient toucher leur soupe. Ingénieux, n'est-ce pas, Mais, les malins se lavaient deux ou trois fois… Avec un peu de chance, évidemment !!! Inutile de dire que le Monsieur pris à faire ce petit trafic « odieux » recevait par le chef de chambre aux bras musclés vingt-cinq coups de bâton sur le derrière… et je vous garantis que ça fait très mal ! On était sans réaction devant ce triste spectacle. Certains le trouvaient même juste, d'autres en riaient. Celui qui se serait élevé contre cette pratique aurait subi le sort de la victime... Dans notre chambre, on passe par fournées de 15 dans les « toilettes ». Après, on regagne la chambre sur la pointe des pieds pour ne pas éveiller le chef de chambre… Enfin, tranquilles. – On redort doucement, engourdi de froid et de faim… On dort ? On dort – Dormir, oublier, rêver... Hein ! Qu'est-ce qu'il y a ? « Faut chercher ses poux — Ah ! me fous des poux ! » « Alles Laüse suchen ! Lauscontroll ». Contrôle des poux ! Ça consiste à passer « à poil » devant les petits caïds de la chambre, et à leur montrer nos attributs où se cachent souvent les poux, ainsi que la chemise et le caleçon. S'ils trouvent un pou, on se fait engueuler et rappeler rudement à l'ordre par le chef de chambre aux yeux de fou. Parfois, le caleçon et la chemise sont confisqués en attendant d'en recevoir d'autres soi-disant propres… On peut risquer aussi 25 coups de bâton sur le derrière. C'est pourquoi, avant de passer au contrôle on cherche ses poux. On en trouve pas mal. À la fin il y avait trop de poux, alors on ne passait plus au contrôle. On les cherchait seulement... Le chef de chambre, bien réveillé par le contrôle des poux et sans doute écœuré par la triste nudité des pauvres types, crie maintenant à tue-tête : « Alles raus ». Tout le monde dehors ! Quelle « vache » ! Je commençais d'entreprendre une conversation intéressante avec un ambassadeur belge au sujet des causes de la défaite ! Bon. On est dehors ; j'ai raté la porte des cabinets. Oh ! Et puis, du reste, les seaux d'eau voltigent – Alors, on se promène, si on peut, parce qu'avec ses claquettes, il est difficile de marcher. Il pleut un peu. On discute. On essaye de discuter ! Et surtout, on attend la soupe. On a faim. La faim : la première grande misère du camp. La faim horrible… La faim tenace, la faim hallucinante qui réduit l'homme à l'état de bête sauvage. Tous, nous avons connu la faim. Une faim à pleurer, à se tuer, à tuer les autres pour manger leur chair. – La chair humaine, mais oui, pourquoi pas ? Un de mes camarades revenant d'un kommando très dur m'a dit : « J'ai mangé de l'homme, c'était très bon… Tu sais, une bonne tranche du côté de… – Tais-toi. Tu me dégoûtes ». Il m'a regardé, étonné… « Mon vieux, il n'y a pas de mal à ça. - C'étaient des types morts qu'on emmenait au four, alors on repérait les plus gras et puis on taillait ». Ainsi, en 1945, en Europe, berceau de la civilisation, des hommes ont mangé de la chair humaine parce qu'ils avaient faim… De quoi peut-on parler aussi ? De nourriture, de plats, on voit des biftecks, du pain blanc, des frites, du beurre - Assez, assez – « Dis donc, comment est-ce que tu fais une blanquette… ? Tiens ! tu connais ça, c'est une recette norvégienne pour faire une carpe ». Et d'écrire sur de minuscules bouts de papier, et de prendre des adresses. « Moi, je suis restaurateur, tu verras, c'est gentil chez moi. J'ai un jardin. Ah ! mon vieux ces pommes – comme ça ! et, je connais une recette d'ailloli ! ». Ah mince … Et ça continue… Nos médecins nous assuraient pourtant que cette obsession faisait naître une sorte de folie. Il fait trop froid pour parler. Il faut se forcer à trouver des sujets de conversations. Chacun raconte sa vie à son copain, son voisin de lit. On s'efforce de se grouper par province. On vante son pays. Un petit Russe me raconte sa steppe longue, mélancolique, une ferme, des vaches… Un traîneau… et puis un jour SS kommen, und alles Kaput. « Feuer ». Tout est brûlé, ses frères morts, sa mère, sa sœur dans un camp, son père au front… On côtoie toutes nationalités. On s'étonne des réactions, des habitudes des autres peuples. Et la matinée finit bien par passer – malgré le froid et la faim. Certains chantonnent un air triste en tapant des pieds, d'autres, groupés en boule, se bercent jusqu'à ce qu'ils perdent l'équilibre. Les plus résistants marchent de long en large à toute vitesse. Ils débattent souvent de grosses questions religieuses – il y en a qui s'engueulent – enfin, beaucoup sont calés dans un coin et pensent à leur souffrance, et n'osent plus espérer. Si pourtant ! Car on apporte la soupe dans de grands bouteillons, la soupe est distribuée dans le camp comme le lait dans un quartier. On apporte la soupe jusqu'à la chambre. Tout le monde a un sursaut de vie. Les yeux brillent. C'est la soupe, la soupe qui nous permettra de vivre jusqu'au soir. Une haie s'est formée pour voir passer cette soupe. On voudrait savoir si c'est épais ou quoi ? Évidemment, pas mal de pauvres types trop curieux ne perdent pas l'occasion de recevoir quelques bons coups. La soupe est là ! Qu'est-ce qu'on attend pour la servir depuis une heure !… De nouveau, on attend. Toujours on attend. On s'exaspère… Ah ! la distribution va commencer ; « Antreten ». Rassemblement pour la soupe. Forcément. On est soigneusement alignés. Et attention à celui qui cherche à passer deux fois ! 25 coups sur le derrière ! Je me souviens d'un type qui est pris à ce manège. Il reçoit la punition. Le lendemain, il recommençait… Souvent, pendant les distributions de soupe, il pleut, ce qui crée encore un peu plus de pagaïe, chacun cherchant à s'abriter pour manger tranquillement dans un coin, puisque la chambre est consignée. Évidemment, inutile de penser aux cabinets. Des tas de types y semblent déjà bêtement assoupis. Dans le petit vestibule c'est la bousculade. Pourtant… Derrière une porte… « Imbécile, ma soupe ! » Deux types qui se battaient ont failli renverser ma soupe. J'ai eu un frisson à la pensée de ma soupe par terre… Voyons cette soupe ! Je prends ma cuiller en bois et j'avale. « C'est bon », semblent dire tous ces hommes lapant goulûment avec beaucoup de bruit ; c'est bon les rutabagas, les raves, les betteraves, les carottes de cochon ; des tas de « machins » indéfinissables qu'on qualifie de « dégueulasses ». En somme, un litre d'eau, quelquefois chaude, dans laquelle nagent des « machins » et des « trucs ». On est tous plus ou moins « crevards », mais il y a des nuances. Le vrai « crevard » atteint presque la folie. Il « boufferait » volontiers sa gamelle après sa soupe. Il cherche toujours un moyen pour avaler une deuxième soupe. Il regarde intensément tous les autres pour observer une défaillance, un dégoût sur le breuvage. Le « crevard » est humble et vil ; il rampe ; il peut engouffrer tout ce qu'on lui propose. J'en ai vu engloutir quinze litres de soupe en une journée ! … Mais crevard ou pas crevard, on ne se contente pas d'un litre de soupe. Cette soupe nous a ouvert l'appétit. On a encore plus faim après. Peu à peu, quand même la faim se fait moins sentir. Pendant une heure à peine… Mais pendant cette heure on reprend goût à la vie. On parle, on commente les nouvelles. Les nouvelles… Les nouvelles des journaux allemands. Évidemment il faut lire entre les lignes. N'est-ce pas ? Car pour les formules de communiqué comme celles-ci : « dans la région de x, nos troupes ont consolidé leurs positions », « les combats sont en cours », « pertes sérieuses de l'ennemi », on trouve toujours des types pour nous interpréter ça. « Du reste, je le tiens de Untel ! ». « Sans blague, Untel t'a dit ça ! ». « Si c'est Untel qui lui a dit ! ». On reprend espoir, ça va. Ça va ! « Dans un mois ou deux ans au maximum ça sera fini. Ils ne peuvent pas tenir plus longtemps … Avec les bombardements ! » Les pronostics vont leur train surtout parmi les Français. Les autres peuples comme les Russes ou les Polonais semblent se désintéresser de la question… On les dirait fatalistes, indifférents à l'avenir. « Achtung ! SS – Antreten » ! J'étais bien camouflé dans un petit coin des cabinets. Flûte ! Qu'est-ce qu'il veut le SS , « Transport ! transport ! ». Oh ! Mauvais. Tansport : deux ou trois mille types pris au hasard parmi les blocks fermés, qu'on envoie pourrir dans les mines de sel ou de je ne sais quoi ! ça va mal maintenant. Je sors rapidement après une grosse bousculade. - Vite ! « schnell » - « Antreten »! Le SS est là... Il s'énerve, il hurle… Oh ! Oh ! Mauvais. Le chef de chambre déploie sa brutalité… En rang, le regard apeuré, les types attendent et essaient de prendre une attitude misérable, impersonnelle, insignifiante. Le SS passe. Il désigne au hasard des détenus, qu'il faut aligner au mur. Oh ! J'ai eu chaud ! Mais ce n'est pas fini. Ah ! bon sang ! Je n'aime pas ça. Ça y est. Les pauvres gars contre le mur semblent indifférents. Tant mieux pour eux. Le SS part. Les types du mur attendent les instructions. Demain ou après-demain, ils seront changés de blocks, et un jour prochain, ils embarqueront à la gare vers une destination connue seulement par des « on dit » … Mais le chef de chambre à qui le SS a daigné sourire nous fait rentrer… Ah ! de nouveau l'attente horrible de la nourriture. Que faire, tassés dans nos cabanes à lapins ?… Réagir. Ne pas se laisser abattre. On fabrique un jeu de cartes avec les moyens du bord et on joue au bridge avec beaucoup de sérieux. Le paquet de cartes a près de 20 cm de haut. ça ne fait rien. Allons, jouons, oublions, forçons-nous à ne pas imaginer autre chose. Curieux spectacle que de voir ces types maigres, hâves, jouant au bridge avec conviction. Merci mes camarades. Merci de vos fortes paroles d'espoir et de votre esprit de résistance. Merci aux optimistes des camps de concentration. On ne peut se figurer la valeur d'un esprit optimiste dans une telle communauté… Parmi les plaisanteries qui m'ont fait rire et oublier, la plus belle de toutes est un « poisson d'avril » assez original. C'était le premier avril. Un dimanche. Dans une chambre dite d'infirmerie, il mourait en moyenne 3 ou 4 détenus par jour ; les infirmiers étaient chargés de porter les morts à la morgue en attendant le four crématoire. Ce premier avril, deux Français décidèrent de rire un peu. Un des deux fait le mort sur son lit pendant que l'autre prévient l'infirmier ; celui-ci en appelle un autre et tous deux chargent le soi-disant mort sur le brancard, l'enveloppent dans son drap et partent flegmatiquement vers la morgue ; dans le couloir des bâtiments de l'infirmerie, ils croisent des kapos, des SS. Brusquement, sur le brancard, le mort se réveille, s'agite et dit : « Hep là ! pas si vite. Je voudrais bien rentrer dans ma chambre ! ». De stupeur les deux infirmiers lâchent le brancard. L'autre prend sa couverture, s'en drape et passe dignement devant les spectateurs de cette scène complètement ahuris ; les SS furent tellement ébahis qu'ils ne demandèrent pas d'explications. On a beaucoup ri de cette plaisanterie macabre. Avouez qu'il faut un certain moral pour exécuter de pareils poissons d'avril ! ... Mais ... Mais, on a faim. Et le pain vient d'arriver dans la chambre. Toutes les têtes sont fixées vers le « brot » très noir que le chef de chambre coupe sur la table… Il est 16 heures ou 17 heures. On distribue le pain. On attend son tour avec impatience. Enfin, on tient son morceau… Du pain ? Cette chose noire, parfois spongieuse au point qu'en appuyant dessus on pouvait faire suinter de l'eau ! Avec le pain on pouvait certains jours recevoir de la margarine ou du saucisson de chien. Après Noël, les rations furent diminuées et finalement on se contente avec allégresse d'un morceau gros comme une biscotte ! … À partir de ce moment, la hantise de la faim devient inouïe ; le vol se multiplia… Certains types étaient devenus d'une adresse à faire pâlir les meilleurs pickpockets du métro. Le pain était dans la poche. Une petite poussée d'épaule, le temps de se retourner rageur et hargneux pour réagir, le voleur a pris le pain et il disparaît déjà dans la foule hâve et grelottante… Le soir tombe. Appel, de nouveau, appel… De nouveau, dehors, alignés misérablement, tous… avocats, préfets, évêques, princes, ouvriers, paysans… Français, Russes, Polonais, Tchèques, Italiens, Yougoslaves … Attendre la liberté…. La Liberté… Mot magique… Comme il a étrangement résonné dans nos cœurs… Comme il est évocateur !… L'appel est terminé. Enfin, on va dormir. Auparavant, on fait quelques visites dans les autres chambres. Pour glaner quelques nouvelles. Et puis il y a le petit commerce - Les échanges ! Un pull-over contre deux rations de pain – une ration de pain contre cinq cigarettes... Ici les cigarettes donnent les cours de change – Les quelques privilégiés qui reçoivent des colis avec des cigarettes peuvent caresser les plus belles espérances – Nous autres, Français à Dachau sommes devenus très puissants grâce aux quelques colis de la Croix-Rouge contenant des cigarettes, colis reçus vers le mois de mars… Ces colis qu'il nous fallait disputer au couteau contre les autres détenus. Une cigarette… On ne peut se figurer ce que représente de bassesse et de fourberie, ce gramme de tabac. Les fumeurs vendent leur pain, leur ration quotidienne pour quelques grammes de tabac. Pourtant, ils savent que quinze jours plus tard le four crématoire les brûlera… mais, ils veulent fumer pour avoir une impression quelconque. Fumer avec délice, avec liberté, se tourner la tête, se saouler avec une cigarette… S'endormir avec cette sensation, parce que… demain ! Que sera demain ? Et cette nuit ? Peut-être qu'une bombe tombera sur le camp, ou même un avion abattu par la « FLAK ». Toutes les nuits Munich est bombardé. Demain, ce sera la même chose ; il faudra se battre contre la mort, le cafard, l'ennui. Recommencer l'appel ; rester debout sous la neige et la pluie avec 40 de fièvre. Attendre – Combien de temps – Combien de jours – Supporter, réagir. Et puis… Et puis un jour, on ne tient plus ; un appel trop long dans la boue, la bise qui souffle. On se sent perdu au milieu de la foule bestiale, et brusquement, la cabane se met à danser et les types sautent comme des pantins. Et on éprouve un grand dégoût et las, on s'écroule dans la gadoue… On voudrait mourir… Mais non ! Une bonne paire de gifles vous réveille. « Alors, mon vieux, ça ne va pas ? ». « J'en peux plus ». « Penses-tu, ce n'est rien. Allons, du courage !… On va peut-être t'envoyer au Revier ». Revier (infirmerie), mot magique au camp de Dachau. Infirmerie… Finis les appels dans le froid. À l'infirmerie, on peut dormir, rester dans sa paillasse ; même, si on n'est pas soigné, cela ne fait rien, on peut oublier. L'infirmerie de Dachau comprend 8 blocks, hébergeant environ 2 500 malades officiels. Chaque block a sa spécialité : chirurgie, maladie générale, typhus, tuberculose, dysenterie, etc… Organisation comme toujours impeccable, mais ne servant à rien… Le chef ou kapo de l'infirmerie est menuisier de son métier ! ! ! Évidemment l'infirmerie est un vaste terrain d'expérience ; on injecte la malaria pour « voir » les réactions des sujets. J'ai vécu un mois dans la chambre voisine de la malaria. Et pendant un mois également, j'ai croisé tous les jours un docteur allemand qui a déjà été jugé. N'est-ce pas, Docteur S.. ? Combien d'hommes avez-vous détruits avec vos expériences ? Et un jour, je suis rentré à l'infirmerie (après une heure d'attente, dehors, par moins 10 degrés, et en chemise !). J'ai pu prétendre à cette faveur avec 40° de fièvre et une broncho-pneumonie ! Et j'en suis sorti pour y entrer de nouveau, et encore une fois… La dernière fois que je suis rentré, un kapo m'a dit : « Tu verras la fin à l'infirmerie, toi ! » Et il a eu raison… Les plaies horribles, immenses, les abcès qu'on soigne à sec, brutalement, en frottant dessus, en appuyant, les malades qu'on brutalise parce qu'ils crient de douleur, les pieds coupés, les bras coupés, les bras atrophiés, la dysenterie qui vide et réduit à l'état de squelette. Et le typhus, le fameux typhus et ses 15 000 victimes en deux mois…
J'ai connu le typhus, j'ai ressenti l'atroce sensation causée par cette maladie. Et il suffit seulement d'une toute petite piqûre de pou. Comme on en trouvait sur soi, chaque jour 50, en moyenne !!! J'ai vu venir la mort ; un soir, j'ai pensé que je ne verrais pas le jour dans cette chambre où hurlaient pendant des heures et des heures les possédés du typhus, avec leurs 41° de fièvre avant d'expirer dans un râle ; vous savez, un râle comme en font les héros d'un film avant de mourir… Une nuit, un de ces malades s'est levé, nu et brûlant de fièvre ; il est sorti dans le camp où tombaient des rafales de neige, en hurlant qu'il voulait rentrer chez lui. Maîtrisé à grand peine, il fut ramené au Revier... Par miracle, il a survécu ; je l'ai connu. Par moment il lui prenait de grands rires nerveux et des colères rageuses… Et d'autres qui se croyaient chez eux parlaient de leurs femmes et de leurs enfants ... et puis ceux qui appelaient leur mère… Mes pauvres camarades, mes pauvres compagnons de misère… Là-bas, évidemment, on ne s'apitoyait jamais puisqu'on se trouvait sous le même joug… Pourtant… Je me souviens d'une nuit où ce convoi exténué arriva aux douches de l'infirmerie… Je puis assurer qu'en pénétrant dans les douches pour aider à transporter ces restes humains, j'eus l'impression saisissante d'une vision d'Apocalypse… « Les hommes sècheront de frayeur ». Imaginez les cadavres que vous voyez au cinéma, dans les charniers des camps, et donnez-leur un souffle de vie, peut-être aurez-vous cette même impression. Je ne voudrais pas y croire, mais si, c'est vrai, c'est vrai… Ils gisaient pêle-mêle ; la bouche ouverte, leurs ventres étonnamment creux, et ils vivaient. Ils respiraient de la même façon qu'un porc égorgé, et on avait envie de les achever comme on achève un lapin ou une perdrix pour ne pas qu'ils souffrent… Leurs yeux retournés ne regardaient nulle part. On attendait qu'ils meurent. On les reniflait tout près, pour voir s'ils n'allaient pas bientôt mourir ; ils se raccrochaient désespérément… C'est long à mourir, un homme !… Voilà la plus puissante impression d'horreur que j'ai jamais ressentie. Cette impression qui longtemps m'a poursuivi après ma rentrée en France… Parlez-moi de la sentimentalité allemande, messieurs les avocats du procès de Bergen-Belsen !!! [Alors que je décrivais sans concession cette scène douloureuse au souvenir insoutenable, se déroulait en 1945-1946, le procès des gardiens de Bergen-Belsen. Nous étions indignés par les artifices que déployaient la défense pour tenter de justifier l'attitude de ces bourreaux]. Méditation sur les « Impressions » de 1945 J'ai essayé de dépeindre ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Rien de méthodique dans ces « impressions » transcrites aussitôt le retour, un peu comme si on écrivait un billet de confession. Cela aurait été pour moi comme une trahison de me taire. Certes, d'autres témoignages existent, et malheureusement la réalité de l'horreur concentrationnaire ne connaît pas de limites dans le spectaculaire et le morbide. J'imagine parfois qu'il y aurait pu ne pas subsister de traces, car c'était la volonté des chefs nazis, et que les quelques survivants poursuivaient leur existence sans qu'il soit donné du crédit à leur récit. Cela aurait été souffrir et mourir deux fois. D'autres ont pu témoigner. Ce sont nos libérateurs. Quels souvenirs pour ces Américains découvrant au cours de l'assaut victorieux vers le camp, des centaines de cadavres dans les wagons à ciel ouvert du dernier train arrivé en gare de Dachau. Et ce n'était pas fini. Devant le crématoire, dans les cours des Blocks, la même vision se renouvelait ; des cadavres en tas. Comment faire comprendre que nous circulions devant ces morts sans émotions, moins frappés par ces scènes que par la hantise de la faim, du froid ou d'un transport lointain ? Se révolter ? Tenter une ultime vengeance contre les bourreaux quand il n'y a plus rien à faire ? J'ai senti que le sujet venait souvent à l'esprit de ceux qui nous interrogeaient. La barbarie du camp nous prédisposait à parvenir au stade de sous homme, avec toutefois des périodes de répit entretenues par la « petite flamme de l'espérance » qui couvait en chacun de nous. Mais que faire avec 35 ou 40 kilos ? Que tenter ? Ici, l'homme descendu au rang de bête affamée essayait parfois de s'évader de cette condition aux réflexes animales par d'étranges préoccupations, des idées ; comme celles-ci : de quelle manière vais-je couper mon pain ce soir ? Ferai-je deux tartines que je mangerai coup sur coup pour me bourrer ? Ou bien découperai-je des petits morceaux comme le pain béni de la messe que je mâcherai lentement ? L'homme, quelque soit son rang dans la société, que devient-il dans un camp de concentration ? C'est l'homme nu, dépouillé, celui de La Ballade des Pendus de Villon. En fonction des règles impitoyables qui sont appliquées entre ces barbelés, chacun se trouve classé : bon, mauvais, utile, inutile, mais tous finalement sont voués à la déchéance. Parfois, on ne se laisse pas faire… Je revois encore ce Hongrois, professeur à l'Université de Budapest qui m'avait pris, je n'ose plus dire volé, quelque nourriture. Nous partagions le même lit au Revier. Il pleurait de honte lorsqu'il fut découvert. Du coup sa honte m'atteignait profondément. Je n'éprouvais plus de colère, tandis que le chef de chambre, alerté, déployait la sienne avec une violence inouïe, lui qui ne se gênait pas pour détourner journellement des rations… Tony était mon copain. Il avait vécu en Algérie. Quand il racontait ses innombrables histoires et aventures amoureuses on avait une impression de soleil sur une terrasse de bistrot. Pendant que je sombrais dans le typhus nous fûmes séparés. Il réussit à me retrouver. Il franchissait des couloirs interdits pour venir près de moi. Un jour, il m'apporta un morceau de chocolat, produit d'une série d'échanges compliqués. Un autre ami se préoccupait de moi. C'était un Belge. Le cher Abbé Haulet, l'optimisme personnifié. Comment avait-il pu se procurer quelques cuillers de lait en poudre ? Sans doute par le block des prêtres. Il m'en fit profiter. Ce qui donna ce joli mot dans la bouche rieuse de mon conteur d'histoires « Lequel tu aimes le mieux ? Tony au chocolat, au l'abbé au lait ? ». On pourrait croire que j'invente pour embellir, afin de finir sur une note gaie, spirituelle. Mais non. Tout était possible au camp. Des faits insignifiants prenaient une importance considérable, la pire dégradation côtoyait le grandiose. Cependant que s'écroulait le régime nazi, et tandis que l'Allemagne toute entière subissait la dure loi de la défaite, les Camps, les Kommandos fonctionnaient encore jusqu'à l'extrême limite de l'arrivée des Libérateurs. Quelle étrange leçon d'obstination donnaient là les forcenés de la SS entraînant dans leur destruction, à l'heure même de la Libération, des milliers de nos malheureux camarades sur des routes qui aboutissaient à la mort… Devant ces images qui s'éloignent on voudrait se taire, et peut-être seulement méditer. Chacun doit essayer de comprendre. Chacun peut prendre ses responsabilités. Le rire joyeux de mon copain Tony était vraiment plus fort que les hurlements des Kapos et des SS. Je l'entends encore… Voici maintenant le journal que j'ai tenu à Dachau, rarement au jour le jour, et pour cause ! Je l'avais intitulé JOURNAL DE BORD et pour l'introduire j'avais écrit :
15 septembre 1944 Note sur Péguy; à propos du livre Le Porche du Mystère de la deuxième vertu. De belles pages. Des répétitions aussi. Mais que toutes ces pages s'appliquent à notre situation. J'ai découvert Péguy soudain, Péguy si expliqué et si mal compris. Un bonhomme français de la terre française. Tout ce qu'il dit est une prière splendide de saint candide et ingénu. 26 septembre 1944 Revier. En attendant la soupe. Yeux fixes d'affamés. 27 septembre 1944 Après les pansements, calme relatif. On est bien. On attend la soupe. Les conversations s'amorcent doucement. Les Russes, eux, parlent fort. On a fini de penser. On méditera cet après-midi pendant le Mittagsruhe. 29 septembre 1944 Faim terrible. Curieuse impression. Désir de voler du pain comme un mendiant chez le boulanger, du pain blanc, tellement ordinaire, comme il s'en trouve dans toute la France, qui craque quand on le rompt, qui bourre avec sa bonne mie blanche. Le croûton frais qu'on coupe en deux pour faire deux tartines, une de beurre, une de confiture. Et puis un morceau de chocolat, et un autre encore. Ce chocolat qui colle un peu aux doigts, aux dents… Rêve matériel. Folie naissante de la faim… Un peu de volonté et d'adresse. Une part fumante de soupe qui vous tombe du ciel. Un bout de pain offert généreusement. Une bricole par-ci, une autre par-là. Alors fini cet appel intérieur du corps… On a plus que sa ration… un tout petit peu plus seulement. On est content, presque rassasié. Effet physiologique bienfaisant. Je vais lire pour disparaître un instant… Mardi 3 octobre 1944 Octobre
déjà. Rentrée des classes ai-je tout de suite pensé.
Pour nous, rien. C'est plus fort que moi. Je me revois au collège
avec un air faussement blasé dévisageant les quelques
nouveaux habillés de neuf, ou discutant avec importance d'un
gros sujet d'actualité, ou même parlant de travail, de
bouquins. C'est déjà loin et déjà regrettable.
On regrette tout dans la vie… 6 octobre 1944 Depuis deux jours conversations passionnantes. Communisme. Un seul capital : le travail. Nivellement par le bas ! Responsabilité du patron. Beau programme réalisé en Russie… Les communistes français sont, paraît-il, des gens compréhensifs et respectueux des opinions d'autrui. Mais ils obéissent aux mots d'ordre de Moscou sans chercher à savoir si ces mots d'ordre sont salutaires ou non à la nation… C'est le père B… qui répond à M… Ils s'engueulent un peu. J'écoute. J'apprends. Réformes sociales… Conversation avec H… ancien directeur des Chemins de fer d'Indochine. Améliorations des conditions de vie de chaque Français. Exemple de l'ouvrier américain et de son niveau de vie… Une seule catégorie de place au cinéma. Une voiture pour cinq… Révision des bénéfices de guerre… Taxer les fortunes acquises durant la période d'occupation - récupérer quelques milliards pour l'État, afin de revaloriser le franc. Éducation,
enseignement, tout reprendre à la base… 7 octobre 1944 À propos d'une discussion. On parle d'abord de l'abus en général des plaisirs un peu défendus. Tout d'abord le tabac - On passe ensuite aux femmes puis finalement on parle ménage… B… nous laisse entrevoir un tableau de sa petite vie tranquille de bon bourgeois… « Ma femme ne sortait jamais sans moi ou alors avec la demoiselle du 3ème ». Moi je vous dis : « Toutes les femmes qui ont du rouge aux lèvres sont des garces et des pierreuses » etc… Je bondis à ces raisonnements simplistes et d'une remarquable étroitesse d'esprit. C'est pourtant tellement évident de reconnaître une bonne maîtresse de maison d'une coureuse… Non. Mais est-ce que je devrais écrire toutes ces choses-là !… Cela me semble ridicule d'avoir de telles discussions ici… et de les consigner. Je
ne peux pas m'en empêcher et lorsqu'une chose frappe mon esprit
et me fait violemment entrer en discussion, il me semble que j'en suis
tout imprimé… Quelle différence d'éducation entre ce bonhomme et moi ! L'expérience, quand on raconte ces conneries, à quoi ça sert ?… Allons, un peu de charité… puisque je lis un bouquin de 250 pages traitant uniquement de ce sujet ( l'Évangile dans toute la vie ). C'est dimanche. Calme. Mittagsruhe. Relative tranquillité d'esprit malgré cette discussion. Douloureux souvenir de ma chère maman. Je la revois si élégante, si distinguée, si soignée dans tous ces actes, les plus simples. Cette manière discrète qu'elle avait de rouler une tarte, de tourner une sauce en robe de soirée aussi bien qu'en peignoir. Ma chère Maman… Je deviens d'un seul coup si triste… Comme j'aimerais parler de toi avec quelqu'un… Allons courage, je faiblis. Il y a de bons camarades partout… Je vais bientôt quitter ceux du revier. Pourtant je m'y attachais. Il me faudra en retrouver d'autres et recommencer les mêmes discussions avant de devenir un peu intimes… Ainsi va la vie ici… 11 octobre 1944 Ce Français à l'accent étranger qui vient d'arriver près de nous parle plusieurs langues. Caractère assez curieux. Il s'impose, se fait valoir. Il parle des Juifs. Il est calme et précis dans ces discussions avec B…. Pour
lui, il n'y a plus d'étrangers, plus de frontières…
Je suis bien partout. « En Allemagne, je vis comme l'Allemand,
en Belgique comme un Belge… ». 15 octobre 1944 Je suis retourné au block. La transition a été brutale. Le revier est un vrai paradis à côté du block. Malgré tout aucun instant de cafard. La faculté d'adaptation est remarquable. Je rentre de nouveau dans l'ambiance des hurlements, des coups de gamelle avec beaucoup d'indifférence. Je regrette seulement mes profondes méditations du revier. Ici nous sommes forts occupés par le matériel de la vie. Le froid, le couchage compressé - je ne dis pas la faim - ça rentre dans le domaine des choses plus que naturelles. J'ai retrouvé Roger et M. Q… J'ai revu le colonel et des tas de gens - L'abbé m'a surpris hier. J'étais très content. De nouveaux amis et compagnons de misère… Hier soir, visite agréable. Mon voisin de lit, M. de Grammont a reçu la visite d'un pasteur suisse épatant de moral, de simplicité, au courant de tout. Après lui le Prince de Bourbon Parme a fait une apparition « princière ». Lundi 16 octobre 1944 Hier, nous sommes sortis du block pour la première fois après la soupe du soir donnée à 3 heures. Promenade au milieu d'une foule cosmopolite... Il y avait un match de foot : les cuisines contre je ne sais plus qui… de la musique… Un concert aux douches… On s'est fait sortir par un SS à coup de gummi… [ Il s'agissait de kapos et détenus du kommando des cuisines, bien nourris et vêtus presque convenablement - La musique était réservée à ce genre de personnel ainsi qu'aux SS ] J'ai eu des nouvelles de Jacques, André et Dédé. Bonnes nouvelles rassurantes sur leur sort. Je goûte un instant de relative tranquillité perché sur la paillasse. Il est 6 ou 7 heures. Les appels sont plus rapides. Coquart me parle de la plantation des vignes et de leur entretien… J'oubliais. Hier nous avons rencontré, Roger et moi, un bonhomme très curieux. Un petit vieux de 72 ans, en paraissant 50. Il nous a débité des blagues à n'en plus finir. Après il est devenu sérieux. Il nous a montré un sac qu'il portait en bandoulière. « Je suis instituteur. Je suis en train d'écrire l'histoire de France. Oui, je recommence tout. Pour les jeunes... ». Je devine le lever sanglant du soleil à quelques tâches isolées qui s'accrochent aux bords des fenêtres et dans le cou de rares promeneurs. Derrière moi un sourd-muet bégaie péniblement avec forces gestes. Des Russes stubedienst balayent la chambre. Ils engueulent n'importe qui pour n'importe quoi. Est-ce que je peux penser au reste. Oui. À la maison. NON. Pas la peine. C'est trop beau et le contraste fait mal. Je lirai plutôt quelques évangiles et puis on verra… 17 octobre 1944 Matin - Je n'ai pas eu de conversations intéressantes hier. Les Hollandais en général se passionnent pour tout ce qui est du domaine de la cuisine et des spécialités culinaires. Ils prennent aussi des tas d'adresses sur des petits bouts de papier. D'une oreille, j'écoute une conversation animée mais polie, entre le général Garibaldi et deux industriels. Solidarité, union, compréhension émaillent toujours ces sortes de conversations. On discute à perte de vue sur la politique d'après guerre. Tout le monde tombe d'accord pour créer le meilleur des gouvernements. On émet d'excellentes idées, depuis l'ajusteur jusqu'au président du conseil d'administration. Dans la cour, deux vieux Norvégiens font des mouvements de gymnastique depuis une heure. C'est assez curieux. Dimanche 21 octobre 1944 Le froid depuis quelques jours nous envoûte. Je souffre beaucoup plus du froid que de la faim. Même le moral semble atteint. Hier particulièrement, j'ai ressenti violemment ma solitude, mon isolement. Un camarade m'a remonté. C'est un ingénieur, un chrétien. Des paroles d'espoir, de forts conseils ; je côtoie ici l'ouvrier, l'ingénieur, l'industriel, l'homme d'affaires, le préfet, le ministre… toutes les classes sont représentées, tous les grades. Je dois en profiter pour m'instruire, écouter, acquérir des connaissances nouvelles… Ce type est épatant. Je suis de nouveau à flot. Hier, j'ai vu l'abbé ( Haulet ) qui n'avait réussi seulement que ce jour à pénétrer dans le block. Il est étonné de notre dénuement. Je dois le revoir aujourd'hui. Allons du cran. Je parle souvent avec des Hollandais. Après avoir épuisé les spécialités culinaires, notre champ de conversation s'étend au domaine de la littérature. J'espère… Jour des Morts Le temps est d'une tristesse infinie. Mais je suis à peine cafardeux. Ironie. Depuis 8 jours que je suis de nouveau au revier, aujourd'hui est peut-être le seul où j'ai repris tout espoir. Tous ces temps-ci, la maladie aidant, je broyais du noir à plaisir. Je ne pouvais m'empêcher d'évoquer les images chères et douces de la vie familiale et le tragique souvenir de Maman retraversait par instant mon esprit désemparé. Ça va mieux en ce jour gris. Hier, j'ai violemment souffert d'un point de pleurite. Je lis. Lectures spirituelles qui commencent à me faire du bien. 11 novembre 1944 REVIER - Les jours se succèdent, éternellement monotones et sans intérêt. L'espoir vacille par moment. C'est long est le leitmotiv. Je lutte du mieux de ma volonté contre le cafard envahissant. Le neige est tombée. Mélancolie des toits blancs. 11 novembre - jour comme les autres. Peut-être évoquerons-nous des souvenirs ? Ou rien du tout. Le temps passe. On dort, on lit, on discute, on se force de parler avec indifférence sur des sujets divers. Je vois le général Delestraint tous les jours. Nous bavardons. Il est formidable d'idéal, de courage. C'est un chef. Je note cette phrase de Tout l'évangile dans toute la Vie, « contre la tendance de l'élève modèle qui remporte tous les prix de sagesse, une sentence de Foch : " La victoire n'appartient qu'à un commandement avide d'aventures audacieuses et de responsabilités "... ». Je
prie quand le courage me manque et même s'il ne me manque pas. 20 novembre 1944 Je note. Quadregesimo anno : … « contrairement aux plans de la Providence, ce travail destiné au perfectionnement matériel et moral de l'humanité tend à devenir un instrument de dépravation. La matière inerte sort ennoblie de l'atelier, tandis que les hommes s'y corrompent et se dégradent ». 30 novembre 1944 Le colonel m'énerve. Il me demande tous les jours : « Vous avez vu la soupe ? épaisse : hein ». Hier, je lui ai répondu : « On dirait de la merde ». Il m'a fait tout un cours sur la distinction, etc… Ce matin, je lui ai lu un passage du livre de René Benjamin Grandgoujon. … « Ce sont des militaires puants qui ont fait le France telle qu'elle est. Ce n'est pas Voltaire, ni Pascal. … L'Université se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et les provinces ne sont jamais conquises par des intellectuels dyspepsiques, mais par des soudards qui cognent, qui gueulent et qui rotent… ». Pauvre colonel. C'est lui qui gueulait… Bernard était là. C'est un étudiant. La discussion a continué. On a fini par parler de Pétain. 24 décembre 1944 C'est pourtant vrai, mon pauvre vieux. Noël se passe. Oui. Noël et je suis à Dachau. De nouveau au revier. Un sapin décoré de pauvres fanfreluches parvient à peine à me rappeler ces vieux pins champenois que nous décorions, mes frères et moi, dans le salon pendant que maman dressait la table… Alerte… 25 décembre 1944 … comme ces préparatifs étaient joyeux, toute la maison se hâtait vers la fête… Et ces paquets volumineux que les parents tentaient de cacher derrière une armoire… Le soir arrivait. La brume descendait. On rentrait de la ville. On revenait de la Messe dite à 5 heures du soir et le repas commençait tard, joyeux, traditionnel et il se prolongeait dans la nuit. Les Polonais ont chanté autour de l'arbre. J'ai chanté presque par force deux ou trois cantiques. Je pense à Noël de là-bas… Mon père, mes frères et toi chère maman qui nous protège. Verrai-je la fin de ce cauchemar. Noël en Allemagne. Enfant Jésus donne nous du courage. Allons du courage… Pour beaucoup c'est encore un Noël dur… Mais pensons à la France libre qui respire et renaît dans cette nuit superbe. Début janvier 1945 Le vieux est mort. Je lui donnais à manger tous les jours. Il m'aimait bien. Il voulait toujours que je finisse sa soupe. Je le forçais. Il ne pouvait plus lever la tête. Sa dernière soupe, il en a mangé une cuiller. Le chef de chambre m'a engueulé. J'ai laissé la soupe. Il est mort. Robert m'a dit d'aller chercher la gamelle. Merci ! Je lui ai dit. La soupe est restée. Le chef de chambre l'a donnée à un Russe. Robert m'engueule. Je suis malade… Janvier 1945 Hier Robert m'a dit :« Il faut te secouer ». C'est vrai. Je ne tiens pas debout. J'ai donné la moitié de ma soupe à Robert… Le grand type au-dessus va mourir. La dysenterie. … Un prêtre l'a confessé. Il gueulait toujours contre les curés. Il est mort. J'ai la tête qui enfle. Je demande à Robert si c'est vrai. Il hausse les épaules. Je ne peux plus aller tout seul aux cabinets… Robert m'aide. Je sens que ça l'énerve. Le courage… 4 avril 1945 Roger m'a fait appeler au fond de la cour. Derrière la barrière il avait une tête triste… Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle… Il n'a rien dit tout de suite. Jacques !… Non ce n'est pas possible. Je suis stupéfait. Jacques mort ! Où ! Dans le kommando. Mort d'épuisement et de dysenterie avec un moral extraordinaire. Jacques
Degrandcourt. La dernière fois que je l'ai vu, c'était
en septembre. On était tous rassemblés pour un transport.
Près de 2 000. Le SS m'a rejeté des rangs au dernier
moment à cause de l'abcès que j'avais au pied. On s'est
embrassé Jacques. Je me suis traîné dans le block.
Toi Jacques tu dépassais tous les autres. La colonne s'est ébranlée.
Je les ai tous regardé ardemment. Tu m'as fait un grand sourire,
et puis un geste amical. [ Jacques Degrandcourt, mort à Kleingladsbach, Kommando de Dachau, était notre chef du Groupe MELPOMÈNE à Châlons-sur-Marne ]. Mercredi 25 avril 1945 Depuis si longtemps je n'ai pas écrit. N'ai-je pas eu assez d'impressions, d'émotions que j'aurai pu noter avec profit ? Ainsi l'hiver est passé. L'hiver que j'appréhendais tant. Je suis toujours au Revier après maintes tribulations, dans toutes sortes de blocks. Hier, dans le couloir, j'ai vu passer une femme. Elle portait un enfant. Elle était très belle. Elle m'a souri. Je l'ai dit à Bernard. Il m'a répondu « une femme ». C'est tout. Hier, il disait à Tony : « Moi je resterais bien là des années » … Je crois qu'il devient fou. Je n'ai pas échappé au typhus. De ce typhus si répandu, je garde un souvenir hallucinant. La rencontre avec la mort chaque jour. La fièvre. Les rêves fous, la douleur atroce. Le sentiment d'une perte totale de ses forces. Tout a passé, tout n'est plus qu'un cauchemar qu'on se rappelle avec des hochements de tête. Je l'ai échappé belle. L'abrutissement
et la sorte de folie qui font suite sont caractéristiques. Tel
qui était doux devient violent. Tel autre voit la vie en rose. Je
lis le Journal de Gide… « Soifs - Rêves de salles
d'auberge fraîches, demi-obscures, pichets de cidre… ». Dimanche 29 avril 1945 À 17 heures 30, les soldats de la 7ème Armée Américaine pénètrent dans le camp… Depuis deux jours, fusillades et canonnades autour de Dachau, laissaient prévoir leur entrée. … Je suis sur la place presque aussitôt… Enthousiasme indescriptible d'une foule en délire… La Kommandantur est pillée, les portraits de Hitler et de tous les tortionnaires nazis volent en éclat. … Des coups de feu retentissent tout prêt… Ils viennent d'un mirador proche. Nous nous couchons tous… Malgré le drapeau blanc, les SS tirent sur un soldat américain. D'autres soldats répondent par quelques coups de mitraillette. Les SS descendent, les bras en l'air. Ils sont immédiatement fauchés par une rafale… La foule des détenus continue de clamer sa joie intense. Je parcours quelques temps la place, serrant les mains à droite, à gauche… Je rentre au Revier tout bouleversé, les yeux brillants de larmes. On s'embrasse… On acclame le premier soldat américain qui pénètre dans la chambre avec un enthousiasme inouï… 30 avril 1945 Dans la nuit, l'artillerie américaine n'a cessé de se faire entendre. Les SS ont tenté de reprendre le camp. Ils furent repoussés. 1er mai 1945 Grande manifestation sur la place. Premier Mai de liberté. On s'en souviendra. 3 mai 1945 Sur la place, les Français défilent devant les représentants du gouvernement provisoire… On parle de rapatriement. » Fin des notes prises à Dachau.
Note d'octobre 1945 Encore imprégné de l'allégresse de la libération, mais animé toujours d'indignation, et, il faut bien le dire, d'une pointe de révolte, je terminais ces « Impressions » par cette conclusion : Quand je relis les quelques lignes écrites à Dachau, après la libération du camp, il me semble que je voudrais revivre ces heures. Je voudrais retrouver cette immense émotion de liberté, de bonheur, de rêve réalisé, qui nous a tous étreints, là-bas, au moment splendide de la libération. Ces balles qui sifflaient, ces clameurs, et puis, ce soulagement de la délivrance. Le premier Américain que j'a approché, quelques heures après la libération, il m'a semblé grand, immense, je croyais voir en lui, un être surnaturel, un personnage fabuleux, sorti d'un conte de fées… Je voudrais revoir ces visages lumineux d'hommes libres, avec leurs yeux brillants de larmes, cet enthousiasme, ces hurlements de joie, ces mains tremblantes d'émotion, qui se tendaient vers les libérateurs, émus aussi ; les mains de ceux qui avaient pendant dix ans, oui dix ans, vécu la plus formidable aventure de toute leur vie, et même de la vie de centaines de générations. Tous ces hommes libres l'ont échappé belle. Les 3 500 hommes libres du camp de Dachau. Et pourtant Himmler avait bien donné l'ordre formel, le 25 avril 1945, d'exterminer le camp. Mais son ordre a été intercepté à Munich, par les rescapés d'un convoi que les SS avaient évacués de Dachau et qu'ils avaient mitraillés sur la route. Ces rescapés (détenus allemands pour la plupart) ont réussi à se rendre maîtres momentanément de Munich, et ils ont pu joindre les armées américaines qui, en apprenant l'état lamentable du camp, ont forcé la marche sur Dachau… Grâce
à un de nos camarades troyens, évadé aux premières
heures de la libération, et retenu au camp, 15 jours après
avec un camion, une trentaine de champenois dont je faisais partie,
purent prendre le chemin du retour, le 17 Mai… Un jour, nous sommes arrivés à Kehl ; nous avons lu ces simples mots :
Trop d'émotion nous a étreints, pour pleurer. Ce pays de la Liberté, vraiment à ce moment, nous l'avons aimé de tout notre cœur et de toutes nos forces, sans rien dire. Et, nous avons revu les lieux chers à notre cœur, nos foyers, notre ville, notre village. Nous avons reconnu nos maquis, dans les bois, calmes, déserts, nos lieux de douleurs, de tortures… Tous libres, libres de l'Allemand. Pensez à ceux qui ne reverront pas les lieux aimés, et qui, pourtant avaient espéré. Pensez bien que « les jeunes gens sans réflexion » qui ont organisé des manifestations dans les villages des alentours, le 14 juillet 1944, pensez qu'ils n'étaient pas fous, pensez même qu'il en fallait des fous pour se battre clandestinement — pensez qu'il était plus simple d'écouter tranquillement la radio de Londres dans son fauteuil, que de coucher dans les bois avec l'impression qu'une nuit, un détachement de SS viendrait vous mitrailler. Pensez aussi, Messieurs les « FFI du 32 Août », avec vos mitraillettes, à ne pas trop vous vanter !… Ne croyez pas à quelque rancune. Ces lignes ne sont pas écrites sous le coup d'une mauvaise humeur de rapatrié qui trouve que ça ne marche pas droit. C'est encore une fois « Quelques impressions », et qui sont, j'en suis persuadé, très collectives.
« Les jeunes gens sans réflexion » c'étaient nous, bien sûr, c'est-à-dire ceux du Groupe Melpomène, y compris les membres arrêtés et déportés. Parmi eux figurait Jacques Degrandcourt, chef du groupe, cité plus haut. J'avais été profondément choqué à l'époque d'entendre des critiques sur la Résistance, les inévitables sous-entendus sur notre action et sur la pureté de nos intentions. Ce n'est pas parce que quarante ans ont passé que mon jugement et les « émotions » de mes vingt ans se sont modifiés. Je me sens solidaire de tout, sans restriction. À un moment de notre vie nous avons réveillé la France en fanfare. On y croyait. On y croit encore. Avec plus de gravité seulement, parce que les combats pour la liberté et le respect de la dignité humaine ne sont jamais terminés. Jacques
SONGY |
||||