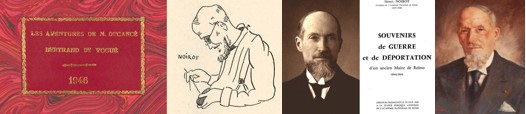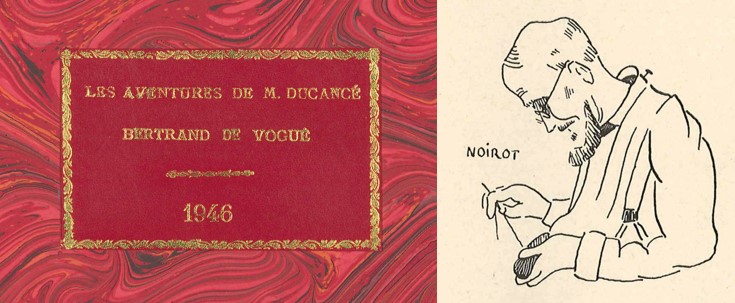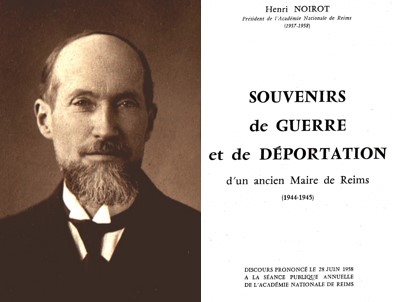|
" Souvenirs
de guerre et de déportation
d'un ancien Maire de Reims 1944-1945 "
par Henti NOIROT
Discours
prononcé le 28 juin 1958 à la séance publique annuelle de l'Académie nationale
de Reims
__________________________________________________________________________________________________________
Henri NOIROT (1879-1972)
in Jean-Pierre et Jocelyne Husson,
La Résistance dans La Marne, dvd-rom,
AERI-Fondation de la Résistance et CRDP de Reims, 2013
Henri Noirot est né le 1er mars 1879 à Reims.
Industriel à Reims, juge au tribunal de commerce, il préside le conseil d’administration du Nord-Est, journal de la droite républicaine, seul quotidien avec L’Éclaireur de l’Est qui est autorisé à paraître sous contrôle allemand pendant l’Occupation.
Conseiller municipal de Reims élu sur la liste Marchandeau en 1935, maintenu et promu adjoint en 1941 par le gouvernement de Vichy, il est appelé au poste de maire de Reims en août 1943 à la suite de la démission de Joseph Bouvier.
Jugé trop mou par les autorités allemandes, il est arrêté le 15 juin 1944 à Reims avec six de ses adjoints et d’autres notables rémois.
Incarcéré à Châlons-sur-Marne, puis transféré à Compiègne, il est déporté le 28 juillet 1944 à Neuengamme (matricule 39 327) comme « personnalité-otage », et détenu dans le block des « proéminents ». Membre de l’« Université de Neuengamme » créée par Bertrand de Vogüé, il y donne une conférence sur " La laine et la flanelle de Reims ". Le 12 avril 1945, il est transféré à Theresienstadt, puis le 30 avril à Brezani, où il est libéré le 8 mai 1945. Il est rapatrié en France par avion, accueilli à Paris à l’Hôtel Lutétia.
Il rentre à Reims le 18 mai 1945.
Il figure dans la galerie de dessins publiés en 1946 par Bertrand de Vogüé dans Les aventures de M. Ducancé, ouvrage illustré relatant la vie à Neuengamme des personnalités-otages qui y ont été déportées en juillet 1944.
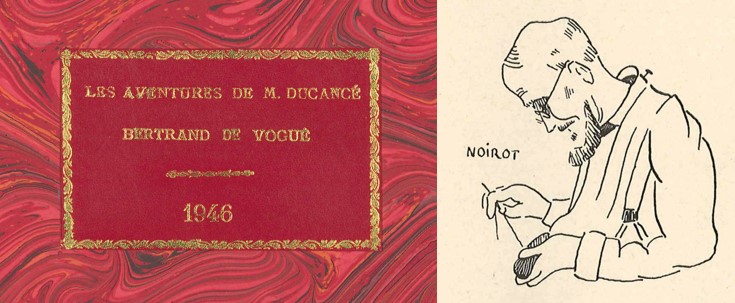
Son portrait peint par Stéphane Lamarche en 1956, figure dans la galerie des maires de l’Hôtel de Ville de Reims

En 1958, Henri Noirot a présenté ses souvenirs de déportation à l’Académie nationale de Reims qu’il présidait
_____________________________________________________________________________________________
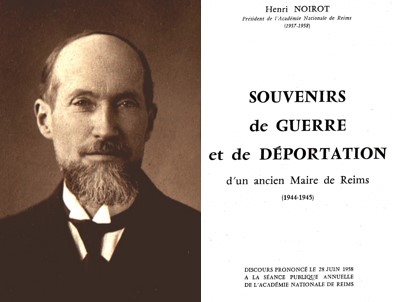
Avant-propos Reims pendant la guerre 1939-1945
Comme
toutes les ville de France, Reims a connu, sous l'occupation allemande,
des journées d'épreuves et de détresse : couvre-feu,
camouflage des lumières, séjours prolongés dans
les caves, en cas de bombardements ou de survol d'avions.
À
cela, il faut ajouter les rigueurs du rationnement alimentaire, les
cartes de pain, viande, sucre, beurre, huile, pommes de terre ; le
régime des rutabagas ; la pénurie de vêtements,
linge, chaussures… Ce sont de pénibles souvenirs, un peu
oubliés aujourd'hui.
Mais
les habitants souffrirent moralement davantage encore, dans une atmosphère
d'oppression et de terreur : un mot malheureux, une dénonciation
même injustifiée, suffisaient pour motiver un séjour
en prison ; la menace du travail obligatoire, en Allemagne, pesait
sur tous, hommes et femmes, jeunes filles même et, à
partir de 1943, les arrestations se multiplièrent.
La
tâche de la municipalité a été particulièrement
difficile, au cours de cette période ; dès 1940, des
fils téléphoniques ayant été coupés,
la ville avait dû fournir cent otages, et les membres du conseil
municipal (à l'exception d'un seul) s'étaient
inscrits en tête de la liste.
Très
vite, l'autorité allemande réquisitionna tout ce qui
lui était nécessaire : immeubles pour installer ses
bureaux, logements pour les officiers, bicyclettes et automobiles
privées, camions et la plupart des autobus. Le bureau des réquisitions,
à l'Hôtel de Ville, eut à soutenir des luttes
homériques, pour conserver à l'agriculture et au commerce
les chevaux, voitures et véhicules indispensables et assurer
à la population un ravitaillement régulier.
Par
la suite, il fallut donner satisfaction aux exigences les plus variées
; c'est ainsi qu'un jour, la municipalité dût fournir
des couverts d'argent pour la réception d'un général.
La
veille même de mon arrestation, le chef de la Kommandantur m'avait
demandé de lui envoyer des tableaux du musée pour orner
son bureau. En vain, je lui expliquai que je n'avais pas le droit
de disposer d'objets appartenant à la Ville ; il me déclara
qu'il passerait les prendre lui-même, le lendemain. J'eus l'heureuse
idée de convoquer aussitôt le conservateur du musée
pour lui dire de préparer d'urgence, dans une petite salle,
des toiles sans grande valeur, mais variées comme dimension
et comme genre.
Un
autre jour, au moment de la réquisition des objets en cuivre,
il manifesta son intention de prendre toutes les poignées de
porte de l'Hôtel de Ville.
Successivement,
l'ennemi avait enlevé plusieurs statues de bronze, les bustes
de Charles Arnould, Jantzy, Docteur Jolicoeur, Ambroise Petit, le
monument aux morts de l'armée noire, le génie ailé
de la fontaine Subé, ne laissant sur place que Colbert, Jeanne
d'Arc, Louis XV et Drouet d'Erlon. Ce dernier faillit subir le même
sort ; malgré le peu de valeur artistique de la statue, la
municipalité mit un point d'honneur à le sauver, en
alléguant la mauvaise impression que produirait cet enlèvement
sur la population, très attachée à ses gloires
locales. Après des pourparlers, l'autorité allemande
alla jusqu'à proposer de fournir, en échange, une statue
de pierre ; en traînant en longueur, on gagna la libération.
Il en fut de même pour les dessins de Kranach, au musée,
qui sont des pièces uniques d'une valeur inestimable et que
les Allemands voulaient nous ravir, offrant d'ailleurs, en contre
partie, des toiles de prix.
On
manquait de charbon à cette époque – sauf dans
les bureaux allemands toujours approvisionnés et parfaitement
chauffés – À l'Hôtel de Ville il était
impossible d'alimenter le chauffage central ; dans le cabinet du maire
et des adjoints, on avait installé des poêles qui brûlaient
quelques heures par jour et dont le tuyau traversait un carreau dans
le haut des fenêtres, ce qui donnait à cet édifice
un air misérable, contrastant singulièrement avec sa
majestueuse architecture.
La
municipalité, afin d'aider les Rémois à se chauffer,
se porta acquéreur de coupes de bois qu'elle fit exploiter,
pour en donner aux ménages pauvres. Afin
d'améliorer l'alimentation, elle décida d'utiliser des
terrains disponibles, aux environs immédiats de la ville, pour
des cultures municipales, où furent employés des chômeurs
; elle développa les cantines scolaires et créa une
porcherie municipale.
Une
installation fut montée, pour assainir, par la chaleur, les
viandes refusées par le service d'hygiène ; cette mesure
qui permettait de les vendre à des prix très bas, sans
danger pour la santé publique, ne prit d'ailleurs pas un grand
développement.
La
municipalité édicta encore d'autres mesures d'assistance
: secours travail aux femmes acceptant de travailler à la confection
de flanelles pour l'Intendance, aide aux mobilisés (colis),
foyer des femmes enceintes, ouvroir municipal, centre d'accueil d'enfants
à Villers-Allerand et avenue d'Épernay.
Depuis
l'institution du STO ( Service du travail obligatoire, qui réquisitionnait
des ouvriers pour les envoyer travailler en Allemagne ), il était
interdit de délivrer des cartes d'alimentation aux réfractaires
; la municipalité les dirigeait discrètement sur la
Sous-Préfecture qui les faisait engager au chemin de fer, sous
une fausse identité.
Au
début de 1944, la Kommandantur commença à exiger,
en outre, la fourniture de travailleurs civils, pour exécuter
des travaux de terrassement et de déblaiement, en particulier,
pour réparer les voies ferrées. Ce fut l'occasion de
nombreuses discussions avec l'autorité allemande. Celle-ci
avait commencé par réquisitionner les ouvriers mis en
chômage par la fermeture de plusieurs usines ; mais, en raison
des risques courus, ( l'aviation anglaise bombardait fréquemment
la ligne et les dépôts de locomotives ) la municipalité
trouva plus équitable d'établir une liste générale
de tous les hommes, par classe de mobilisation ; ainsi, employés,
fonctionnaires, ouvriers, oisifs, carrières libérales
participèrent, à raison de 1 000 par jour, à
tour de rôle, à ce travail particulièrement pénible,
à partir d'avril-mai, en raison de la grande chaleur. Le maire
et les adjoints visitèrent, à plusieurs reprises, les
chantiers et organisèrent des distributions d'eau, pour permettre
aux travailleurs de se désaltérer.
Dès
le début de ces réquisitions, il avait été
possible de faire admettre un service de visite préalable ;
les médecins se montraient naturellement très compréhensifs
et malgré les 1 200 désignés quotidiennement,
le chiffre imposé de 1 000 était loin d'être atteint,
ce qui attirait des réclamations acerbes. La Préfecture
avait exempté la police, les pompiers, les ponts et chaussées,
les boulangers ; de son côté, la Kommandantur s'attribuait
le droit d'exonérer certaines catégories : services
publics, électricité, gaz, usines travaillant pour l'armée
allemande, chauffeurs, garagistes ou simplement telle ou telle « persona
grata ». C'est ainsi que le secrétaire de la milice,
ayant sollicité une exemption, sous prétexte qu'il était
seul dans son service et ayant essuyé un refus catégorique
du maire, s'adressa aux Allemands qui firent parvenir à l'Hôtel
de Ville une note de service, prescrivant de le rayer de la liste.
Au
fur et à mesure que les avions alliés multipliaient
leurs raids, l'armée allemande devenait plus exigeante ; il
fallut fournir, de jour et de nuit, des sentinelles, le long des voies
ferrées.
Un
jour, une corvée ayant été désignée
pour combler des trous d'obus sur le terrain d'aviation de Courcy,
je protestai contre l'emploi de main d'œuvre civile sur un terrain
miliaire. En l'absence du chef de la Kommandantur, je me mis en rapport
avec son adjoint qui me promit une réponse pour le soir même
; j'en pris acte, en lui déclarant que je suspendais le service,
en attendant une décision. Comme elle ne vint pas, je m'abstins
d'envoyer les travailleurs, le lendemain matin. Mais un ordre d'arrestation
fut lancé contre le maire de Reims et ne fut rapporté
que sur l'intervention de la Préfecture qui donna l'ordre de
faire partir la corvée.
En
octobre 1943, la municipalité avait fait évacuer les
locaux du groupe scolaire de la Maison Blanche, en prévision
de bombardements anglais ; elle avait réinstallé les
écoles de filles et de garçons au patronage de Saint-Louis
que l'abbé Donnay avait offert pour les loger, ainsi que dans
des locaux municipaux et à la Cité-Jardin de l'Office
d'habitations à bon marché.
En
1944, les services municipaux procédèrent méthodiquement
à la détermination des zones dangereuses et des mesures
furent prises pour évacuer, d'abord les écoles, puis
tous les habitants et les transférer dans des maisons inoccupées
d'autres quartiers. Un recensement fut fait des locaux disponibles
; d'accord avec la Sous-Préfecture, les conseillers municipaux
firent des tournées, dans les localités voisines, pour
y rechercher les possibilités de logement.
Enfin
un plan fut établi en prévision de la libération.
À la fin d'avril 1944, la municipalité avait commencé
à étudier le transfert du Collège moderne et
technique, en raison du voisinage du pont de Laon, lorsque se produisit
le premier bombardement de la ville (1er mai). Visant
certainement le dépôt de locomotives, l'aviation anglaise
lâcha ses bombes sur le quartier ouvrier du Maroc, heureusement
à peu près désert (c'était un dimanche),
causant vingt-cinq morts et de nombreux blessés. En entendant
le ronronnement des moteurs, je montai dans ma chambre, au premier
étage : l'effet était saisissant : on eût dit
que, du haut des nuages, se déversaient des tombereaux de décombres,
soulevant une poussière épaisse : quelques secondes
après, un terrifiant roulement de tonnerre ébranlait
l'atmosphère.
Je
me rendis aussitôt sur les lieux du sinistre, où arrivait
déjà la Croix-Rouge. Le spectacle était celui
d'un paysage dévasté par un cyclone : la plupart des
maisons, de construction légère, effondrées,
un monceau de décombres, des entonnoirs, des enchevêtrements
de poutres… Les secours furent immédiatement organisés,
avec le concours de la police. Les sauveteurs évacuèrent
d'abord les blessés, puis se mirent à la recherche et
au transport des cadavres, cependant que quelques bombes continuaient
encore à exploser, mais sans faire de nouvelles victimes.
Le
maire, dans la séance du conseil municipal du 4 mai, évoqua
l'horreur de cette journée et fit voter une résolution
mettant les frais des obsèques à la charge de la Ville.
Quelques
jours plus tard, un bombardement eut lieu sur le faubourg de Laon.
Des infirmières et des jeunes gens du Centre Belin qui, dès
les premiers moments, étaient venus offrir leurs services,
se réfugièrent, à l'arrivée d'une seconde
vague d'avions, dans un abri de la Place Luton, où ils furent
tous tués, à l'exception d'un seul, une bombe ayant
éclaté à l'entrée de l'abri. Leurs corps
furent déposés à l'église Saint-Maurice,
où une foule émue put défiler devant eux (30
mai 1944).
Les
Allemands devenaient nerveux. Le débarquement anglais (1er
juin) [sic], fut suivi de nombreuses arrestations
: M. Bertrand de Mun, président honoraire de la Chambre de
Commerce, qui fut relâché peu après, Jacques Détré
qui fut torturé au siège de la Gestapo, rue Jeanne d'Arc
et succomba aux brutalités qu'il y subit, pour avoir héroïquement
refusé de parler, le docteur Quentin, Jean Droit avoué,
et d'autres.
Peut
être, les groupements germanophiles, en particulier la milice,
sont-ils à l'origine de ces arrestations et il semble bien
que ce soit sur leurs indications que fut opérée, à
Reims, l'arrestation du maire, des adjoints et de diverses personnalités,
le 15 juin.
La
même opération avait déjà été
faite, ou se fit, par la suite, dans les départements où
les Gestapos locales choisirent leurs victimes, suivant leur inspiration,
dans toutes les classes de la société : maires, préfets,
industriels, ecclésiastiques, ouvriers communistes et militants
syndicalistes ; on peut supposer qu'elles poursuivaient le but de
mettre hors d'état de nuire toutes les personnes susceptibles
d'apporter leur aide à l'envahisseur, ou de se procurer des
otages.
Il
est à présumer que le gouvernement français intervint
pour faire cesser ses rafles, car elles ne se poursuivirent pas ;
mais les trois cent cinquante personnes déjà arrêtées
ne furent pas relâchées et, après un séjour
plus ou moins prolongé en prison et au camp de Compiègne,
furent déportées en Allemagne, au camp de Neuengamme,
près d'Hambourg où elles formèrent notre groupe
de déportés politiques ou Sonderhäftlinge
(prisonniers spéciaux).

L'arrestation
de la municipalité
Le
15 juin 1944, à 7 heures et demie du matin. On sonne chez moi,
je vais ouvrir et me trouve nez à nez avec un sous-officier
allemand et, derrière lui, deux soldats armés de mitraillettes
; une automobile attend. Je demande le temps nécessaire pour
m'habiller et déjeuner ; il consent, mais, dès lors,
ne me quitte plus d'une semelle et m'accompagne jusque dans mon cabinet
de toilette. Il ne m'autorise pas à téléphoner
à la mairie.
Arrivé
à la Gestapo, rue Jeanne d'Arc, je retrouve un certain nombre
de Rémois qui ont été arrêtés au
saut du lit ou à leur bureau : Mme Douce, présidente
de la Croix-Rouge ; Mme Krug, présidente du Retour à
Reims ; MM. Hodin, Tixier, Jardelle, Huet, de Vogüé,
Clignet, adjoints au maire ; Denieuil, procureur de la République
: Gény, secrétaire général de la Sous-Préfecture
; Réville, président de la Chambre de Commerce ; Faivre,
contrôleur principal des Contributions Indirectes ; Thiébault,
ingénieur des Ponts et Chaussées ; Drapier, directeur
de la SPDE. Quelques autres personnes qui furent relâchées
au bout de quelques jours (en même temps que Mmes Douce et
Krug, MM Hodin et Tixier).
Nous
sommes soumis à un bref interrogatoire d'identité, puis
on nous autorise à téléphoner à nos familles
pour demander des vivres et du linge. Au début de l'après-midi,
un autocar vient nous prendre et nous dépose à la prison
de Châlons ; celle de Reims était en partie détruite
par des obus. Sans doute, avions-nous été recommandés,
car on nous laisse nos papiers, nos vivres et notre linge, nous prenant
seulement les bouteilles de vin ou alcool.
Une
lourde porte, à double verrou, munie d'un guichet, se referme
sur nous ; nous sommes dix dans une cellule de cinq mètres
de long sur trois de large, éclairée par une étroite
fenêtre, garnie de barreaux et percée à 2 m 50
au-dessus du sol.
Des
couchettes à double étage, munies de paillasses et d'une
couverture ; un lavabo, une table, deux chaises, un seau hygiénique
complètent le mobilier.
Nous
ne quittons guère notre prison que pour faire deux courtes
promenades, dans une cour, matin et soir. Le moral reste bon néanmoins
; nous avons apporté des livres, des cartes, un jeu de dames
et nous passons de longues heures, à échanger nos idées
et nos pronostics.
Régime
: le matin une sorte de viandox, à midi soupe aux pois (rarement
aux haricots et nouilles), le soir soupe aux pommes de terre, servie
dans les gamelles de l'armée ; pain en quantité suffisante.
Notre menu est largement corsé par les colis de la Croix Rouge,
par nos provisions et par celles que, dès le premier jour,
nos amis de Reims et de Châlons nous apportent ou nous envoient
: conserves, fromages, fruits ; malgré l'interdiction formelle,
nous nous procurons même du vin, grâce à la complicité
d'un gardien très corruptible ; nous profitons de cette abondance
pour ravitailler nos voisins qui sont de corvée, pour nous
apporter la soupe.
Deux
détenus français de droit commun qui ont su s'assurer
des intelligences dans la place, ont la clef de notre guichet ; ils
peuvent sortir de la prison, mettent nos lettres à la poste
et nous apportent notre courrier, arrivé dans un café
voisin, des cigarettes, du papier, du vin…
Le
soir, des sentinelles font des rondes ; et jettent, en passant, un
coup d'œil au travers du judas ; elles échangent volontiers
quelques mots avec nous, mendient, sans vergogne des cigarettes et
du pain et nous disent leur lassitude de la guerre.
Bien
vite, des visites s'organisent ; les femmes, enfants et amis peuvent
venir nous voir, au prix d'un voyage fatigant, grâce à
l'amabilité de la Croix-Rouge, de la Cie du Gaz, de Mignot
qui fournissent des camions. Ce sont, malheureusement, de courtes
visites de quelques minutes, dans un couloir ; nous apprenons ainsi
que le conseil municipal s'est réuni et a nommé 6 conseillers
délégués pour remplacer le maire et les adjoints.
Le
22, Reims est bombardée ; nous l'apprenons le lendemain ; c'est
une journée de cafard, nous savons qu'il y a des victimes et
nous ressentons douloureusement l'éloignement de nos familles
qui n'ont pas eu le réconfort de notre présence. J'ai
été informé, par la suite, qu'une bombe était
tombée sur le monument aux Morts.
Le
5 juillet, un sous-officier vient nous interroger ; il nous pose des
questions fantaisistes, nous demande si nous sommes francs-maçons,
germanophobes, anglophiles. Il assure certains d'entre nous que nous
n'irons pas en Allemagne et que nous serons relâchés,
dès que les Anglais auront été rejetés
à la mer (!)
Le
bruit avait couru de notre prochain départ ; aussi avions-nous
partagé nos vivres et préparé nos paquetages
; nous eûmes la dernière satisfaction de pouvoir nous
offrir, le 14, en l'honneur de la fête nationale, un déjeuner
de gala arrosé de Clicquot. Notre gardien avait fermé
les yeux. Bref, cette prison était presque un paradis ; mais
nous n'allions pas tarder à connaître l'enfer.
À
14 heures, les cars nous chargent dans la cour, avec d'autres détenus
; nos bagages sont entassés sur le toit ; aux fenêtres
de la cuisine, des femmes pleurent et font des signes d'adieu à
un vieux paysan qui monte à côté de nous. Le terme
de notre voyage était le camp de Royallieu, à Compiègne.

Le camp de Royallieu
Nous
sommes une cinquantaine, au camp C, une ancienne caserne, en rez-de-chaussée,
donnant sur la campagne et entourée de fils barbelés,
avec des miradors sur les côtés (sorte d'observatoires) où les sentinelles veillent pour éviter toute évasion.
Il est interdit de sortir des bâtiments après la nuit
tombée. On nous avertit que nous devons saluer, non seulement
les officiers et sous-officiers mais même les simples soldats
allemands et répondre à l'appel du soir. Nous sommes
fouillés et on nous prend nos papiers d'identité, couteaux,
billets de banque sauf 600 francs.
Nous
pouvons continuer à recevoir des visites, en présence
d'un interprète ; mais le voyage est pénible pour les
familles, faute de moyens de transport faciles.
Un
de nos compagnons est Monseigneur Théas, l'actuel [en
1958] évêque de Lourdes, qui ne sera pas déporté,
les Allemands ayant sans doute redouté que sa forte personnalité
ne suscite des mouvements de révolte en Allemagne.
À
côté de nous, se trouve le camp A où sont rassemblés
les détenus qui ont été arrêtés
isolément et dont le régime ressemble au nôtre
: une sorte de vie de caserne.
Toutes
les semaines, un contingent de 2 000, environ, part pour l'Allemagne.
Une
huitaine de jours après, nous apprenons l'avance des Anglais,
en France ; et après nous avoir fait passer aux douches, on
nous distribue du pain et du saucisson pour trois jours et on nous
emmène en gare.

Le voyage de Compiègne à Neuengamme
Les
détenus du camp A sont déjà sur le quai ; ils
sont déshabillés entièrement, à l'exception
de leur chemise et de leur caleçon, pour rendre plus difficile
une évasion ; leurs vêtements sont chargés dans
un wagon spécial ; ce traitement nous est épargné
et nous conservons nos costumes, pour prendre place dans le wagon
à bestiaux qui sera notre cantonnement pendant trois nuits
et deux jours.
Nous
sommes partis 40 du camp C ; nous avons donc pu nous étendre
la nuit, sur un peu de paille, serrés les uns contre les autres,
chacun ayant, dans l'estomac, les pieds de son voisin d'en face ;
dans un coin, une cruche d'eau ; dans un autre, une tinette qui sera
largement utilisée, certains d'entre-nous ayant la dysenterie
et qui, secouée par les cahots, éclabousse les voisins,
malgré la paille dont elle est garnie d'un liquide peu odorant.
Mais
nos camarades du camp A sont parfois entassés à 70 par
wagon ; nous devons, par comparaison, nous trouver presque heureux.
Le
temps est couvert, nous éviterons donc la chaleur torride qui
serait intolérable, dans ces wagons fermés et cadenassés
; nous n'avons d'air que par la petite lucarne du haut, garnie de
fil de fer barbelé.
Le
convoi démarre à la nuit, avec des arrêts fréquents
; le lendemain, nous sommes debout de bonne heure, un peu courbaturés
et constatons que nous approchons de Reims. À la faveur d'un
court arrêt, nous pouvons échanger, à travers
la lucarne, quelques mots avec le sous-chef de gare et le secrétaire,
M. Renard ; nous leur demandons de prévenir nos familles mais
bientôt nous repartons et, avec des larmes dans les yeux, nous
voyons disparaître la cathédrale ; cette fois, nous sommes
coupés de tout ce qui fut notre vie : femmes, enfants, famille,
patrie.
À
Amagne, une heureuse surprise nous attend. La Croix Rouge fait ouvrir
nos wagons et nous offre du pain blanc, du sucre, des boîtes
de sardine. On ne dira jamais assez, quel dévouement elle a
montré pendant toute la guerre et quelle reconnaissance lui
doivent les déportés et les prisonniers.
Elle
fait remplir notre cruche d'eau ; le précieux liquide est rapidement
partagé et consommé et nous songeons aux convois qui
firent le trajet sans aucune boisson et dans lesquels plusieurs détenus
étaient morts en arrivant.
Nous
sommes naturellement dans l'impossibilité de nous nettoyer
; nos mains sont noires, la sueur laisse des traces dans la poussière
qui couvre nos visages ; les barbes non rasées donnent déjà,
à certains, une physionomie de bagnards.
Drame
rapide
Nous
roulons à travers les Ardennes la locomotive souffle dans la
côte et l'allure se ralentit ; soudain des coups de feu retentissent
; un arrêt brusque ; on entend des éclats de voix et
la porte de notre wagon est brutalement ouverte ; un sous-officier
monte et inspecte rapidement notre groupe ; une évasion vient
de se produire et les gardes ont tiré sur les fuyards. Des
soldats circulent sur la voie, pénétrant successivement
dans tous les wagons. La porte du nôtre est refermée
mais, par les fentes, nous voyons deux hommes poussés, à
coups de crosses, sur la voie contiguë. On les fait coucher,
la figure contre terre, un soldat s'approche, la mitraillette sous
le bras, il décharge deux fois son arme dans la nuque des malheureux.
Plusieurs d'entre nous ont détourné la tête ; d'autres
ne peuvent détacher leurs yeux de l'affreux spectacle ; les
corps sont secoués d'un dernier soubresaut et le convoi repart
lentement. Deux de nos camarades avaient déjà été
fusillés à Soissons.
Peu
après, la porte s'ouvre ; un officier surgit, revolver au côté.
Comme il ne paraît pas avoir d'intentions hostiles, notre camarade
de Vogüe lui exprime courageusement notre douloureuse émotion.
« Je suis un homme comme vous, réplique-t-il en
allemand ; mais je suis, avant tout, un soldat et, comme tel, je dois
exécuter les ordres reçus. Des hommes ont scié
les planches de leur wagon et tenté de s'évader ; la
sanction a été appliquée immédiatement
; j'ai prévenu, qu'en cas de récidive, dans une des
voitures, un certain nombre des occupants seraient fusillés
». Puis, sans transition, il ajoute : « Je vais regagner
Compiègne et vous remettre entre les mains d'un nouveau détachement
qui vous conduira à destination ; je n'ai pas le droit de vous
la révéler. Certains d'entre vous auront, sans doute,
l'occasion de travailler utilement en Allemagne, peut-être d'occuper
certains postes ; il faut vous persuader que vous avez avantage à
le faire. L'Allemagne et la France doivent s'unir contre l'ennemi
commun (la Russie) ».
Il
s'en va, nous laissant tout éberlués par cette déclaration
; est-elle sincère ? est-elle l'expression d'un sentiment
personnel ou d'une propagande officielle ?
Après
trois nuits de voyage, le 31 juillet au petit jour, nous sommes arrivés
à Hambourg maritime. Devant nos yeux, les quais du port sont
démolis, les grues de guingois sur leurs bases ; des mâts
de navires émergent des bassins ; au plus loin que la vue se
porte, ce ne sont que dévastations ; mais nous ne découvrons
rien de la ville elle-même.
Bientôt,
nous apercevons un vaste camp, avec des baraquements, des miradors,
des fils barbelés ; nous sommes arrivés ; le train s'arrête.
On entend des commandements rauques, cependant que les wagons voisins
s'ouvrent ; on perçoit une ruée de troupeau humain,
au milieu d'aboiements furieux ; puis notre porte est tirée
; tous nos codétenus, en chemise, courent, poursuivis par les
soldats armées de lanières, avec lesquelles ils frappent
les retardataires ; nous nous précipitons dehors, la vue des
chiens-loups, tenus en laisse, les hurlements « Raus,
los, los » nous donnent des jambes et, rapidement,
nous sommes en rangs par cinq, sur la route, attendant des ordres.

Le camp de Neuengamme
Une
vaste esplanade en ciment ; à droite et à gauche des
baraques, ornées de petites boîtes oblongues garnies
de verdure ; le camp lui-même est entouré de plates-bandes,
où alternent fleurs et légumes, qui leur donnent, au
premier abord, un aspect riant ; mais les yeux se portent bien vite
sur les barbelés qui ceinturent chaque bâtiment, courant
sur des poteaux à peine équarris et passés au
goudron. C'est l'image du perpétuel contraste allemand : le
luxe, sans cesse, côtoie la misère. Des détenus,
qui circulent, en corvée, avec des soldats allemands, nous
crient de bons conseils : « Ne buvez pas d'eau ! »,
mais nous mourrons de soif ; l'un d'entre nous se trouve mal et s'affale
à terre. On nous apporte des écuelles contenant environ
deux litres d'eau, une par file de cinq et, après un moment
d'hésitation, devant cette promiscuité, nous buvons
avec délices.
Après
un appel, nous recevons une plaque matricule, à porter au cou
; je ne suis plus que le 39.327 ; puis c'est la douche, après
avoir déposé argent, bijoux et vivres ; avec regret
je donne ma montre qu'un soldat place dans un sachet de papier, mais
je garde mon alliance dans ma bouche ; nos effets sont mis dans un
sac pour la désinfection et nous recevons une chemise, un pantalon
et une veste, marqués d'une croix jaune (pour rendre plus
difficiles les évasions) le tout rapiécé, déteint
mais propre. On nous rendra nos effets, quelques jours après,
étuvés.
Toutes
les baraques dites « blocs » sont commandées par
un chef qui est, généralement, un condamné de
doit commun allemand, assisté d'adjoints (Vorarbeiter).
Nous
gagnons le bloc 12 qui jouit d'un régime un peu spécial
; il est habité par des déportés politiques français,
arrêtés comme nous et qui ne sont pas astreints au travail.
Nous y sommes reçus par R…., un député,
qui semble commander le groupe et nous reçoit d'une façon
charmante. Comme tous les lits sont garnis, certains camarades ont
décidé de coucher à deux, pour nous abandonner
leur place, afin que nous puissions nous reposer, après ces
trois nuits exténuantes.
Les
couchettes à trois étages sont garnies d'une paillasse
remplie de copeaux de bois. Celle-ci s'aplatit vite et atténue
à peine la dureté de la planche ; mais elle a un avantage
: les parasites ne s'y mettent pas et nous n'en avons jamais eu à
Neuengamme.
Au
centre du bâtiment, un espace vide avec tables et bancs sert
de réfectoire ; mais, vu son exiguïté, il faut
organiser trois services.
Le
menu est maigre ; le matin une sorte de tisanes avec 100 grammes de
pain ; à midi, soupe aux choux ou aux navets ; le soir 200
grammes de pain, avec une rondelle de saucisson, remplacée
parfois par une cuillerée de confitures ou du fromage. Cette
nourriture presque exclusivement aqueuse dispose à la dysenterie.
Nous sommes descendus d'un degré dans la misère ; pourtant
il y a plus malheureux que nous, ainsi que nous expliquent nos anciens.
La vie des blocs de travail
Lorsque
notre convoi, dont faisait partie Albert Sarraut, est arrivé,
un soir, il y a quinze jours, nous dit l'un deux, nous avons été
immédiatement dirigés vers « la Cave »
où nous sommes restés, sans manger ni boire, jusqu'au
lendemain matin. Debout, empilés dans un espace restreint,
manquant d'air, certains s'évanouirent et durent être
évacués ; les geôliers commencèrent à
nous passer, cheveux et barbe, à la tondeuse, puis avec quelques
coups de rasoir, à éliminer, sans aucun ménagement,
devant et derrière, tous les poils jugés superflus.
C'est alors que le préfet Dommange demanda à parler
au commandant du camp et, malgré les coups, réussit
à faire entendre ses protestations contre le traitement ignominieux
qu'on voulait appliquer à un ancien président du conseil
français, à des ministres, parlementaires et magistrats.
Un
scrupule saisit les exécuteurs, et après une conversation
téléphonique avec Berlin, un tri fut fait : ministres,
députés, sénateurs, ecclésiastiques furent
mis à part et constituèrent un groupement auquel fut
donné le nom de Sonderhäflinge (prisonniers spéciaux) ; il fut dispensé du travail et put conserver ses valises,
habits, linge et provisions ; mais là se bornèrent les
avantages.
Quelques
jours après, tous ceux qui avaient été arrêtés
par la même mesure générale, comme suspects, qu'ils
fussent d'ailleurs commerçants, fonctionnaires ou ouvriers,
furent adjoints au groupe, à l'exception de ceux dont la fiche
mentionnait des inculpations précises ; parmi ceux-là,
peu nombreux, figuraient deux préfets (dont Dommange) ; ils
furent versés dans les blocs de travailleurs.
C'est
ainsi que notre groupe de Reims fut affecté à ce groupement.
Peut-être,
les Allemands eurent-ils, à l'époque, l'idée
que ces Sonderhäftlinge pourraient éventuellement
servir de monnaie d'échange ; craignirent-ils, sous leur influence,
l'éclosion de mutineries ? En tout cas, ils furent soigneusement
séparés, dans un bloc à part, mais, par une singulière
inconséquence, on continua à les entasser dans les mêmes
abris, en cas d'alerte.
Et
voici le régime des blocs de travailleurs.
Lever
à 5 heures, rassemblement dans l'étroite cour longeant
le bâtiment, où les bagnards attendent, debout, par tous
les temps, le départ au travail à 7 heures. La
nourriture est la même que la nôtre avec, en plus, un
léger cassecroûte à 10 heures, accompagné
de 100 grammes de pain. Retour à midi, déjeuner, à
nouveau travail jusqu'à 17 heures. Puis appel, récréation
jusqu'au dîner à 19 heures et coucher à deux par
lit.
Le
travailleur n'a, pour tout costume, qu'une chemise, un pantalon et
une veste à croix jaune, un chapeau également bariolé,
une paire de semelles en bois, avec des courroies ; mais ni mouchoirs,
ni papiers, ni couteaux ; des fouilles sont opérées
inopinément et les délinquants sont battus.
Les
coups de toutes sortes sont la monnaie courante ; lors des appels,
les SS accélèrent le mouvement, à grands coups
de lanières de cuir ou de nerfs de bœuf. Les claques,
les coups de point en pleine figure pleuvent, sous le moindre prétexte
et la malheureuse victime doit les recevoir sans broncher ; un mouvement
de révolte entraînerait immédiatement la pendaison.
Le
camp abrite toutes les nationalités : Allemands, Français,
Belges, Hollandais, Danois, Yougoslaves, Polonais, Russes.
À
côté des travailleurs à croix jaune, existent
des bagnards en costume rayé ; ceux-là sont détachés
en Kommandos pour des travaux de tranchées, déblaiement
ou terrassement. Les jeunes préfèrent ces Kommandos
au camp, malgré le travail plus pénible, parce qu'ils
sont, pendant cette période, mieux nourris et moins brutalisés.
Les secrétaires, infirmiers, et médecins sont en rayé,
ainsi que les musiciens, car il y a des musiciens, une fanfare de
cirque, composée de cuivres, d'ocarinas et d'une grosse caisse,
qui accompagne le départ au travail, au pas cadencé.
Le
dimanche, le travail est suspendu l'après-midi, la musique
joue sur l'esplanade ; les volontaires organisent des matches de football
ou de boxe.
Parfois,
on voit passer un troupeau lamentable de manchots, bossus, unijambistes
; ce sont ceux qui, incapables de travailler, vont éplucher
les légumes à la cuisine. Les plus de 60 ans sont employés
à une besogne spéciale : ils sont assis et font, avec
de vieux chiffons, des sortes de tresses qui serviront à confectionner
des couvertures, mais comme, faute de baraquements, il doivent se
tenir dehors, leur sort, en hiver ou par la pluie, est plus dur encore.
Tout
rapport nous est interdit avec les travailleurs mais, à la
faveur des récréations ou des jeux du dimanche, nombreux
sont ceux qui, au risque d'une correction, viennent nous parler au
travers des barbelés. Nous avons vu là l'avoué
Droit, le liquidateur Poupart, Dompmartin, entrepreneur, Berland de
la SPDE, Docq, secrétaire de la Bourse du Travail, le marquis
de Moustiers, le préfet Dommange…. Des Russes ou des Polonais,
parmi lesquels il y a des enfants, de 12 ou 13 ans, viennent mendier
un peu de nourriture, restes de soupe, croûtes de pain, épluchures
de pommes de terre, sur lesquels ils se jettent avec voracité.
Nous
apprenons ainsi par des secrétaires qui ont entendu la radio,
quelques bribes de nouvelles ; nous savons que Paris est virtuellement
dégagé et sommes anxieux pour Reims, mais nous lisons
bientôt, entre les lignes des communiqués, qu'il n'y
a pas eu de combats, autour de notre ville et que l'ennemi a dû
fuir à toute vitesse.
La
loi du camp c'est le marché noir. Les travailleurs touchent,
chaque semaine, une paie dérisoire avec laquelle ils achètent,
à la cantine, des cigarettes et des vivres ; nous avons, de
notre côté, conservé quelques billets de banque
; nous pouvons ainsi nous procurer au travers des barbelés,
du fil, des aiguilles, du savon, du linge, probablement pillé
par les plus audacieux, au magasin d'habillement, où sont entassés
les effets ayant appartenu aux déportés et aux morts.
Mais la véritable unité monétaire, c'est la cigarette,
car certains préfèrent encore fumer que manger.
La
loi du camp c'est aussi la loi de la jungle, le vol qui finira, hélas
! par se manifester aussi dans notre groupe.
Le
2 août on nous transfère dans les Revier, bâtiments
de l'ancienne infirmerie ; ce sont des baraques, divisées en
petites chambres, d'environ 35 lits à deux ou trois étages.
Nous sommes là 350 prisonniers spéciaux, arrêtés
dans les mêmes conditions. C'est le milieu le plus hétéroclite
qu'on puisse rêver : un ancien président du Conseil,
Albert Sarraut, deux ministres, une demi douzaine de parlementaires,
des préfets, des magistrats, Monseigneur de Solages qui dirige
la faculté catholique de Toulouse et fait très bon ménage
avec le recteur de l'Université, avec lequel il discute de
mathématiques, des médecins, des avocats, beaucoup de
maires, des commerçants, des cultivateurs, des ouvriers provenant
de milieux syndicalistes et communistes : comme âge, de 16 à
75 ans. Tout ce monde, fort peu fait pour vivre ensemble s'et groupé
par régions : Bourguignons, Champenois, Lorrains, Toulousains,
etc… Les camarades m'ont nommé Chef du groupe Champagne.
Quelques
jours après, arrive un contingent d'Alsaciens, pour la plupart
de jeunes fonctionnaires qui n'ont pas voulu s'enrôler dans
l'armée allemande, gais, causeurs, souvent même imprudents
dans leur conversation ; quelle animation ils apportent. Hélas
! trois mois après, ils devaient être brutalement enlevés
pour être incorporés dans les blocs de travailleurs.
Nous avons supposé que les Boches s'étaient vengés
de la perte de l'Alsace. Beaucoup ne sont pas revenus.
Au
début de septembre c'est un groupe de policiers danois en uniformes
rutilants ; ils sont logés dans un bloc spécial,
conservent leurs vêtements et n'ont pas les cheveux coupés
mais ils travaillent ; ils repartent une semaine plus tard.
Le
froid commence à faire son apparition ; on nous autorise à
aller prendre dans nos valises des pardessus et vêtements chauds
; grâce à un paquet de tabac, je peux jeter, dans une
couverture, des sandales, mon couteau, des cigarettes, du savon, des
brochures mais ni lettres, ni portefeuille.
7
septembre : un Polonais a tenté de s'évader
; nous le voyons rentrer, escorté par les chiens qui le mordent
et lui mettent les vêtements en lambeaux. Les SS l'accablent
de coups, avant de le réintégrer dans son bloc.
Quelques
jours plus tard, un détenu traverse l'esplanade en courant,
poursuivi par les soldats armés de lanières ; hurlant
de peur, il est bientôt rattrapé, trébuche et
tombe ; les soldats continuent à le battre et le bourrent de
coups de pieds ; il finit par se relever, ensanglanté en boitant
lamentablement.
Le
30, nous voyons défiler en rangs, mais attachés, une
trentaine de pauvres bougres, qui se dirigent vers « Le Mitard
», sans un geste de protestation, sans un cri. Ils se placent
devant la porte du bâtiment, attendant leur tour d'être
pendus. Quelques minutes de torture morale ! Mais ils ont tant souffert
que tout réflexe de réaction a disparu chez eux.
Le
mitard est une cellule sombre où l'on enferme, à peu
près sans nourriture, les détenus pour la moindre faute
; elle touche à la salle d'exécution et n'en est souvent
que l'antichambre. Avant l'exécution, les condamnés
sont mis à nu ; les vêtements et le linge sont ramassés
et envoyés à l'étuve. Les corps vont au four
crématoire mais auparavant, les dents d'or sont soigneusement
arrachées.
1er
octobre : les hommes de corvée qui nous
apportent la marmite de soupe font un faux mouvement ; elle bascule
; aussitôt tous sont à quatre pattes avec leurs cuillers
qu'ils sortent de leur poche et avalent goulûment ce qu'ils
peuvent ramasser sur le macadam.
Les
appels
Chaque
soir à 17 heures tous les détenus du camp – notre groupe
compris – se rassemblent sur l'esplanade. Bien souvent se révèlent
des manquants, malades, partis en Kommandos ; un jour même,
trois morts nécessitèrent de longues recherches. Et
au soleil ou sous la pluie, l'appel dure une demi-heure , une heure
et jusqu'à deux heures et demie (le camp contient 10 000 détenus).
Alertes et abris
Dès
que la sirène a annoncé une présomption d'alerte,
c'est un branle-bas général de préparation et,
quand sonne l'alerte, c'est une ruée vers la cave d'un bâtiment
en briques, situé à l'extrémité du camp.
La nuit, comme l'électricité s'éteint, il faut
courir dans l'obscurité, au risque de trébucher dans
un trou. Les SS en profitent pour distribuer, au hasard, une ample
provision de coups de fouet. Chaque nuit voit au moins une alerte,
quelquefois deux ou trois.
La
cave est un simple sous-sol, qui préserverait des éclats,
mais serait crevé par la plus petite bombe d'avion. La véritable
raison de ces rassemblements aux abris n'est pas de préserver
nos vies, mais d'éviter des évasions à la faveur
du bombardement. Le séjour dans cette cave est pénible
à la lueur de quelques ampoules bleues ; on manque d'air dans
cette agglomération d'hommes qui causent, chantent et fument
; il se prolonge souvent une heure ou deux, quelques-uns se laissent
tomber au milieu des gravats et des flaques d'eau. Il est prudent,
dans ces rassemblements, où foisonnent des éléments
douteux, de surveiller sa coiffure ou ses proches.
Et
que de bronchites en perspective pour l'hiver.
La visite médicale à
l'infirmerie
Chaque
matin a lieu une visite médicale, passée par deux ou
trois médecins de notre groupe ; les malades sont nombreux
au fur et à mesure qu'apparaissent les brouillards d'automne
; par contre, les médicaments sont en quantité insuffisante,
même les plus simples. Quelques-uns des nôtres se sont
improvisés infirmiers. Il y a une visite allemande, pour les
grands malades et une infirmerie allemande ; à côté
de celle-ci est un petit bâtiment que nous appelons la chambre
des condamnés à mort ; les malades sont mis là,
dès qu'ils sont considérés comme inguérissables,
sans médicaments et sans soins ; tous les matins, seulement,
on enlève les morts.

Le nouveau camp
Au
milieu d'octobre, on nous fait à nouveau déménager
et on nous installe dans une nouvelle partie du camp aménagée
à notre intention un peu à l'écart des blocs.
Un bâtiment voisin du nôtre abrite quelques dames en pyjamas,
auxquelles les officiers viennent rendre visite le dimanche. Chez
les Allemands, tout est organisé et réglé ! Ce
sont deux anciennes écuries qui ont été garnies
d'un plancher et abritent chacune 150 à 200 couchettes à
trois étages.
À
l'extrémité, sont deux petites salles, l'une pourvue
d'une vingtaine de robinets, constitue notre cabinet de toilette,
l'autre, munie de huit sièges en porcelaine, tient lieu de
ce petit local où l'on est ordinairement isolé ; mais
nous ne nous embarrassons plus des convenances et pudeurs mondaines
et ce salon d'un nouveau genre est parfois le cadre de conversations
animées.
Jusque
là, le chef de notre groupe était un jeune médecin
alsacien, énergique et parlant bien l'allemand, ce qui lui
permettait, en maintes circonstances, d'exposer nos doléances.
Mais bientôt il tombe malade ; nous désignons alors,
comme chef et homme de confiance, Henri Maupoil, sénateur,
ancien ministre, commandant de réserve, commandeur de la légion
d'honneur, grand mutilé, autant de titres qui sont respectés
par les Allemands et lui permettront de se faire entendre.
Avec
l'approche de l'hiver, la température est devenue froide ;
dans nos deux baraquements sans plafonds et contenant seulement deux
petits poêles, il y a des gouttières partout ; nous allons
vivre dans l'humidité ; les quelques morceaux de sucre que
nous conservons encore, fondent ; les chaussures, laissées
sous les lits, se couvrent rapidement de moisissure.
La
visite médicale est plus chargée, à cause de
l'insuffisance de nourriture ; la force de résistance diminue,
les traits se tirent. Une pesée générale, en
février, devrait révéler des perte de poids de
5, 10, 20 kilos, exceptionnellement 30 et 40. La moindre égratignure
suppure et tarde à se cicatriser. Le 24 décembre, un
professeur d'anglais qui s'était coupé légèrement
au doigt, à un carreau cassé, meurt de gangrène
gazeuse en quelques jours.
Entre
les deux baraques, c'est le sol brut, la terre argileuse qui, à
la moindre pluie, se transforme en bourbier ; nous obtenons, au bout
de trois semaines, des débris de briques et des tombereaux
de mâchefer, un rouleau pour les écraser ; nous pouvons,
alors, confectionner une sorte de macadam, où l'on circule
à pied sec.
La
soupe nous est apportée dans de grands récipients de
60 à 10 litres ; avec le pain, le saucisson et la margarine
: une équipe de 4 ou 5 hommes qui constitue « La Répartition
» en prend livraison et fait la distribution dans chaque groupe.
Au
début de 1945, la faim, chez certains, était devenue
une souffrance. J'évoque la soupe répandue sur l'esplanade
et mangée, à terre, par les hommes de corvée
; les mêmes causes comportent les mêmes effets : des boîtes
de moules, sauce moutarde, se répandent sur les flaques d'eau
glacée de notre cour ; on les ramasse et on les distribue avec
les autres. Quand l'un de nous – bien rarement – laisse quelques légumes
de sa soupe dans son assiette, ces restes trouvent vite preneur. On
nous a servi de petits poissons, trempant dans la saumure et dont
l'odeur nous aurait fait, autrefois, lever le cœur ; non seulement,
nous les avons mangés mais l'un de nous a récolté
les têtes, les queues et les arêtes de ceux qui avaient
procédé à un épluchage ; il les a écrasées
avec du pain et mangées.
Les
répartiteurs sont vivement critiqués ; on les accuse
de se servir plus largement, au détriment de la masse ; pour
une pomme de terre de plus ou de moins dans votre assiette, ce sont
des paroles amères, des reproches violents. Pour comble, des
vols se produisent dans les armoires individuelles ; des querelles
éclatent, des injures s'échangent ; le vernis de la
civilisation a craqué ; beaucoup redeviennent des hommes primitifs,
prêts à se battre pour leur subsistance. Les parts sont
maintenant tirées au sort ; après la distribution des
confitures le plat est attribué à tour de rôle,
pour être léché. J'ai vu le président Réville,
passer longuement sa langue sur l'assiette ; qu'eut-il pensé
de cette manière de faire, un an auparavant ?
J'ai
vu un préfet, avec son bras unique, laisser tomber une cuillerée
de confitures dans son soulier ; et personne n'a songé à
rire quand on l'a vu ramasser et racler soigneusement le jus sucré.
Quand
on sert, le dimanche, des pommes de terre, en robe des champs, nombreux
sont ceux qui ne les épluchent pas et les mangent telles quelles
; d'autres enlèvent soigneusement la peau qu'ils font sécher
et découpent ensuite, pour constituer un ersatz de tabac.
Conséquence
curieuse de cet état perpétuel de fringale : jamais
on ne s'est tant intéressé aux plaisirs de la bouche.
Tout d'abord, ce furent les conversations où chacun évoquait
les bons repas d'autrefois, puis des échanges de recettes et
bientôt une frénésie de cuisine sévit sur
le camp ; il y eut des cours où l'on prenait des notes : plats
mijotés, gibiers, entremets, crèmes, tout défilait,
exaspérant encore l'appétit des malheureux.
Nos
chaussures, qui sont passées déjà plusieurs fois
chez le cordonnier, sont en triste état ; afin de les réserver
pour les marches que nous pourrions être appelés à
faire, nous portons, malgré le froid, des semelles de bois,
fournies par le camp et fixées par des courroies, comme celle
des capucins.
Maupoil
a obtenu, difficilement, qu'on répare nos effets les plus usés
ou qu'on nous les remplace ; qu'on distribue des pardessus ; mais
combien d'autres réclamations restent sans réponse ;
en particulier nous n'avons jamais pu obtenir de correspondre avec
nos familles, même par simple carte.
Les
conférences. : comme les prisonniers
de guerre, nous nous sommes rendu compte très vite qu'il était
nécessaire de nous maintenir en bonne forme intellectuelle,
pour pouvoir supporter la captivité et chacun de nous accepta
de faire une conférence sur sa profession. Alors se succédèrent
les sujets les plus variés, la médecine, la chirurgie,
la papeterie, la verrerie, la laine et les textiles artificiels, la
laiterie, les tabacs, les transports, les pierres précieuses,
la chasse, puis vinrent des récits de voyage, des causeries
touristiques sur les provinces françaises, des études
littéraires ; Albert Sarraut nous parla de l'Indochine, dont
il avait été gouverneur.
On
organisa des cours d'allemand, d'anglais, d'Histoire de mathématiques
qui occupèrent une grande partie de nos journées.
L'université
de Neuengamme était créée et notre camarade de
Vogüé, qui en avait été le plus actif promoteur,
en fut par acclamations, « le Recteur ». On
peut dire que c'est grâce à lui que notre moral a résisté
aux épreuves.

Impressions de captivité
Nous
avions accepté la détention à Châlons,
avec une grande sérénité ; elle semblait devoir
être courte et n'entraînait pas de graves privations ;
le départ pour Compiègne avait déjà marqué
une aggravation sensible, mais la vie au grand air, en été,
nous avait aidés à la supporter.
C'est
seulement de notre déportation en Allemagne, que datent véritablement
nos souffrances morales. La perte de la liberté est plus pénible,
en terre étrangère, et une nostalgie invincible commence
à envahir nos âmes de détenus. Les brimades, le
manque de confort, le spectacle du bagne qu'est la vie de nos voisins
des blocs, les privations et surtout l'impossibilité de correspondre
avec nos familles abattent le moral de ceux dont le caractère
est mal trempé.
On
cherchera des dérivatifs : jeux de cartes, de dames ou d'échecs
; beaucoup s'en lassèrent vite ; la lecture – mais la
bibliothèque du camp ne contenait que des livres allemands,
souvent sans grand intérêt ; faute de mieux, on s'en
contenta. Mais surtout les conférences et les cours furent
un heureux dérivatif.
Un
autre motif d'anxiété pour nous, c'était le sort
de la partie occupée, menacée de la guerre sur son propre
sol, qui la laisserait, peut-être, complètement ruinée.
Heureusement,
à peine dix jours après notre arrivée à
Neuengamme, l'offensive anglaise commençait à gagner
rapidement du terrain ; et nous pouvions envisager notre retour à
la liberté vers la fin de l'année. Nous recevions chaque
jour, sans nous expliquer pourquoi, un journal allemand, et, à
travers toutes les réticences, tous les articles tendancieux,
nous démêlions les craintes et les déceptions
de l'ennemi. Le communiqué retardait bien de quelques jours
les succès alliés, il insistait lourdement sur les pertes
de l'adversaire, mais il ne pouvait nous cacher l'avancée irrésistible
de nos troupes.
Aussi
ce fut avec consternation que nous apprîmes, à la fin
de 1944, l'échec d'Arnheim et la contre-offensive de Bastogne.
Tout cela, certes, ne pouvait changer l'issue de la guerre mais c'était
sa fin retardée. Et, passant d'un excès à l'autre,
ceux qui avaient prophétisé la clôture rapide
des hostilités en octobre, annonçaient un second hiver
à passer derrière les barbelés. L'énervement
général était encore accru par les fausses nouvelles
qui circulaient annonçant des succès foudroyants et
démenties le lendemain.
Entre
les optimistes forcenés et les pessimistes impénitents,
il y avait néanmoins des esprits posés, s'efforçant
de raisonner, en faisant abstraction de nos désirs et de nos
déceptions. N'avait-on pas, en 1918, consenti, trop tôt,
un armistice qui permit aux Allemands de conserver la foi dans l'invincibilité
de leur armée, de préserver leur pays de toute destruction
et de se relever plus vite que la France sinistrée ? Pour éviter
le retour de semblable erreur, ne pouvions-nous sacrifier quelques
mois de notre vie, tandis que les combattants donnent la leur tout
entière, puisque aussi bien le succès était assuré
à plus ou moins brève échéance ? Nous
faisons notre sacrifice, nous attendrons, sans récriminer,
l'heure de la victoire, en pensant à tous les nôtres
qui ont aussi leurs épreuves et leurs misères.
Noël. notre
recteur avait bien prévu ces moments de découragement
au moment de Noël et du Nouvel An ; aussi avait-il organisé,
pour ces jours-là, de petites fêtes.
Un
livre classique, retrouvé dans les bagages de l'un de nous,
lui donna l'idée de monter une représentation des Plaideurs,
de Racine ; c'était une entreprise audacieuse, mais le Français
est ingénieux ; on dressa une estrade ; un artiste brossa des
décors sur du papier goudronné ; du linge et des couvertures
servirent à confectionner des costumes et des soutanes constituèrent
les robes de juge et de greffier.
D'autre
part, une chorale s'était constituée qui commença
à répéter Le Temps des Cerises, Les
Bateliers de la Volga et une chanson de soldat du Moyen-Âge.
Ce
fut un succès mais qui ne nous empêcha pas le soir, sous
les couvertures, d'évoquer les réveillons et réunions
de famille d'antan et d'envoyer une pensée émue aux
nôtres avant de nous endormir.
La
température à fin décembre était devenue
très basse. Le thermomètre descendit à -17°,
puis atteignit -25°.

La fin de l'hiver 1944-45
Depuis
quelques temps, nous avions vu arriver au camp beaucoup de Nordiques,
en particulier des Danois et des camions de la Croix-Rouge suédoise
étaient apparus sur la route, venant sans doute pour les ravitailler.
Elle dût apporter de gros approvisionnements car notre ordinaire
s'en ressentit. Ce fut d'abord une distribution de pain de seigle
vitaminé puis un colis pour quatre, composé de lait
en poudre, fromage, conserves de viande, margarine, sucre et chocolat
; par ailleurs nos soupes devenaient meilleures. Y avait-il donc quelque
chose de changé ?
Nous
pûmes le croire quand Monseigneur de Solages nous apprit qu'il
venait de recevoir l'autorisation de dire la messe le jour de Pâques.
Plusieurs demandes avaient déjà été faites,
aussi bien par les protestants que par les catholiques, pour célébrer
des offices le dimanche, mais nous n'avions jamais reçu de
réponse ; faute de mieux les prêtres récitaient
les prières de la messe, en les commentant et de nombreux indifférents
s'étaient habitués à venir entendre le prêche
dominical.
Cette
première messe fut un événement ; les jours précédents,
on avait préparé fiévreusement l'autel, les ornements
liturgiques, les hosties, le vin, retrouvés dans les valises
spéciales des prêtres ; un camarade avait offert un crucifix,
sculpté par lui dans une planche.
Et
le jour de Pâques, au milieu d'un silence religieux, Monseigneur
de Solages commença à officier. Ses yeux, naturellement
brillants d'intelligence et de douceur, resplendissaient d'un éclat
particulier de recueillement intérieur et d'extase ; et tous
les assistants se sentaient transportés, eux aussi, dans un
autre monde. Les communions furent nombreuses et, parmi ceux qui reçurent
l'hostie, il en était beaucoup qui n'avaient pas pratiqué
depuis longtemps.
Mais
cette belle cérémonie ne devait pas avoir de lendemain
; quelques jours après, les cars de la Croix-Rouge suédoise,
faisaient leur entrée sur l'esplanade, pour nous emmener vers
l'inconnu. On nous avait auparavant restitué nos montres et
nos bijoux.
Le départ de Neuengamme, 12
avril 1945
Nous
sommes installés, à vingt-cinq par véhicule,
sur quatre banquettes en bois longitudinales ; nos valises sont sur
le toit, nos musettes et vivres sur un petit rayon ; nous sommes très
serrés mais ce départ nous semble le prélude
de la liberté, bien qu'un soldat, installé près
du wattman, le fusil en main, nous surveille, d'un air soupçonneux
et nous compte soigneusement à chaque arrêt, pour s'assurer
que personne ne manque.
Tout
de suite, c'est l'enchantement du printemps ; à travers nos
barbelés, nous n'apercevions que les arbres de la route et
quelques coins de champs, masqués par des blockhaus ; nous
roulons maintenant en pleine campagne ; à perte de vue, c'est
le vert tendre des feuilles ; de petites maisons coquettes s'égrènent
au passage ; on cultive, comme si la guerre n'avait jamais existé
; des enfants, beaucoup d'enfants, aux joues rouges et bien pleines
; ces gens-là n'ont pas souffert.
Nous
roulons vers l'Est ; le convoi a stoppé et les chefs de cars
sont allés chercher au car de ravitaillement du pain, du saucisson,
de la margarine ainsi qu'un nouveau colis américain.
Nous
dépassons Postdam ; le parc de Sans Souci, le moulin, les palais
semblent intacts ; par ci, par là, des éraflures d'éclats
d'obus sur les murs ; mais, en pénétrant plus avant
dans le centre, on voit des devantures éventrées, des
débris de carreaux jonchent le sol ; les avions ont dû
passer par là ; dans les rues, une grande circulation d'hommes
et de femmes, qui ont l'air tristes et pressés. Sans doute
commencent-ils à s'inquiéter.
Le
soir tombe, nous allons passer une mauvaise nuit, les banquettes sont
étroites et dures et nous n'avons plus guère de graisse
sur les os, pour remplacer les coussins ; il est impossible d'allonger
les jambes ; aussi commençons-nous à avoir les chevilles
enflées, le lendemain matin.
On
nous arrête pour déjeuner dans une prairie et nous avons
là, sous le soleil une heure délicieuse ; nous récoltons
des pissenlits et des laitues sauvages et découvrons une source
glacée où nous allons puiser ; nous nous croyons en
pique-nique et oublions notre gardien, mais, bougon, il se rappelle
à notre souvenir, se plaint qu'on lui ait dérobé
son quart et, sans façon, confisque celui d'un d'entre nous.
Nous
avons pu parler à l'infirmière suédoise ; elle
nous apprend qu'on doit nous déposer au camp de Flossenbourg,
où des camions suisses viendront nous chercher. Quant au convoi,
il continuera sa route, pour aller chercher des Juifs au ghetto de
la forteresse de Theresienstadt et les emmener en Suède.
Dans
les villes, au sud de Postdam, le grouillement de la population s'accentue ; il
y a relativement peu de maisons détruites, mais des voitures,
des camions stationnent dans les rues ; on y empile fiévreusement
des meubles, des males, des matelas. Nous croisons des fuyards dans
des charrettes de ferme, des cyclistes, des piétons, chargés
de sacs tyroliens, traînant des valises et des paquets, des
enfants accrochés aux jupes de leur mère et pleurant
; et tout ce monde semble affolé, comme des fourmis dont on
vient de retourner la fourmilière.
À
ce spectacle, nous nous sentons payés de beaucoup de nos misères
; il nous rappelle les exodes français de 1940 ; mais cette
fois c'est le vainqueur d'alors qui connaît, à son tour,
l'angoisse de la défaite, la douleur du foyer abandonné,
la fuite dans l'inconnu, après avoir ramassé les souvenirs
auxquels ont tient le plus et sans espoir d'un avenir meilleur, comme
nous pouvions le conserver au plus fort de la débâcle.
C'est la revanche et nous voudrions le leur crier.
Nous
devions passer par Leipzig ; mais les conducteurs ont stoppé
; ils consultent leurs cartes et modifient leur itinéraire
; la tenaille doit se resserrer et l'espace libre entre les armées
russes et américaines diminue ; allons-nous nous trouver en
pleine bataille et être enlevés par une formation de
tanks ? Tous les espoirs sont permis, mais on n'aperçoit aucune
troupe dans les champs et on n'entend pas de coups de feu
Nous
traversons Meissen, localité pittoresque sur l'Elbe, Karlsbad,
Marienbad, Egger et, après une nouvelle nuit dans les cars,
apercevons Flossenbourg perché sur une hauteur, garnie de forêts.
L'officier suédois est déjà en conférence
avec le commandant du camp et bientôt les voitures font demi-tour
et repartent en sens inverse ; on chuchote qu'on ne peut nous recevoir
parce que le camp est sur le point d'être évacué.
Nous
traversons à nouveau Egger pendant une alerte, puis Karlsbad,
quelques minutes avant un violent bombardement ; au cours d'une montée
abrupte, nous admirons la ville d'eaux dont les hôtels luxueux,
les vastes bâtiments administratifs grimpent le long de la côte
; l'air de la montagne est frais, la neige subsiste dans de petites
gorges où le soleil ne pénètre pas.
Une
troisième nuit nous reste à passer ; nous sommes exténués,
faute d'avoir pu nous étendre, depuis plus de quarante-huit
heures et nous avons les jambes enflées. Le lendemain matin,
nous faisons notre entrée dans la forteresse de Theresienstadt
(Therezin). Avant de quitter la Croix Rouge suédoise,
nous remettons des lettres aux conducteurs ; nous remercions tout
particulièrement l'infirmière qui note nos noms et nos
adresses et nous prenons congé un peu émus.
Lorsque
nous avions quitté Neuengamme, notre camarade de Vogüé
commençait une sérieuse pneumonie ; après consultation
des médecins, nous avions décidé de l'emmener
coûte que coûte. Un long voyage avec 40° de fièvre
n'était pas sans danger, mais nous ne voulions, à aucun
prix, le laisser aux mains des médecins allemands. Dans un
des cars, on organisa une infirmerie, on l'installa sur un brancard
et nous eûmes la satisfaction de le voir arriver en bon état,
grâce aux soins dévoués de l'infirmière.

Le rôle de la Croix-Rouge
dans notre départ de Neuengamme
Renseignements
recueillis par M. de Vogüé en 1946 lors de son voyage
en Suède auprès du Comte Bernadotte, président
de la Croix Rouge suédoise :
- la
Croix-Rouge suédoise, arrivée en Allemagne en février
1945, avait pour mission de rassembler à Neuengamme, tous les
déportés scandinaves. À cet effet, elle avait
établi son quartier général à Friedrichsruhe
et avait, à plusieurs reprises, ravitaillé ses compatriotes ;
- des
prisonniers scandinaves avaient signalé notre présence
aux autorités suédoises qui avaient demandé l'autorisation
de s'occuper de nous, au même titre que de leurs compatriotes.
Ils s'étaient vu opposer un refus. Brusquement, changement
de décision, auquel semble-t-il n'a pas été étranger
M. Musy, délégué suisse, détaché
par la Croix Rouge Internationale à Friedrichsruhe. Le 12 avril,
ordre est donné au Capitaine suédois Folke de nous emmener
à Flossenbourg puis d'aller, à vide, au ghetto de Theresienstadt
pour ramener les Juifs danois, qui s'y trouvent, au camp de Neuengamme.
La Croix Rouge suisse doit ensuite nous prendre à Flossenburg.
Le
convoi suédois quitte Friedrichsruhe à 10 heures pour
venir nous chercher. Au moment où la dernière voiture
quittait le QG arrive un coup de téléphone du ministre
des affaires étrangères de Stockholm, donnant contrordre
en raison de la nouvelle offensive russe qui risque de rendre difficile
le passage entre les armées alliées américaine
et russe. Le capitaine Folke prend sur lui de passer outre, en donnant
comme prétexte que le convoi était déjà
parti ; sans cette initiative heureuse, nous aurions, sans doute,
été embarqués, comme tous nos camarades, sur
les sinistres bateaux de Lubeck.
Le
capitaine Folke était parti en avant, dans sa voiture particulière,
pour prendre contact avec le chef du camp. Il savait que Flossenburg
était un Vernichtungslager et il eut l'intuition qu'on
nous envoyait là, pour nous supprimer sans témoins gênants,
conformément à l'ordre général donné
par Himmler ; cette opération eût été délicate
à Neuengamme, en raison de la présence de la Croix Rouge
suédoise, tandis qu'à Flossenbourg…
Ses
soupçons sont confirmés par le SS qui l'accompagne dans
sa voiture et dont il avait acquis la confiance, grâce à
de nombreuses rasades de " Snapps ", sorte de vodka suédoise.
Folke
cherche aussitôt à éviter que l'on nous débarque
dans ce bagne. Plusieurs solutions peuvent être
envisagées.
Nous
emmener à l'ouest à la rencontre des Américains
?
C'était renoncer à l'ordre reçu de ramener
les Juifs au Danemark.
Se
diriger vers la Suisse ? Pas assez d'essence.
Il adopte un troisième parti ; il sait que
le Ghetto de Theresienstadt, qui regroupe des personnalités
du monde juif a moins mauvaise réputation et il demande au
gouverneur allemand l'autorisation écrite de nous y déposer,
arguant qu'il existe là (pure invention de sa part),
un délégué de la Croix Rouge internationale qui
pourra nous prendre en charge. Le Boche refuse, Folke insiste et après
lui avoir donné une centaine de cigarettes, quatre bouteilles
de snapps et 400 francs suisses (!) il obtient gain de cause.
Une
deuxième fois, nous devons la vie à l'initiative de
Folke. On sait le sort qui a été fait quelques jours
plus tard aux malheureux bagnards de Flossenburg : les Américains
purent suivre leur douloureuse évacuation par les cadavres
échelonnés tout le long de leur route.

La forteresse de Theresienstadt
Nous
sommes logés dans des casemates, pouvant contenir chacune soixante-dix
hommes et prenant jour uniquement sur la porte d'entrée ; un
seul lavabo minuscule et un seul WC. C'est-à-dire que la vie
à l'intérieur est intenable, d'autant plus que la paille
des couchettes se révèle pleine de poux et de punaises.
Mais
la nourriture est meilleure ; on l'apporte dans de grands baquets
et chacun, à tour de rôle, vient tendre une boîte
de conserves vide.
18
avril : levé
de bon matin, j'aperçois dans la cour voisine, où sont
logés des Tchécoslovaques, une civière montée
sur roues qui s'arrête devant chacun des bâtiments ; on
en sort des cadavres raidis, complètement nus, qui sont chargés
et simplement recouverts d'une bâche. Cette macabre corvée
se renouvelle chaque jour.
Le
25 avril, nous déambulons dans notre cour, l'après-midi,
lorsqu'un coup de feu claque tout près de nous et l'un des
nôtres s'affaisse touché au ventre ; un soldat, dans
une cour voisine, a frappé un détenu avec la crosse
de son fusil et le choc a déclenché le coup. Les médecins
se précipitent et font préparer une civière et
une camionnette pour le mener à l'hôpital, mais il meurt
en arrivant.
Nous
sommes exaspérés. Le capitaine Folke a dû nous
recommander au commandant de la forteresse, car il reçoit Maupoil
et lui exprime ses regrets. Maupoil demande à aller préparer
les obsèques au village voisin, Bochovitz, et il est entendu
qu'une délégation ira accompagner notre camarade à
sa dernière demeure.
Le lendemain matin, nous sommes 200 ; on nous laisse
passer sans difficulté. La petite église ne peut nous
contenir tous et pourtant il n'y a là aucun habitant ; une
consigne a dû leur être donnée.
Après
l'office, le cortège se dirige vers le cimetière ; le
cercueil est descendu dans la fosse et nous jetons une pelletée
de terre avant de nous éloigner.
Une
surprise nous attendait à la sortie : tous les habitants du
bourg sont là, avec des paniers, des valises contenant du pain,
du sucre, des gâteaux qu'ils nous distribuent ; nous les remercions,
vivement émus de voir tous ces braves gens qui certainement
ne sont pas riches et connaissent des restrictions, comme en France,
se priver pour soulager notre infortune.
Au
retour, on nous annonce le départ et nous retournons à
Bochovitz où nous prenons place dans un train qui sera notre
cantonnement pendant trois jours. le chef de détachement est
un simple caporal yougoslave qui nous laisse toute liberté
; ses hommes et lui, vivent à notre ordinaire, et nous confient
qu'ils ont des effets civils pour s'échapper le moment venu.
Une
corvée part au village et, pendant deux jours, grâce
à l'aide d'un commerçant, nous faisons une soupe qu'on
apporte en gare.
Les
habitants nous comblent de prévenances, ils viennent causer
avec nous ; des femmes apportent des cruches de soupe ou des boissons
chaudes ; d'autres viennent avec des paniers de pain et de gâteaux
; sans se lasser, ces braves gens renouvellent leur geste aux heures
des repas.
Aussi,
quand, le samedi 28, le bruit court qu'un armistice est signé,
nous forçons la consigne et nous répandons dans les
rues pour fraterniser avec la population. Dans un café, où
nous nous installons pour manger nos provisions, on nous sert du thé
et le patron refuse notre argent.
Cet
accueil d'un peuple qui a souffert physiquement et moralement, pendant
des années d'occupation, s'adresse d'abord aux déportés
mais surtout aux Français et nous sommes infiniment touchés.
Dans
la rue, les habitants nous arrêtent, nous offrent à manger
et à boire, même à coucher. Une brave femme qui
m'a questionné sur notre captivité, insiste pour m'avoir
à déjeuner le lendemain après la messe, et je
devine que j'aurai un déjeuner de gala ; je lui dis combien
je suis sensible à son invitation et j'accepte. Mais serons-nous
encpore là demain ?
En
effet le lendemain 29, à 8 heures, on annonce le départ
pour la fin de la matinée ; nous allons prévenir nos
aimables hôtes et regagnons tristement nos wagons après
la messe. Le train s'ébranle aux cris répétés
de « Vive la Tchéquie », quelques-uns
même entonnent une Marseillaise qui ne provoque pas de
réaction chez les « Vert de gris ». On sent que la
fin approche. Des mouchoirs s'agitent ; nous quittons des amis que
nous ne reverrons probablement jamais.
À
chaque station, sous l'œil de la Wehrmacht, qui laisse faire,
les employés viennent nous parler ; la foule envahit les quais,
nous offrant des vivres, des cigarettes ; nous descendons ; les jeunes
filles se pressent autour de nous avec de petits carnets nous demandant
des autographes ; nous signons, nous signons toujours, après
avoir, en quelques mots, remercié de l'accueil que nous recevons
et exalté l'amitié franco-tchèque, en allemand,
car nous ne parlons pas tchèque et ils ne comprennent pas le
français.
Arrivés
à Kravice, le point terminus, nous partons en débandade,
par un chemin qui monte, en pente raide, vers notre nouveau cantonnement.

Le camp de Breshan
Le
camp de Breshan (Brezany) englobe une petite partie du
village, dont les allemands ont évacué les habitants.
Il a servi de centre d'entraînement de SS et il est entouré
de barbelés. Toute la contrée, qui occupe le haut d'un
plateau, sert de garnison à des troupes slovaques, sous le
commandement d'un officier allemand, que nous ne verrons jamais ;
nous dépendons d'un feldwebel, assisté de quelques
sous-officiers. Un administrateur tchèque assure le ravitaillement.
La
cuisine est faite par des détenus tchèques dans un local,
au guichet duquel nous allons tendre nos récipients, à
l'heure des repas.
Nous
avons touché des couvertures, des gamelles, cuillers et fourchettes,
mais pas de paille ; et nous constatons bientôt que les couchettes
sont infestées de punaises. Nous avons beaucoup d'espace, une
prairie pour nous promener, un étang où se perd un petit
cours d'au ; mais il pleut souvent et le sol est horriblement boueux.
Une
infirmerie fonctionnera dans une bicoque ; à peine était-elle
installée qu'on y transporte plusieurs de nos camarades, grelottant
de fièvre ; on dut les évacuer sur l'hôpital de
Bénéchau où ils furent soignés avec beaucoup
de sollicitude par les médecins tchèques ; mais, un
seul d'entre eux devait revenir ; ils avaient, en effet, contracté
la terrible maladie du typhus, qui ne pardonne guère aux Européens
de l'Ouest.
Le
6 mai, Maupoil décide de profiter d'un voyage à Prague
du chef de camp, pour l'accompagner avec deux camarades, et tenter
de se mettre en rapport avec Benès, qu'il connaissait, pour
organiser notre rapatriement.
Nous
avons su à son retour qu'il était tombé dans
une ville en pleine émeute ; il avait été arrêté
par les insurgés qui fusillent le feldwebel mais acclament
nos camarades, quand ils savent qu'ils sont Français et déportés.
On les laisse continuer, mais leur auto est attaquée par les
Allemands et c'est à grand peine que, sous les balles, ils
trouvent refuge à la Croix-Rouge.
Benès
n'était pas à Prague, mais le gouvernement insurrectionnel
promet à Maupoil de nous envoyer des cars pour nous chercher.
Pendant
ce temps, dans la matinée du 8 mai, nous avions vu les troupes
slovaques défiler sur la route voisine, former les faisceaux
et se mettre à chanter ; nous en sommes étonnés
car ce ne sont plus des chants de marche ; ils sonnent plutôt
comme des hymnes nationaux.
À
la tombée de la nuit, le sous-chef de camp nous avoue la suspension
des hostilités. On l'oblige à nous faire entendre la
radio anglaise, qui annonce les succès alliés et l'effondrement
allemand. C'est une explosion de joie ; on s'embrasse, on chante la Marseillaise à tue-tête, on se précipite
aux cuisines pour réclamer du café, un casse-croûte
et, à plus de minuit, les chants continuent.
Le
lendemain, les Allemands sont partis ; nous restons seuls avec l'administration
tchèque. Nous recevons la visite du maquis avec lequel nous
fraternisons.
Alors
nous sortons en bande pour aller au village voisin, Tynec, un gros
bourg étagé sur le flanc d'un coteau, où les
habitants nous accueillent à bras ouverts.
La
propriétaire d'une grosse usine, fabriquant autrefois des cycles
et transformée depuis l'occupation en usine de guerre, dont
le mari est mort depuis le début des hostilités, invite
à dîner les chefs de groupe et nous reçoit dans
un intérieur luxueux, brillamment éclairé ; elle
parle très purement le français ainsi que ses directeurs
qui assistent à la réception. Le dîner, à
vrai dire, est maigre et se ressent des restrictions : tartines de
margarine, biscottes, pain d'épices, une poire, mais il est
arrosé de bons vins, en particulier d'un excellent Bordeaux.
Après
avoir remercié et pris congé, nous avons trouvé
chez des employés ou contremaîtres, qui nous ont reçus
avec des attentions touchantes, des lits à l'allemande, avec
des couvertures étroites qu'on ne peut border et des édredons
trop lourds ; nous avons passé une nuit délicieuse.
Tout
notre groupe (plus de 300) est invité pour le lendemain
dans une grande salle de l'usine. Le déjeuner est un véritable
festin : goulache de bœuf avec des knœdels, sortes
de pains de pâté un peu lourds, fromage, bière
et café et, pour terminer, des discours auxquels répondent
les directeurs et qui exaltent l'amitié franco-tchèque.
Maupoil fait son entrée ; il est accueilli par des acclamations
délirantes, embrassé, porté en triomphe.
Dans
le village, toute la population est en liesse ; on nous entoure, on
nous décore de rubans aux couleurs tchèques, qui sont
précisément les nôtres en ordre différent.
Notre
chorale qui, hâtivement, a appris l'hymne tchèque, donne
une aubade qui déchaîne l'enthousiasme général
; nous nous précipitons à la poste pour expédier
des cartes. Le directeur nous donne des timbres, sans nous les faire
payer.
Rentrés
dans nos cantonnements, nous voyons bientôt arriver les premières
troupes russes et nous parlementons, avec l'aide de camp d'un des
nôtres parlant notre langue. Ils prétendaient occuper
nos baraques et nous envoyer coucher à la belle étoile
; heureusement, un officier, après explications, envoya ses
hommes loger dans les maisons du village, en dehors de nos barbelés.
Le lendemain, ils étaient partis, mais d'autres leur succédèrent
et chaque fois, ce furent des pourparlers pour éviter l'expulsion.
Les
soldats faisaient preuve d'une indiscipline absolue ; leur première
distraction fut de jeter des grenades dans l'étang pour se
procurer du poisson ; quand ils rencontraient l'un des nôtres,
isolé, ils le dépouillaient, sans ménagement
et sous la menace de la mitraillette, de tout objet de valeur, montre,
bague, etc. Nous n'osions plus guère sortir et aspirions à
quitter, le plus tôt possible, cette zone indésirable.
Nous
avons vu défiler à Tynce de nombreux convois, artillerie
et camions, charrettes et voitures de ferme, cabriolets, landaux,
le tout chargé de soldats, de bagages, d'armes ; faisant penser
aux hordes d'Attila ou de Tamerlan ; les races les plus diverses sont
représentées : larges figures écrasées
de Kalmouks, jaunes aux yeux bridés, des visages de brutes
primitives et des physionomies distinguées de Russes blancs,
accoutrés d'uniformes hétéroclites avec des coiffures
de toutes sortes, allant du calot à la casquette de fourrure.
Tout
passe devant nos yeux sous les vivats de la foule qui agite des drapeaux.
Quelques communistes de notre groupe se croient tenus de les saluer,
le poing fermé ; mais c'est, sans doute, un signe inconnu d'eux,
car ils répondent, souriants, la main largement ouverte et
des nez se baissent sous nos regards moqueurs.
Aux
grand'haltes, les chevaux sont lâchés dans les blés
mûrissants ; les véhicules eux-mêmes, sortis de
la route, sont rangés à côté, sans souci
des cultures. Pourtant, le pays qu'ils foulent, c'est une nation amie,
qui les accueille cordialement ; nous commençons à nous
rendre compte que nous sommes en présence d'une bande de sauvages
qui volent, pillent, au besoin tuent… Dans certaines maisons
ils ont expulsé les hommes et conservé les femmes !
Quelques
jours plus tard, un directeur d'usine nous disait : « Nous avons
été réquisitionnés par les Allemands,
nous le sommes aujourd'hui par les Russes et nous n'avons probablement
pas gagné au change ».
Le
14 mai de bonne heure, les cars viennent nous chercher.

Le
voyage de retour
Les
cars nous déposent à Prague où nous avons le
temps d'aller visiter l'église de la Vierge noire et du petit
enfant Jésus.
Le
vieil Hôtel de Ville est en ruines, mais le pont avec ses statues
et la tour sont intacts ; sur les façades de petits reposoirs
avec des fleurs, en hommage aux morts.
Le
15 nous sommes à Pilsen, la métropole de la bière
; mais nous n'en trouvons pas un verre à boire. Les rues sont
larges comme celles d'une capitale ; en ville on nous aborde,
on nous questionne en tchèque, parfois en allemand, rarement
en français, on nous offre des tickets de pain, parfois même
de l'argent.
Je
cherche en vain à acheter des souvenirs ; les magasins n'ont
plus rien, ni vases, ni bibelots, ni mouchoirs ; les vitrines sont
encore plus vides qu'en France ; je dois me contenter de cartes postales.
On est très bien reçu, à condition de s'exprimer
d'abord en français que presque personne ne comprend ; on s'explique
ensuite en allemand.
C'est
un spectacle touchant et réconfortant, à la fois, de
constater combien notre pays a conservé de rayonnement et de
sympathie dans cette contrée, loin de nous, malgré notre
défaite, malgré la diminution de la puissance française,
malgré Munich ; un avocat me fait doucement remarquer que nous
les avons bien abandonnés, mais il corrige aussitôt cette
critique, en ajoutant : « Nous vous aimons bien tout de
même et nous admirons la France ».
Après
le dîner, nous organisons, sur la grande place, un concert de
notre chorale qui exécute la Marseillaise et l'hymne
tchèque. Un membre de la municipalité qui a habité
quelque temps Paris nous adresse, d'une fenêtre, un long discours
en français auquel Maupoil répond et on se sépare
après avoir serré de nombreuses mains.
Le
lendemain des camions découverts nous emmènent et nous
débarquent blancs de poussière à Würtzbourg,
après être passés le long des remparts de la ville
de Nuremberg, complètement détruite. Nous sommes dans
une ancienne caserne où grouille une bande d'anciens prisonniers
et de déportés ; les chambres sont dans un état
de saleté indescriptible ; les lavabos sont remplis de débris
de viande et de déjections.
Heureusement
nous pouvons prendre contact avec le commandant américain qui
met des avions à notre disposition. Splendide voyage.
Notre
dernière vision c'est le spectacle de cette magnifique armée
américaine, innombrables camions automobiles, engins motorisés
; à perte de vue des tas bien réguliers de milliers
de bidons d'essence chacun ; des appareils de tous calibres au repos
et en plein vol. Quelle différence avec l'armée russe
!
Dans
une apothéose de soleil, nous survolons Reims, Sainte-Clotilde,
la Cathédrale, l'Hôtel de Ville… et nous débarquons
au Bourget, où nous sommes reçus à bras ouvert
; on nous distribue des boissons chaudes, des gâteaux, des cigarettes.
Puis des autobus nous transportent en gare.
Et
le 18 mai, à minuit, nous sommes accueillis en gare de Reims
par nos familles, nos amis, M. Schneiter, sous-préfet de Reims…
Tous nous embrassent, nous entourent, nous questionnent. Ce sont des
minutes de douce émotion avant de regagner nos foyers.
Tout
est bien qui finit bien ; mais nous aurions pu y rester, comme les
camarades que nous avons vu mourir à côté de nous.
Nos
santés se sont rétablies.
La
France aussi s'est relevée.
Souhaitons
qu'elle retrouve maintenant, dans des institutions rénovées,
la prospérité, la paix intérieure et extérieure,
et sa place parmi les grandes nations.
En
terminant, je veux, au nom de tous les camarades de notre groupe de Sonderhäftlinge, remercier du fond du cœur la Croix-Rouge
suédoise, le capitaine Folke et l'infirmière, Mademoiselle
Björke à qui nous devons, pour une bonne part, le bonheur
d'avoir pu rentrer sains et saufs, dans notre pays, après notre
déportation.


|