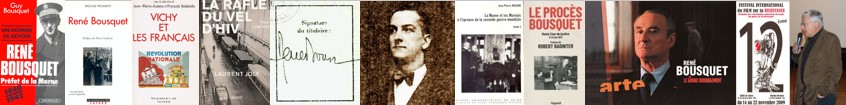René Bousquet devant la Haute Cour de Justice
________________________________________________________________________________________________________________________
De Vichy
à Fresnes
En quittant
la Marne en
avril 1942, pour rejoindre LAVAL
à Vichy au poste de secrétaire
général à la Police de Vichy, René
BOUSQUET avait
cru qu'il pourrait continuer de sauver ce qui pouvait l'être,
comme il avait le sentiment d'avoir réussi à le faire
dans ce département.
Mais les enjeux n'étaient pas les mêmes
et ne se situaient plus à la même échelle.
En négociant directement avec les plus hauts
dignitaires nazis, OBERG,
le chef des SS et de la police allemande en France, HEYDRICH,
le chef de l'Office central de sûreté du Reich ( RSHA
) rencontré à Paris en
mai 1942, le Reichsführer SS
HIMMLER lui-même, en
avril 1943, il
a été pris dans un engrenage qui l'a amené à toujours céder
un peu plus aux Allemands.
Bien qu'ayant été renvoyé
en décembre
1943, arrêté
par les Allemands en
1944 et placé
en résidence surveillée en Allemagne à
la fin de la guerre, BOUSQUET
n'a pas échappé aux poursuites à son retour en France
en
mai 1945, et a reçu
à cette occasion l'appui de nombreux amis marnais qui
ont accepté de témoigner en sa faveur.
Il a été traduit, tardivement il est vrai, devant
la Haute
Cour de Justice qui a rendu hommage à l'ancien préfet
la Marne avant d'acquitter l'ancien secrétaire général
à la Police.
Les Allemands
s'étaient d'abord bien entendus avec lui, au moins jusqu'au
printemps 1943, époque où SCHLEIER,
collaborateur de l'ambassadeur d'Allemagne Otto
ABETZ, rendait compte de l'entrevue de BOUSQUET
avec HIMMLER
en ces termes :
« Le
Reichsführer a été impressionné par la personnalité
de Bousquet. Il partage désormais manifestement la conception
représentée jusqu'ici par Oberg, à savoir que
Bousquet est un collaborateur précieux dans le cadre de la
collaboration policière, et qu'il serait un adversaire dangereux
s'il était poussé dans un autre camp » (1).
Le consul
général Krug
VON NIDDA notait quant à lui :
« Bousquet
s'est déclaré très satisfait de la compréhension
qu'a témoignée à l'égard de la France
le Reichsführer SS, compréhension qui dépasse encore
celle manifestée par Heydrich. Himmler s'est exprimé d'une façon
positive sur l'activité de Bousquet et lui a demandé
de continuer comme il l'avait fait jusque-là » (2).
Mais, à
partir de la fin du mois de mai 1943, les Allemands ont
commencé à s'interroger sur l'opportunité de remplacer BOUSQUET,
tout en constatant qu'ils ne pouvaient pas l'éliminer immédiatement,
parce qu'il aurait fallu plusieurs mois pour que son successeur devînt
aussi précieux que BOUSQUET l'avait été pour eux avec toute son expérience.
En
décembre 1943, ils ont finalement exigé
que BOUSQUET soit limogé et remplacé par le chef de la Milice, Joseph
DARNAND, lui reprochant, entre autres griefs, d'avoir
laissé se développer le maquis.
En réalité, il a été
simplement placé en position de disponibilité et a continué
de recevoir un traitement (3).
En
avril 1944, plusieurs
journaux collaborationnistes, à la suite de l'arrestation
d'un dénommé Bousquet dans la région de Clermont-Ferrand, croyant qu'il
s'agissait de l'ex-secrétaire général à
la Police, ont
annoncé par erreur son arrestation et son incarcération
à Fresnes (4).
De passage à Châlons-sur-Marne le
1er mai 1944, alors qu'il rentrait à Paris venant
de sa « gentilhommière » d'Heiltz-le-Hutier, René
BOUSQUET, questionné par un pompiste sur sa prétendue
incarcération, répondit en souriant : « On
m'a accordé une permission de quelques heures »,
propos immédiatement transmis à Vichy par les Renseignements
généraux de la Marne (5).
Le
9 juin 1944, au lendemain du débarquement allié
de Normandie, il a été arrêté par la
Gestapo à Paris et mis au secret à Neuilly (6).
Le National
Populaire du 24
juin 1944, sous le titre « Une
situation régularisée », a
affiché sa satisfaction de constater que BOUSQUET était « maintenant
considéré et traité en définitive pour
ce qu'il était, c'est-à-dire pour l'organisateur
du maquis en France ».
Il a été transféré en Allemagne dans des conditions honorables,
puisque le voyage s'est fait dans une voiture conduite par un des chauffeurs
particuliers d'OBERG (7) et qu'il a été placé en résidence surveillée à
Ober-Allmannshausen en Bavière, dans une villa où avait
été relégué avant lui le comte CIANO,
gendre de MUSSOLINI. Sa femme et son fils Guy,
accueillis dans une famille marnaise amie après son arrestation,
ont été invités à l'accompagner. Son frère Louis,
travailleur en Allemagne, a été muté dans
une ferme voisine et autorisé à le rencontrer (8).
BOUSQUET a été révoqué
sans pension le
6 décembre 1944 par le Gouvernement provisoire,
sur la proposition de la Commission d'épuration du ministère
de l'Intérieur (9). Le
22 janvier 1945, le Procureur général MORNET a signé contre lui un
réquisitoire aux fins d'information. Par une ordonnance
du 6
mars 1945, le président du Tribunal de la Seine a placé
ses biens sous séquestre, y compris sa résidence
secondaire d'Heiltz-le-Hutier, située dans un petit village
proche de Vitry-le-François où il avait été
sous-préfet (10). Dès son retour d'Allemagne où il a
été libéré par les Américains, BOUSQUET a été mis sous mandat de dépôt et écroué
à Fresnes le
18 mai 1945. Bien que les premières
procédures contre lui aient commencé dès
octobre 1944 à Marseille où il était
impliqué dans la destruction du Vieux Port, l'instruction
de son procès a traîné en longueur, tant et si bien que
l'ancien secrétaire général à la Police
a été une
des dernières personnalités du régime de Vichy
à être traduite devant la Cour
de Justice (11).

La Haute
Cour de Justice
La Haute
Cour de Justice a été créée,
conformément à l'Ordonnance
du 18 novembre 1944, pour juger PÉTAIN, LAVAL et les cent huit ministres, secrétaires d'État, secrétaires
généraux, délégués généraux,
gouverneurs généraux de l'Empire qui ont accepté
de servir l'État français instauré par « le vainqueur
de Verdun » à Vichy en
juillet 1940. BOUSQUET en faisait partie.
Elle était initialement composée de vingt-sept
membres et elle était présidée
par trois juges (un président et deux vice-présidents) nommés par le ministère de la Justice, assistés
de vingt-quatre
jurés tirés au sort sur deux listes établies
par l'Assemblée consultative provisoire : la première
au sein même de cette assemblée issue de la Résistance ;
la seconde parmi les députés et les sénateurs
qui avaient voté contre les pleins pouvoirs à PÉTAIN
en juillet 1940 (12).
Conformément à la loi
du 19 avril 1948 (13), la Haute Cour
de Justice qui a jugé BOUSQUET
en 1949 ne comptait plus que quinze
membres. Son président et les deux vice-présidents
étaient désormais élus
par l'Assemblée nationale à la majorité
absolue et au scrutin secret. Pour chaque affaire, le président procédait
au tirage
au sort de douze jurés titulaires et de douze jurés suppléants,
parmi une liste de parlementaires désignés en leur sein
par les différents groupes selon la règle de la proportionnelle. Selon la nouvelle procédure, non seulement
les listes de jurés, mais aussi les jurys eux-mêmes étaient proportionnels
au nombre de parlementaires dont disposait chaque
parti politique à l'Assemblée (14). Les délibérations étaient secrètes. Si l'ensemble des jurés d'un même groupe
venaient à être défaillants, ils étaient
remplacés par des jurés des autres groupes (15).
Le
1er mai 1948, à l'issue de l'élection des
deux vice-présidents, Jacques
DUCLOS, au nom du groupe communiste, dénonça
violemment les modifications apportées à l'organisation
de la Haute Cour, protesta contre « l'ostracisme et la
partialité » manifestés selon lui par l'Assemblée
nationale à l'encontre du candidat communiste à la vice-présidence, KRIEGEL-VALRIMONT,
à qui elle avait préféré Edgar
FAURE, et annonça la démission
collective des jurés communistes, motivée
en ces termes :
« La
majorité de l'Assemblée a écarté un élu
communiste de la vice-présidence de la Haute Cour, donnant
ainsi la fâcheuse impression d'obéir aux injonctions
du traître Xavier Vallat [...]
Le groupe communiste, refusant de s'associer à
une oeuvre caractérisée par la mise en liberté
des collaborateurs et par les poursuites contre les Résistants,
a décidé de ne désigner aucun membre pour figurer
sur la liste des jurés de la Haute Cour.
En conséquence, les jurés membres
du groupe communiste vous adressent une lettre de démission
collective [...]
Le groupe communiste a conscience [...] de respecter
la volonté profonde de l'immense majorité des Français
patriotes qui ne se considéreront pas comme engagés
par les jugements scandaleux qui pourront intervenir à la suite
des modifications apportées à la composition et au fonctionnement
de la Haute Cour » (16).
Après l'exclusion en mai 1947 des ministres
communistes
du gouvernement présidé par le socialiste RAMADIER, le PCF certes encore puissant s'est trouvé à nouveau isolé. L'anticommunisme reprenant le dessus, d'anciennes
solidarités se sont renouées autour de BOUSQUET qui a été remis
en liberté provisoire le
1er juillet 1948.
Le
21 juin 1949, BOUSQUET a été enfin traduit devant
la Haute Cour de Justice dont la composition reflétait
bien les
changements intervenus depuis la Libération (17). Elle était présidée par le
socialiste Louis
NOGUÈRES, assisté d'un membre du Parti républicain
de la liberté (PRL), nouvelle appellation de la droite
parlementaire, et d'un membre de l'Union démocratique et socialiste
de la résistance (UDSR).
Le
jury était composé exclusivement de représentants
des partis soutenant les gouvernements de Troisième force qui
tentaient depuis
1947 de gouverner au centre en rejetant dans l'opposition
communistes et gaullistes : quatre MRP (Mouvement républicain
populaire), quatre socialistes, un UDSR, un républicain indépendant,
un membre du Centre Républicain d'Action Paysanne et Sociale,
et un radical-socialiste Jean
BAYLET, un ami de BOUSQUET qui appartenait à la mouvance de La
Dépêche de Toulouse devenue La
Dépêche du Midi, mouvance dont BOUSQUET lui-même était issu.
L'acte
d'accusation de 25 pages, dressé par le procureur
général FRETTE-DAMICOURT le 8 février
1949, s'ouvrait sur un
véritable panégyrique de l'action de BOUSQUET dans la Marne, brossé en quelques lignes définitives :
« Sous-Préfet
de Vitry-le-François en avril 1938, il était au début
de la guerre Secrétaire général de la Préfecture
de la Marne, où il fut maintenu affecté spécial ;
il n'en partit que le 15 juin 1940, après l'occupation allemande,
et fut alors décoré de la Croix de Guerre (18). Il y reprit ses fonctions au début de juillet,
fut nommé Préfet de la Marne le 17 septembre 1940, et
Préfet Régional un an plus tard. Dans ces deux postes, il se révéla
un excellent administrateur, habile et ferme, qui négocia avec
l'occupant au mieux des intérêts français. Fidèle à ses opinions républicaines,
il maintint ou fit rétablir dans leurs fonctions les Assemblées
et les élus du département. Il intervint en faveur des Israélites, des
francs-maçons, des syndicalistes et des communistes, évita
des sanctions à la population et parvint, par des fausses statistiques,
à limiter les impositions de l'occupant. Il favorisa les évasions de prisonniers du
Camp de Châlons, enfin, il créa toute une organisation
agricole qui permit de faire échec à l'arbitraire des
réquisitions des occupants, et aux tentatives d'exploitation
collective des fermes par les Allemands. Il apparaît donc que, pendant toute cette
période de sa vie administrative, rien ne puisse être
reproché à Bousquet » (19).
Il était
bien clair que BOUSQUET n'était pas poursuivi en tant qu'ancien
préfet régional de Châlons-sur-Marne,
comme l'attestait d'ailleurs la conclusion de l'acte d'accusation
:
« En
conséquence, le sus nommé est accusé d'avoir,
en France, en 1942-1943, en tout cas depuis un temps non prescrit :
1/ - en tant que
secrétaire général à la Police du Gouvernement
de fait, postérieurement au 16 juin 1940, sciemment apporté
une aide directe ou indirecte à l'Allemagne et à ses
Alliés et porté ainsi atteinte à l'Unité
de la Nation, à la Liberté des Français, et
à l'égalité entre ces derniers.
2/ - Sciemment accompli,
en temps de guerre, des actes de nature à nuire à
la Défense Nationale.
Infractions prévues et punies par les articles
1er et suivants de l'Ordonnance du 26 décembre 1944, paragraphe
4 du Code Pénal.
Fait au Parquet Général de la Haute Cour de Justice
À Paris le 8 février 1949
Le Procureur Général » (20)
Le ton
généralement modéré du procureur
général FRETTE-DAMICOURT,
parfois même complaisant à l'égard de l'inculpé, qui se dégageait
de la lecture d'un acte d'accusation retenant finalement beaucoup d'éléments à mettre
à son crédit, encouragea BOUSQUET qui assura
lui-même sa défense, tout au long des trois
jours que dura son procès, avec l'aide de Maurice
RIBET. Ce dernier avait été l'avocat d'Édouard
HERRIOT au procès de Riom au cours duquel le régime
de Vichy avait mis en accusation les dirigeants de la Troisième
République.
Les lauriers que lui avait tressés le procureur
général dans l'acte d'accusation, pour son action dans
la Marne, confortaient BOUSQUET dans sa conviction qu'il fallait jouer la
carte marnaise. Celle-ci constituait assurément son meilleur
atout face au jury de la Haute Cour qu'il a réussi à
leurrer. Il reste qu'on ne peut s'empêcher de s'interroger
sur la bienveillance à l'égard de BOUSQUET qu'a manifestée tout au long du procès le procureur
général FRETTE-DAMICOURT. Certes ce dernier avait été relevé
de ses fonctions de procureur au tribunal de la Seine par le régime
de Vichy dès
novembre 1940, sans
doute parce qu'il était franc-maçon et admis
à la retraite en
1941, mais il avait été avant-guerre conseiller
technique du garde des Sceaux sous le Front populaire, époque
où BOUSQUET lui-même s'était vu confier la
direction du fichier central de la Sûreté. On peut légitimement se demander s'il n'a pas, plus ou moins
consciemment, fait preuve d'« une
sorte de solidarité de corps » envers
un haut fonctionnaire pour lequel, en dépit des circonstances,
il conservait de l'estime (21).

L'instruction : les Marnais témoignent
Lorsqu'à son retour d'Allemagne, BOUSQUET a commencé d'organiser sa défense, il a bien
compris d'emblée tout l'avantage qu'il pourrait tirer de l'image
de grand préfet que bon nombre de ses amis marnais étaient
prêts à cautionner par leurs témoignages.
Le
11 juin 1945, il a remis à la Commission
d'instruction de la Haute Cour une note rédigée
de sa main et intitulée « Mon
action de juin 1940 au mois d'avril 1942 ». Il y exposait quelle était la
situation de la Marne en
juin 1940, quels avaient été ses
projets au moment du retour de l'exode, ce qu'avait été son action comme secrétaire général, préfet puis
préfet régional, et il concluait en ces termes :
« Je
peux donc affirmer sans crainte d'être contredit, qu'au moment
où je quittais le département de la Marne :
- l'économie et les finances départementales
étaient restaurées,
- le ravitaillement assuré,
- le cheptel reconstitué,
- les stocks de champagne sauvegardés ( 120 millions de bouteilles environ ),
- l'Administration française respectée
et aussi indépendante que possible,
les sanctions collectives évitées,
- les intérêts individuels ou
particuliers défendus,
- l'unité française maintenue
ou renforcée,
- les plans de reconstruction approuvés,
- les sinistrés abrités.
Les regrets que manifestait la population à
l'annonce de mon départ paraissaient égaux à
ceux que j'éprouvais moi-même en abandonnant une région
où, du fait de mes administrés, je n'avais connu que
des satisfactions.
Je tiens à la disposition de l'Instruction
les preuves de cette affirmation.
Le 11 juin 1945.
René BOUSQUET » (22)
Tout au long de l'été
1945, BOUSQUET a
mobilisé ses amis marnais, suscité des témoignages
et des attestations favorables. C'est ainsi que son dossier s'est rempli de soixante-dix
témoignages de personnalités marnaises qualifiées,
de toutes obédiences, y compris de chefs de la résistance,
parmi lesquelles ont été recensées vingt-sept
attestations favorables adressées directement et
spontanément au juge d'instruction (23),
et vingt-sept
auditions de témoins entendus à la demande de l'inculpé,
mais hors de sa présence, en vertu d'une Commission
rogatoire du président de la commission d'Instruction
près la Haute Cour de Justice (24).
Les témoins
entendus sur commission rogatoire à la demande de BOUSQUET,
parmi lesquels se trouvaient plusieurs résistants en vue dont certains venaient
de rentrer de déportation, ont tous fait des déclarations qui
corroboraient largement le mémoire en défense déposé par BOUSQUET en juin
1945, et qui faisaient son éloge en utilisant souvent
les mêmes termes : « vrai
Français comme il en aurait fallu beaucoup en ces temps difficiles »,
« patriote », « républicain
sincère », « grand préfet »,
« excellent administrateur », « intelligent »,
« énergique », « digne »,
« habile défenseur des intérêts français
et marnais qui a roulé les Allemands », « protecteur »,
« homme dévoué qui avait rendu beaucoup de
services », « un ami sûr pour les Marnais ».
Tous tendaient à accréditer l'idée
qu'au
moins dans la Marne et pourquoi pas après son passage
dans ce département, BOUSQUET n'avait jamais au fond de lui-même adhéré au régime
de Vichy, qu'il était resté un
républicain convaincu et qu'il avait habilement
joué le double jeu.
La plupart des auditions effectuées dans
la Marne à la demande de la Commission d'instruction de la
Haute Cour, auprès de « membres
du personnel de la préfecture, d'interprètes, de personnes
qui, par leur action dans la résistance, devaient être
à même de pouvoir citer les faits qui pouvaient constituer
des charges contre l'inculpé » n'ont guère contribué à infirmer les propos des témoins entendus
à la demande de BOUSQUET ; beaucoup
allaient dans le même sens (25).
Quelques
résistants ont émis certaines
réserves et ont souligé le caractère « ambitieux et arriviste » de BOUSQUET. Un seul, Pierre
DECLEY, ancien adhérent du Parti social français
avant-guerre, qui avait rejoint le Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, mouvement de résistance créé par les communistes, et qui présidait de la
Commission du NAP (Noyautage des administrations publiques) du Comité départemental de libération nationale (CDLN) de la Marne, a pris clairement position contre BOUSQUET, affirmant
catégoriquement :
« Après
la libération, en tant que président de la Commission
du NAP, j'ai eu en main, divers documents (dépositions ou
rapports) qui permettent de dire que M. Bousquet a eu une politique
franchement collaboratrice pendant le temps où il a exercé
des fonctions administratives dans le département de la Marne.
Les documents que j'ai eu en mains, ont été envoyés
au Ministère de l'Intérieur à Paris » (26).
Ces propos n'ont pas été pas retenus, ni même
évoqués lors du procès, tant
étaient nombreux, concordants et impressionnants les témoignages
de résistants favorables à René
BOUSQUET.
[Pierre Decley est né le 7 mars 1905 à Paris. Courtier remisier domicilié à Reims, il a participé fin 1940 à des évasions de prisonniers français vers la zone non occupée. À partir de juillet 1941, il a servi d'agent de liaison à un réseau SOE Buckmaster implanté à Lyon jusqu’au démantèlement de ce réseau en janvier 1943. De retour à Reims, il a adhéré en juin 1943 au Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France, mouvement créé par les communistes, mais ouvert à toutes les sensibilités de la Résistance. Il y a retrouvé plusieurs de ses anciens camarades du Parti social français (PSF) où il avait milité avant-guerre, et s'est mis aux ordres de l’un d’entre eux, Georges Dompmartin, un des responsables marnais de ce mouvement. Il a participé à l’hébergement et à l’évacuation d’aviateurs alliés. En juin 1944, après l’arrestation de Dompmartin, il a siégé au Comité départemental de la libération nationale (CDLN) de la Marne. Il a servi de boîte aux lettres et a mis son appartement à la disposition de l'état major FFI de la Région C. Il a recruté pour la 1ère Compagnie FTPF, a participé à son armement, et a facilité son intégration au sein des FFI. Il a établi les premiers contacts de la résistance rémoise avec Marcel Grégoire-Guiselin, nommé commissaire régional de la République fin juin 1944.
Après la Libération, il a présidé la commission du NAP (Noyautage des administrations publiques) créée au sein du CDLN, ainsi que la Commission départementale d’épuration. C’est à ce titre qu’il a adressé au juge d’instruction de la Haute Cour de Justice une attestation dans laquelle il déclarait « avoir eu en main divers documents qui permettent de dire que René Bousquet a eu une politique franchement collaboratrice pendant le temps où il a exercé des fonctions administratives dans le département de la Marne », et avoir adressé ces documents restés sans suite au ministère de l’Intérieur à Paris. Cette déposition ne sera même pas évoquée devant la Haute Cour de Justice en 1949, lors du procès de l’ancien préfet de la Marne, au cours duquel par contre seront signalés les très nombreux témoignages en faveur de Bousquet, émanant de notables marnais de toutes sensibilités, y compris des responsables de la résistance. Pierre Decley a été homologué FFI et a reçu le titre de Combattant volontaire de la Résistance avec la mention mention RIF (Résistance intérieure française). À l’époque de la guerre froide, Pierre Decley a rompu avec ses camarades du Front national et a rejoint le mouvement gaulliste Ceux de la Résistance (CDLR) dont il est devenu le vice président départemental en 1950. Président des Combattants volontaires de la Résistance de la Marne en 1963, il s’est investi dans la promotion du Concours national de la Résistance et de la Déportation dans la Marne].
Deux
gaullistes, le lieutenant Jean
CHABOT (27) de
Reims et le chef de bataillon Lucien
SITTEWELLE (28) de
Vitry-le-François, ont attesté qu'arrêtés par
les Allemands pendant l'occupation, le premier en
1941, le second en
1943, ils avaient été libérés à la suite d'une intervention de BOUSQUET.
Lucien
PAUL, fondateur
et chef départemental du mouvement de résistance Ceux de la Libération (CDLL), qui rentrait de déportation,
a déclaré tout net : « Pour
moi M. Bousquet était un patriote indiscutable ; il fallait
un homme comme lui pour tenir tête aux Allemands comme il l'a
fait. Il les a roulés chaque fois qu'il a pu ». Cette
déclaration formulée lors de son audition comme témoin,
a été ultérieurement complétée, sans doute à
la demande de BOUSQUET,
par une lettre dactylographiée dans laquelle Lucien PAUL écrivait
:
« Je
tiens à vous renouveler ma foi profonde dans le patriotisme
sans tache de René Bousquet, et je ne mets pas en doute qu'après
plus d'un an d'instruction, son innocence apparaisse clairement et
qu'il soit possible à la Haute Cour de prendre la décision
que ses nombreux amis marnais et moi-même attendons avec confiance
et impatience » (29).
Le docteur Paul
LAGEY, en relation amicale avec BOUSQUET depuis son arrivée à Châlons en
1939, prisonnier de guerre libéré en vertu
des accords Scapini, responsable
du mouvement de résistance Ceux de la Résistance (CDLR) arrêté en septembre
1943 par la Gestapo alors que BOUSQUET était encore secrétaire général à
la police de Vichy, déporté
à Buchenwald en
janvier 1944, a affirmé tout aussi catégoriquement
qu'il n'y avait rien à reprocher à BOUSQUET :
« À
mon retour de captivité en février ou mars 1941, M.
Bousquet qui était devenu préfet de la Marne, alors
que je lui exposais que tout ne me semblait pas perdu, me dit que
la victoire de l'Allemagne ne faisait aucun doute et qu'en conséquence
il fallait chercher à sauver le maximum de ce qu'on pouvait
sauver et que les Français étant plus intelligents que
les Allemands, nous arriverions bien à les rouler d'une façon
et d'une autre.
En tant qu'adjoint du chef du groupe Ceux de la
Résistance, secteur de Châlons-sur-Marne, j'aurais eu
connaissance d'actes antinationaux de M. Bousquet s'il en avait commis
dans l'exercice de ses fonctions.
Tant que M. Bousquet a été préfet
puis préfet régional, jamais nous n'avons eu connaissance
de faits à lui reprocher » (30).
Pierre
BOUCHEZ (31), chef départemental
des Forces françaises de l'intérieur (FFI) et président
du Groupement interprofessionnel des syndicats patronaux,
estimait que l'activité du préfet de la Marne, au point
de vue économique, avait été « profitable » et qu'il avait « reçu
le meilleur accueil » auprès du secrétaire
général à la Police, lorsqu'il était intervenu
auprès de lui en
octobre 1942 à la suite de la condamnation à
mort d'un gendarme (32).
[Pierre Bouchez est né le 29 octobre 1899 à Reims. Fils d’un industriel rémois du textile, il a fait ses études au lycée de Reims puis à Jeanson de Sailly à Paris. En 1917, il s’est engagé dans le 8e Régiment d’artillerie et a participé aux combats de Champagne. Sous-lieutenant en 1918, il a été chargé après l’armistice de l’identification des soldats morts. Devenu à son tour industriel à la tête de l’entreprise familiale, il a présidé le Groupement des syndicats patronaux de Reims et de la région. Ce syndicat patronal avait été créé en 1936, à l’époque du Front populaire, à l'initiative du président de la Chambre de commerce de Reims, Bertrand de Mun – ancien député de l'Alliance républicaine et proche des Jeunesses Patriotes de Pierre Taittinger dans les années 1920 –, pour négocier pied à pied des conventions collectives avec les syndicats ouvriers. Officier de réserve, Pierre Bouchez a rejoint en 1939 le 24e Régiment d’artillerie à Châlons-sur-Marne et son action lui a valu une citation à l’ordre de l’armée et la Croix de guerre avec palmes. En 1940, Pierre Bouchez a été confirmé par les autorités de Vichy à la tête de l’organisation patronale rémoise rebaptisée Groupement interprofessionnel des syndicats patronaux de Reims et de la région. Il a entretenu des rapports cordiaux avec les représentants du gouvernement de Vichy dans la Marne : l'intendant régional des Affaires économiques, Charles Célier, qu'il a invité à Reims en mars 1942, pour y présenter les objectifs économiques de la politique régionale de Vichy ; le préfet René Bousquet, futur secrétaire général à la Police, en faveur duquel il a accepté après la guerre de témoigner devant la Haute Cour de justice ; le préfet Louis Peretti della Rocca, successeur de Bousquet dans la Marne, qu'il a reçu à sa table.
Dans le même temps, il a participé à la Résistance : de 1940 à 1942, il appartenaitt au service de renseignement SR Kléber, puis il a rejoint en novembre 1942 le groupement rémois de Ceux de la Résistance (CDLR), lié au groupement châlonnais de Ceux de la Libération (CDLL). Au cours de l'été 1943, Pierre Bouchez a été pressenti pour figurer sur une liste des personnalités à mettre en place dans la Marne en vue de la Libération et proposé pour le poste de commissaire de la République. Le 28 décembre 1943, lorsque la Gestapo est venue l’arrêter, il est parvenu à s’échapper et il est passé à la clandestinité, tandis que son adjoint, Jacques Détré, a été incarcéré et torturé à mort à la prison de Reims. Après le départ pour Londres du chef départemental de CDLR, Henri Bertin, et l’arrestation de membres de l’organisation fin 1943-début 1944, sur les conseils d'André Schneiter, responsable BOA-CDLR du secteur de Reims, Pierre Bouchez a été pressenti par André Schock, délégué militaire de la Région C, pour prendre le commandement des FFI de la Marne. Cette nomination a été confirmée en mai-juin 1944 par le colonel Grandval, chef de la Région C. À partir de février 1944, Pierre Bouchez a siégé au sein du Comité départemental de libération nationale (CDLN) de la Marne au titre de CDLR. Le 2 septembre 1944, au lendemain de la libération de la ville, il a été nommé commandant militaire de la place de Reims, fonction qu’il a exercée jusqu’au 30 décembre 1945. Pierre Bouchez, dans le rapport consigné dans son journal de marche à la date du 25 septembre 1944, est pour le moins laconique et en même temps très satisfait de son action à la tête des FFI de la Marne, tandis que le colonel Grandval a formulé après la guerre sur cette action un certain nombre de réserves.
Le commandant Pierre Bouchez a été un chef départemental des FFI contesté au sein de la Résistance marnaise, mis en cause dans la disparition de pièces d’or parachutées, la rétention d’armes et l’exécution en octobre 1944 de Simone Baudoin, une collaboratrice rémoise en attente de jugement et enlevée illégalement de sa cellule de la clinique Mencière. Ayant affronté les syndicats et les partis marxistes à l'époque du Front populaire, il considérait qu'il était dangereux de fournir des armes aux groupements de résistance d’obédience socialiste, communiste ou cégétiste. Au Front national de lutte pour l’indépendance de la France, chez les FTPF, à Libération-Nord, la rumeur courait selon laquelle, le chef départemental des FFI donnait comme consigne à ses amis de bien conserver et cacher les armes qu’il destinait à servir après la guerre pour contrer une éventuelle prise du pouvoir par les communistes. Pierre Bouchez a été homologué FFC (Forces françaises combattantes) au titre du réseau SR Kléber, et il a reçu le titre de Combattant volontaire de la Résistance avec la mention FFI, ainsi que la Médaille de la Résistance.
Après la guerre, devenu directeur gérant de L'Union, organe du CDLN de la Marne, Pierre Bouchez a entrepris de longues et laborieuses négociations avec Paul Marchandeau, ancien ministre et maire radical de Reims, en même temps que président-directeur général du journal L'Éclaireur de l'Est suspendu à la Libération. Ces négociations ont abouti en 1953 à un accord financier de compromis autorisant le journal L'Union à prendre possession des locaux et du matériel saisis en 1944 au siège de L'Éclaireur de l'Est.
En 1962, Pierre Bouchez a épousé Germaine Charlot, fille du gendarme Édouard Charlot, gendarme résistant qui avait été guillotiné le 4 janvier 1943 à la prison de Cologne. Décédé en 1982, Pierre Bouchez a été inhumé à Warmeriville. À Reims, la partie des Hautes promenades où a été implanté le Monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation, porte depuis 1987 le nom d’Esplanade du colonel Bouchez. Une stèle à sa mémoire y a été érigée.]
Irénée
DLÉVAQUE, enseignant révoqué par BOUSQUET pour outrages
au maréchal Pétain en
1941, responsable
du mouvement de résistance Libération-Nord créé dans la mouvance du Parti socialiste et maire de Châlons-sur-Marne
à la libération, a déclaré qu'à son avis,
il n'y avait « rien
à reprocher » à BOUSQUET pendant la période où il avait exercé les fonctions
de secrétaire général, de préfet et de
préfet régional et que d'une façon générale,
dans ses rapports avec les Allemands, « il
avait toujours défendu les intérêts français » (33).
C'est
ce qu' a confirmé Émile
PETITJEAN (34), chef du service des interprètes à la préfecture,
membre du groupe de résistance Bleu
et Jonquille, déporté
en 1944, et Charles
RUPP (35),
un résistant d'origine lorraine devenu à la Libération
délégué régional du ministère des
prisonniers, qui avait assisté en tant qu'interprète
aux négociations entre BOUSQUET et les autorités allemandes.
Les
personnalités qui avaient assumé la charge de maire
sous l'occupation dans les villes les plus importantes
du département, telles que le docteur Joseph
BOUVIER (36) à Reims ou encore Louis
BUDIN (37) à Épernay, se
montraient bienveillants, tandis qu'à Châlons-sur-Marne, Georges
BRUYÈRE (38) se
souvenait qu'il avait été le « confident » de BOUSQUET et lui conservait toute son « estime », et que Lucien
PRUD'HOMME (39) de Vitry-le-François, rappelait « les
profondes attaches » qui unissaient la population
vitryate à cet « ami
très sûr et dévoué » qu'avait été René
BOUSQUET .
À
la préfecture régionale les chefs de division étaient
unanimes.
Yves
BOUTEILLE, résistant
rentré de déportation, a affirmé que « les
faits et gestes de M. Bousquet n'étaient pas ceux d'un collaborateur » (40).
[Yves Bouteille est né le 7 novembre 1896 à Dunkerque. Domicilié à Saint-Memmie, il était chef de division à la préfecture de la Marne. Fin 1940, il a facilité l’évasion de deux prisonniers de guerre français en leur fournissant des fausses cartes d’identité. Arrêté en mars 1941 par la Feldgendarmerie, il a été libéré sur intervention du préfet Bousquet. En mars 1942, il a rejoint CDLR, était en contact avec Armand Bolot et le groupe Tritant, auquel il a fourni des renseignements et a procuré de fausses cartes d’identité. En 1942, il a prévenu la famille Ast restée à Saint-Memmie que des arrestations de juifs allaient avoir lieu. Affecté à l'équipe BOA du groupe Tritant en mars 1943, il a participé aux parachutages dans la vallée de la Coole sur les terrains Hyène et Rousseau et à des transports d’armes et d’explosifs. Arrêté par la Gestapo à Saint-Memmie le 11 septembre 1943, il a été interné à la prison de Châlons-sur-Marne et déporté comme résistant le 22 janvier 1944 à Buchenwald (matricule 42 185). Transféré le 22 février à Mauthausen, il a été affecté au kommando d’Ebensee. Il a été libéré le 6 mai 1945 et rapatrié le 26 mai. Il a été homologué FFI et FFC (Forces françaises combattantes) au titre du réseau Action D. Il a reçu le titre de
Combattant volontaire de la Résistance avec la mention et DIR (Déporté-interné-résistant) ainsi que la Médaille de la Résistance avec rosette. Décédé le 1er septembre 1974, il est inhumé dans le cimetière de Saint-Memmie].
Selon Gaston ANDRÉ , on ne pouvait « rien
reprocher à Bousquet au point de vue national » ; « son
attitude vis à vis des Allemands était guidée
par le principe suivant : en tirer le maximum et en lâcher le
minimum » (41).
Raoul
SOURIN (42), chef de
bureau déporté à Neuengamme en
juin 1944, était reconnaissant à René
BOUSQUET d'avoir protégé les francs-maçons,
et considérait que c'était un « grand
préfet très intelligent, ayant beaucoup d'initiative
et de caractère » et qu'il s'était
montré « favorable
aux milieux ouvriers », propos confirmés
par Roger
DENIS (43), militant
socialiste et secrétaire général de la Bourse
du Travail de Châlons-sur-Marne.
[Raoul Sourin est né le 2 mai 1903 à Mourmelon-le-Grand. Chef de division à la préfecture de la Marne à Châlons-sur-Marne, il était membre de la Loge La Bienfaisance châlonnaise. Menacé par la législation antimaçonnique de Vichy, il a été protégé et maintenu à son poste par le préfet René Bousquet. Chargé des Affaires du Travail à la préfecture, Raoul Sourin était en contact avec Guyot, directeur du STO à Reims, André Benoît, directeur départemental du Travail et Pierre Boitel, chef du Service départemental de la main d’œuvre de la Marne. Avec leur aide, il a tenté de limiter le nombre de réquisitions pour le STO par la destruction de fichiers et la dissimulation de dossiers. Arrêté par la Gestapo le 13 juin 1944 à la préfecture, il a été incarcéré à Châlons-sur-Marne jusqu'au 20 juin 1944, puis interné à Compiègne comme « personnalité-otage » dans le camp C sous le matricule 41 955. Déporté le 15 juillet 1944 à Neuengamme (matricule 34 479), il a été détenu dans le block dit des « Proéminents ». Le 14 septembre 1944, il a été opéré de l’appendicite par un médecin déporté, le docteur Veyssière, dans des conditions rudimentaires. Membre de l’« Université de Neuengamme » créée par Bertrand de Vogüé, il y a animé la chorale, il a composé la musique du Noël du Prisonnier et a réalisé les décors de la pièce Les Plaideurs interprétée à l’occasion de Noël 1944. Le 12 avril 1945, il a été transféré à Theresienstadt, puis le 30 avril à Brezani, où il a été libéré le 8 mai 1945. Il a été rapatrié en France par avion le 18 mai 1945, et a été accueilli à Paris à l’Hôtel Lutetia. Il figure dans la galerie de dessins publiés en 1946 par Bertrand de Vogüé dans Les aventures de M. Ducancé, ouvrage illustré relatant la vie à Neuengamme des personnalités-otages qui y ont été déportées en juillet 1944.
En août 1945, entendu sur commission rogatoire par le juge d’instruction de la Haute Cour de Justice à la demande de René Bousquet, Raoul Sourin a déclaré être reconnaissant à l’ancien préfet de la Marne d’avoir protégé les francs-maçons et l'a décrit comme un « grand préfet très intelligent, ayant beaucoup d’initiative et de caractère », qui s’était montré « favorable aux milieux ouvriers ».
Raoul Sourin a reçu le titre de Combattant volontaire de la Résistance, mention RIF (Résistance intérieure).]
Les anciens rédacteurs à la préfecture de la Marne Tony
HERBULOT (44) et Maurice
MENNECIER (45), militants
socialistes, membres du mouvement Libération-Nord et sous-préfets
de la Libération, ne connaissaient « aucun
fait positif de collaboration », ni « aucun
acte » de BOUSQUET visés par les articles du Code Pénal et les ordonnances
citées par la commission rogatoire .
Jules
MARTINVAL , directeur
des Services agricoles, a assuré que BOUSQUET avait défendu au mieux « les
intérêts du département sur le plan agricole » (46) .
Les
responsables de la paysannerie marnaise ont tenu le même discours.
Robert
MANGEART, syndic
régional de la Corporation paysanne nommé
par le gouvernement de Vichy, a déclaré :
« Ayant été appelé à Vichy pour une réunion des syndics régionaux, j'y ai rencontré M. Bousquet et je lui ai posé la question suivante : " Êtes-vous devenu sincèrement collaborateur ? ". M. Bousquet m'a répondu textuellement : " Pour la sauvegarde des intérêts français, il est nécessaire qu'au moins les membres du Gouvernement apparaissent aux yeux des Allemands comme étant sincèrement collaborateurs ".
Cette réponse non équivoque, expliquait à mes yeux son attitude et me confirmait dans l'opinion que j'avais de lui : c'est-à-dire qu'il n'était pas favorable aux Allemands » (47).
[Robert Mangeart est né à Lavannes (Marne) le 24 septembre 1900. Agriculteur, père d'une nombreuse famille, formé dans les rangs de la Jeunesse agricole chrétienne (JAC), Robert Mangeart est une personnalité marquante de la paysannerie marnaise. Conseiller municipal de Lavannes avant-guerre, il a aussi été un militant du Syndicat agricole de Champagne, syndicat fondé en 1890, dont la devise était « Cruce et Aratro - Par la Croix et la Charrue ». Partisan d'un rapprochement entre ce syndicat chrétien et l'Union agricole, horticole et vinicole (UAHV), syndicat laïque d'inspiration radicale-socialiste animé par Albert Barré, il a défendu la création en 1938 de l'Union des organisations agricoles de la Marne, présidée par Albert Barré, qui est devenue le point de rencontre des dirigeants syndicalistes agricoles représentant les deux sensibilités, et l'expression d'une solidarité que l'épreuve de la guerre, de la défaite et de l'Occupation ont renforcée. Dès le retour de l'Exode et le début de l'Occupation, il a apporté sa collaboration à René Bousquet, secrétaire général de la Marne, dans la mise en place de responsables agricoles nommés dans chaque canton, pour faire face à la pénurie de main d'œuvre, d'engrais, de moyens de traction,pour assurer les récoltes et faire face aux réquisitions allemandes. Il a fait partie des sept membres de la Commission administrative choisis et nommés par René Bousquet, devenu préfet de la Marne, pour se substituer provisoirement au Conseil général de la Marne dissous à la fin de l'année 1940. En 1941, il a été reçu par le maréchal Pétain, a été nommé délégué général de l'Organisation corporative paysanne mise en place par le gouvernement de Vichy et il a siégé au Comité permanent ainsi qu'au Conseil national de la Corporation paysanne jusqu'en avril 1944, date de sa démission. En février 1942, à l'issue de l'assemblée générale constitutive de l'Union régionale corporative agricole, présidée par le préfet Bousquet, il en a été nommé syndic régional dans la Marne. En 1943, il a fondé à Reims une école d'agriculture qu'il a présidé jusqu'en 1968. La même année, il a été candidat au poste de syndic national de la Corporation paysanne, mais n'est arrivé qu'en seconde position derrière Adolphe Pointier qui a été élu. Dans le même temps il a été nommé par le gouvernement de Vichy membre du Conseil départemental appelé à prendre le relais de la Commission administrative créée par Vichy après la dissolution du Conseil général élu avant-guerre, et il en est devenu un des quatre secrétaires. À la Libération, il a comparu devant le Comité de Libération, et il a été déchu de son mandat de conseiller municipal ainsi que de ses droits civiques, mais il a participé en tant que délégué marnais au congrès constitutif de la Confédération générale de l'agriculture appelée à se substituer provisoirement à la Corporation paysanne dissoute en octobre 1944 par le gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle, et il en est devenu dès sa création un des quatre dirigeants. En mars 1945 il a été élu membre du conseil d'administration de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Marne, par l'assemblée générale constitutive de ce syndicat qui a remplacé la Corporation paysanne, et dont il est devenu ultérieurement le vice-président, puis le président. Réélu en avril 1945 conseiller municipal de Lavannes dès le premier tour sous l'étiquette Union républicaine démocratique, il a été invalidé en raison des responsabilités qu'il avait assumées sous le régime de Vichy au sein de la Corporation paysanne. Entendu comme témoin à la demande de René Bousquet traduit devant la Haute Cour de Justice après la guerre, Robert Mangeart a défendu l'action du préfet de Vichy dans la Marne. En 1946, il a participé au congrès fondateur de la Fédération des syndicats d’exploitants agricole (FNSEA), et à l’issue de ce congrès, il en a été nommé membre du conseil d’administration, et un peu plus tard secrétaire adjoint. En 1947, il a accédé à la présidence de La Providence agricole, une des plus importantes coopératives champenoises. Il a exercé de nombreux responsabilités sous la IVe et la Ve République comme président de La Providence agricole devenue Champagne Céréales et de la Coopérative sucrière de Bazancourt, comme membre du Conseil économique et social, et comme administrateur des hôpitaux, de la caisse départementale du Crédit agricole et de la Mutualité sociale agricole. Dans ses Souvenirs et réflexions publiés en 1982, il assume totalement son engagement au service de la politique agricole de Vichy qui, selon lui, n'a pas été une rupture ni une parenthèse dans son long parcours de responsable agricole marnais, mais au contraire une période d'opportunité qui lui a permis de réaliser « l'unité paysanne, l'unité du monde agricole ».]
Albert
BARRÉ, syndic
régional adjoint, a conclu son témoignage
en ces termes :
« Quand
M. Bousquet a été nommé secrétaire général
à la Police, je lui ai fait part de mon étonnement de
le voir accepter ce poste ; il m'a répondu : " J'ai roulé les Allemands dans la
Marne, je les roulerai encore ".
Au cours des conversations que j'ai eues avec lui
en tête à tête dans son Cabinet, il m'a déclaré
plusieurs fois qu'il ne croyait pas à la victoire de l'Allemagne,
qu'il était persuadé que les Allemands ne pouvaient
pas gagner la guerre » (48).
[Albert Barré est né le 19 février 1894 à Condé-sur-Marne (Marne). Maire de cette commune, maintenu à son poste par le gouvernement de Vichy en 1940, Albert Barré présidait avant-guerre l’Union agricole, horticole et vinicole, syndicat d’inspiration laïque, anticléricale et radicale-socialiste, rival du Syndicat agricole de la Champagne, syndicat d’inspiration chrétienne présidé par Robert Mangeart. Albert Barré présidait également l’Union des organisations agricoles de la Marne constituée en 1938, qui était une structure de concertation entre les responsables des deux syndicats. En juillet 1940, à l’instigation de René Bousquet, secrétaire général du département, qui n’était pas encore préfet, Albert Barré a accepté de fusionner son syndicat avec celui de Robert Mangart au sein d’un Comité d’entente des organisations agricoles de la Marne. Lorsqu’en 1942 le gouvernement de Vichy a créé la Corporation paysanne, il a été nommé Syndic régional adjoint aux côtés de Robert Mangeart. À partir de mars 1943, nommé par le gouvernement de Vichy, il a siégé au sein du Conseil départemental qui s'est substitué à la Commision administrative créée après la dissolution par Vichy du Conseil général élu avant-guerre. À la Libération, il a dirigé L’Union républicaine de la Marne, quotidien d’inspiration radicale-socialiste qui avait cessé de paraître sous l’Occupation. En septembre 1944, il a lancé dans ce journal avec Georges Bruyère, ancien maire de Châlons-sur-Marne nommé par Vichy et ami de Bousquet, une souscription pour l’érection d’un monument destiné à honorer la mémoire des fusillés. En mars 1945, il a présidé l’assemblée générale constitutive de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et il a été élu membre de son conseil d’administration. À l’issue des élections municipales d’avril-mai 1945, il a été réélu maire de Condé-sur-Marne. Entendu comme témoin, il a témoigné à sa demande en faveur de René Bousquet traduit devant la Haute Cour de Justice.
Albert Barré est décédé le 2 février 1959 à Sézanne. Une rue porte son nom à Condé-sur-Marne.]
Paul
PÉRARD, agriculteur
et maire de Cernay-les-Reims, a confirmé que BOUSQUET avait mis en place une organisation qui a servi de « paravent
entre les autorités allemandes et le monde agricole » et qui a permis d'« éviter
l'Ostland » (49).
Marcel
LEMAIRE a déclaré que l'action de BOUSQUET avait toujours été dirigée « en
faveur des paysans » (50).
Tous
étaient ou allaient être confirmés à la
tête des syndicats d'exploitants agricoles au lendemain
de la 2e guerre mondiale .
Dans les milieux du champagne, Robert
de VOGÜÉ, délégué
général du Comité interprofessionnel des vins
de Champagne, a confirmé à
son retour de déportation que grâce à BOUSQUET le stock de champagne avait été sauvegardé, que
ce dernier « désapprouvait
au fond totalement la politique suivie par le gouvernement de Vichy » ;
il l'aurait entendu dire que « Vichy
était le bocal de tous les vaincus des élections de
1936 » ; il a exprimé sa conviction que BOUSQUET était « au
moins dans ses sentiments d'accord avec la Résistance »,
et il a relaté les propos que lui auraient tenus les Allemands lors
de son interrogatoire par la Gestapo en
janvier 1944 :
« Nous
savons très bien que si la résistance est organisée
et développée de la sorte, c'est qu'elle a bénéficié
de l'appui plus ou moins déguisé de Bousquet ;
il nous a roulés ; maintenant qu'il est parti et que Darnand
le remplace, la gendarmerie travaillera avec nous au lieu de travailler
avec vous » (51).
[Robert-Jean de Vogüé est né le 3 août 1896 à Menetou-Salon (Cher). Notable reconnu, le comte Robert-Jean de Vogüé était l’archétype du vichysto-résistant dans la Marne. Négociant en vin de champagne, gérant de la maison Moët et Chandon d’Épernay depuis 1930, secrétaire de la Commission spéciale de la Champagne délimitée créée en 1935, Robert-Jean de Vogüé a été nommé par René Bousquet en 1940 membre de la Commission administrative provisoire, puis en 1941 du Conseil départemental, créés par le gouvernement de Vichy pour se substituer au Conseil général de la Marne dissous. En septembre 1940, il a fait partie du Bureau de contact composé de quelques représentants des négociants de champagne, qui a été institué pour entrer en rapport avec la puissance occupante. En novembre 1940, il a siégé au sein du Bureau national de répartition du vin de Champagne mis en place par le gouvernement de Vichy. En 1941, Robert-Jean de Vogüé a été nommé délégué général du Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), représentant du négoce, désigné par le secrétaire d’État, ministre de l’Agriculture. Président du Groupement interprofessionnel patronal d’Épernay (GIPER), Robert-Jean de Vogüé a participé dès l’automne 1940 à la création d’une Maison du travail destinée conformément à la politique corporative de Vichy à regrouper les organisations patronales et ouvrières. En 1942, il a été l’initiateur avec Fernand Muls, président de l’Union locale des syndicats ouvriers, du Centre interprofessionnel et social d’Épernay (CIS), un des premiers à voir le jour dans la France de Vichy pour promouvoir la Charte du travail promulguée en octobre 1941. En 1943, membre de Saule, sous-réseau d’Éleuthère dans la Marne, Robert-Jean de Vogüé a animé le le mouvement Ceux de la Libération (CDLL) à Épernay, aux côtés de son secrétaire Henri Fignerol, de Frère Birin et de Maurice Germain. Le 24 novembre 1943, il a été arrêté par la Gestapo dans le bureau d’Otto Klaebisch le « Weinführer du champagne » 3, boulevard Désaubeau à Reims. Le 29 novembre, Maurice Leflond, secrétaire du syndicat des cavistes a lancé un ordre de grève aux employés et ouvriers des sociétés vinicoles de Reims et d’Épernay pour protester contre cette arrestation. Incarcéré à la prison de Châlons-sur-Marne, Robert-Jean de Vogüé s'est confié à son voisin de cellule Robert Tritant, chef du mouvement Ceux de la Résistance (CDLR) à Châlons, sans se rendre compte que des micros étaient dissimulés dans sa cellule. Son procès, que les Allemands ont voulu public, a eu lieu en février-mars 1944 à Reims dans la salle des criées de la Chambre des notaires, cours Langlet et non pas à Châlons-sur-Marne où siégeait habituellement le tribunal militaire allemand. Condamné à mort, Robert-Jean de Vogüé a été gracié, bénéficiant de multiples interventions, dont celle de l'ambassadeur de Suède et celle du gouvernement de Vichy dont René Bousquet ne faisait alors plus partie. Ce dernier pouvait néanmoins encore plaider la cause du délégué du CIVC qu'il avait bien connu dans la Marne, auprès des autorités allemandes, auprès de Laval ou auprès de Pétain lui-même. Robert-Jean de Vogüé a été interné en France puis déporté comme résistant le 27 juin 1944 dans les prisons de Karlsruhe, de Rheinbach, de Ziegenhain, et de Rheinberg, où il a été libéré le 3 mai 1945. Deux résistants sparnaciens jugés et condamnés à mort en même temps que lui, René Herr et Léon Leroy, ont été fusillés, de même que Robert Tritant. Robert-Jean de Vogüé a été homologué FFC (Forces françaises combattantes) et il a reçu le titre est de Combattant volontaire de la Résistance (CVR), mention DIR (Déporté-interné-Résistant) ainsi que la Médaille de la Résistance. Après la guerre, lorsqu’à l’époque de la guerre froide la scission est intervenue au sein de l’association des anciens déportés, Robert de Vogüé a adhéré à la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP) aux côtés des anciens résistants d’obédience communiste. À Épernay, le nom de Robert-Jean de Vogüé, décédé le 17 octobre 1976, a été donné à une place de la ville où se dresse un buste honorant sa mémoire.]
Selon Bertrand
de MUN (52), ancien
député marnais de l'Alliance républicaine et
président de la Chambre de commerce de Reims, BOUSQUET « faisait
tout ce qu'il pouvait pour servir d'écran protecteur » entre les Marnais et les autorités allemandes.
Pierre
REGNAULT, directeur
du Champagne Salon à Mesnil-sur-Oger, a exalté la « conduite
magnifique » de BOUSQUET au retour de l'exode, n'hésitant pas à affirmer que « le
plus beau fleuron de la résistance de M. Bousquet à
nos ennemis, fut l'organisation de la viticulture champenoise » (53).
Plusieurs
ecclésiastiques onnt également été
mis à contribution.
L'archevêque
de Reims, monseigneur
MARMOTTIN, se souvenait avoir reçu BOUSQUET à deux ou trois reprises , et l'avoir entendu exprimer son « indignation » en évoquant la condamnation à mort et l'exécution
d'« un
communiste » par les Allemands (54).
[Louis-Augustin Marmottin est né le 11 mars 1875 à La Neuville-au-Pont (Marne). Ordonné prêtre du diocèse de Châlons-sur-Marne en 1898, il a été nommé évêque de Saint-Dié en 1930, une fonction qu’il a exercée jusqu’à sa nomination à la tête de l’archevêché de Reims en août 1940 en remplacement du cardinal Suhard nommé archevêque de Paris. Dès le début de l’occupation allemande, Monseigneur Marmottin a accepté la défaite comme une sanction voulue par Dieu, et a témoigné constamment un parfait loyalisme à l'égard du régime de Vichy ainsi qu'une véritable vénération à l'égard de Pétain, déclarant notamment le 28 décembre 1940 :« Serrons-nous autour de la personne vénérée du chef que la France s'est donnée. Quelle grande et belle figure que la sienne ! Elle s'impose par sa pureté sans tache, par sa noblesse sans défaillance à l'admiration de l'Univers. Et nul ne peut, mieux que le Maréchal Pétain avec plus de sagesse et plus d'autorité, gouverner notre pays, refaire ses idées et ses mœurs, et lui rendre son prestige auprès des autres peuples. Au surplus, il est également le Chef de l'État français, auquel nous devons le respect, loyale obéissance et entier dévouement ». Un peu plus tard, il a condamné comme « péché mortel » la désobéissance au gouvernement de Vichy, et a dénoncé les résistants comme des « rebelles » au service de l'étranger : « Les fidèles qui n'obéissent pas au gouvernement légal de Vichy commettent un péché mortel. De même, ceux qui se rangent du côté des rebelles ou suivent les directives d'une puissance étrangère qui par ses appels les invitent à désobéir au gouvernement, commettent une faute grave envers la France et envers Dieu ». En 1941, il a exposé les conditions du redressement de la France, affirmant que « la neutralité scolaire, en privant de Dieu les jeunes âmes, avait été la première cause de ses récents malheurs », rappelant « les vrais principes de l'Éducation qui ne peut être que chrétienne », fustigeant « le mépris des divines lois du Mariage » ainsi que « les ravages causés par le divorce, l'union libre, l'adultère, la stérilité volontaire, l'avortement », pleurant sur « la famille française jadis si féconde », dénonçant « la dépopulation causée par l'immoralité » qui, selon lui, avait compté pour beaucoup dans « la défaite de notre pauvre pays », et présentant les prêtres comme « les artisans nécessaires et les plus puissants du relèvement français ». Le préfet de Vichy René Bousquet a entretenu d'excellents rapports avec l’archevêque de Reims qui lui a été reconnaissant d'avoir loyalement appliqué dans la Marne les mesures en faveur de l'enseignement catholique, et cela malgré ses origines radicales, ses amitiés franc-maçonnes et ses convictions laïques. De son côté, le préfet de la Marne, dans son rapport de janvier 1942 aux autorités de Vichy, s’est attaché à montrer le parfait loyalisme de Monseigneur Marmottin envers le régime du maréchal Pétain, relevant qu’il « affirme le caractère impérieux de l'obéissance au chef de l'État le Maréchal Pétain et à ses représentants légaux, comme investis du pouvoir légitime reçu de Dieu ». En janvier 1942, Monseigneur Marmottin, pressenti par le délégué régional de la LVF pour présider le comité d’honneur rémois de cet instrument de la collaboration militaire avec l’Allemagne nazie, s'est récusé en raison du caractère de sa fonction, mais a promis son appui et son aide. Lors des obsèques des victimes des bombardements alliés de mai 1944, il a fustigé les « oiseaux meurtriers » qui jetaient la « terreur et désolation » sur la « ville sainte de la patrie française », et il a manifesté sa « réprobation devant les méthodes de guerre qui ne respectent ni rien, ni personne, qui se rient des lois divines et humaines, qui font servir la science et le progrès à une destruction de la civilisation ». Il a magnifié l'« immolation collective » des victimes rémoises et les a associées aux « milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de France, de tout âge, massacrés tous les jours sans ménagement, sans pitié ». Le 11 juillet 1944, il ne s’est pas opposé à ce qu’un service religieux honore dans la cathédrale de Reims la mémoire du milicien Philippe Henriot exécuté par la résistance, en présence des miliciens et des collaborationnistes marnais, mais il n’y a pas participé. Après la Libération, Monseigneur Marmottin s'est rallié de bon gré à la résistance, et a participé officiellement à la célébration de la victoire alliée de mai 1945. Le 9 mai 1945, il a présidé dans sa cathédrale un Te Deum solennel à l’issue du défilé de la Victoire. Le 13 mai 1945, il a célébré la fête de Jeanne d’Arc en déclarant : « Que pouvait Hitler contre nos saints de France, ligués là-haut pour la protection d’une patrie que sauva d’un péril mortel la pure jeune fille que nous célébrons aujourd’hui, notre prodigieuse Jeanne d’Arc ? Une vision s’impose à nous en ce moment, celle de Jeanne d’Arc à genoux dans ce sanctuaire, les drapeaux des nations victorieuses sont à l’honneur aujourd’hui. Chacun d’eux implore pour le pays qu’il représente la guérison de ses blessures, la concorde de ses fils, un glorieux avenir ». Après la guerre, bien que figurant sur la liste des prélats susceptibles d’être inquiétés, monseigneur Marmottin a été épargné par l’épuration épiscopale, mais n’a jamais reçu le chapeau de cardinal traditionnellement attaché au siège archiépiscopal de Reims.]
L'évêque
du diocèse de Châlons-sur-Marne, Monseigneur
TISSIER, l'avait toujours considéré comme « un
très bon Français » qui
avait « fait
preuve de dignité vis à vis des Allemands » et qui estimait que « son
attitude n'avait pas été celle d'un collaborateur » ( 55 ).
Monseigneur
PETIT, ancien
vicaire général à Châlons, devenu évêque
coadjuteur de Verdun, a déclaré que BOUSQUET lorsqu'il avait quitté le département avait « emporté
la reconnaissance générale des Châlonnais et des
Marnais », qu'il avait « fait
figure d'un chef à l'âme française et nullement
un plat serviteur des autorités occupantes »,
et que d'« aucuns
estimaient qu'il travaillait simultanément pour le Gouvernement
à venir autant que pour celui de l'heure qui passait » (56).
L'abbé
Pierre GILLET, directeur
de la Maison des Oeuvres, membre du mouvement de résistance Ceux de la Libération (CDLL), vice-président de
l'Amicale des déportés et internés de l'arrondissement
de Châlons-sur-Marne, a attesté que « jamais
il n'avait eu connaissance que Bousquet ait fait à Châlons-sur-Marne
quoique ce soit contre la France », et qu'« au contraire il y avait effectué plusieurs interventions
efficaces ». Lorsque BOUSQUET,
nommé au secrétariat général à
la Police, avait fait ses adieux à la ville de Châlons,
il lui a fait part de son étonnement qu'il ait pu accepter
un tel poste et BOUSQUET lui a répondu : « Je
sais bien que cela nuira à ma carrière, mais je ne vois
qu'une chose, le bien de mon pays » (57).
[Pierre Gillet est né le 10 mai 1904 à Somme-Yèvre. Ecclésiastique, prisonnier de guerre évadé, l’abbé Gillet est rentré à Châlons-sur-Marne et a siégé dans la commission municipale mise en place au retour de l’exode. En 1942, il a été nommé directeur de la Maison des œuvres catholiques du diocèse de Châlons-sur-Marne et a rejoint le mouvement Ceux de la Libération (CDLL) à la demande de Lucien Paul, responsable de la branche civile de cette organisation. Il a organisé la fabrication de faux papiers pour les prisonniers de guerre évadés, puis pour les réfractaires du STO et les résistants. Il a aidé un aviateur canadien tombé à Marson à passer en Espagne. Arrêté le 17 mai 1944, il a été interné à la prison de Châlons-sur-Marne jusqu’au 23 août 1944. Pierre Gillet a reçu le titre de Combattant volontaire de la Résistance, mention DIR (Déporté-interné-résistant) et la Médaille de la Résistance. En 1945, il a été élu conseiller municipal de Châlons-sur-Marne. En 1983, il a publié une histoire de la Résistance dans l’arrondissement de Châlons-sur-Marne dans le numéro 3 des Cahiers Châlonnais sous le titre Châlons sous la Botte, ouvrage qui a été réédité en 1998 et qui se montre bienveillant à l'égard du parcours du préfet Bousquet dans la Marne. Une rue de Châlons-en-Champagne porte son nom et une plaque rappelle sa mémoire dans la cour de l’évêché].
Andrée
GASNIER (58),
en religion soeur
MARIE, supérieure
de la maison de Charité et assistante départementale
de la Croix-Rouge, qui avait organisé avec Madame
BOUSQUET, grâce à l'aide de son mari, un
centre d'accueil pour les prisonniers rapatriés,
a relaté comment BOUSQUET avait
obtenu la grâce de Pierre
DUFRÊNE, industriel condamné par
le tribunal militaire allemand de Châlons-sur-Marne (59). Arrêté sur dénonciation le 31 octobre 1941 à son domicile de Reims où des armes avaient été découvertes, Pierre DUFRÊNE avait été condamné à mort pour détention d’armes, peine effectivement commuée en 12 ans de travaux forcés sur intervention de BOUSQUET. Il a été déporté le 4 mai 1942 dans la prison de Karlsruhe et transféré dans les prisons de Rheinbach, puis de Siegburg où il est décédé le 14 février 1945.
Enfin,
l'abbé
GILLET et soeur
MARIE ont justifié l'attitude de BOUSQUET dans ce qu'on a appelé à Châlons l'« affaire
du Casino », par le fait qu'il
avait dû flatter publiquement un officier allemand parce qu'il
venait d'obtenir de lui la grâce d'un condamné à
mort. Maurice
JONQUET, notaire
à Châlons, a relaté cette affaire qui a fait
scandale et qui a constitué la
seule réserve émise par les Châlonnais au sujet de l'attitude de BOUSQUET. En
1941, au cours d'une soirée de bienfaisance au Casino
de Châlons en faveur des prisonniers, devant une assistance
de plus de mille personnes, BOUSQUET était monté sur la scène à l'entracte pour
vanter les avantages d'une entente avec les Allemands et s'était adressé au docteur
HAECKEL, représentant du Feldkommandant assis
dans la loge d'honneur en lui disant : « Quoiqu'il
arrive, nos relations d'amitié se maintiendront et je compte
après la guerre aller chez vous comme vous viendrez chez moi » (60)
BOUSQUET avait aussi sollicité le témoignage du président de l'association cultuelle israélite de Châlons,
délégué du Consistoire central des israélites
de France, avec lequel il avait été en relation en
mai 1940. Léon
ULMANN, qui avait passé la guerre à Annecy
puis en Suisse,a fait la déclaration suivante :
« Il
m'est impossible de dire quelle a été l'activité
et l'attitude de M. Bousquet à Châlons-sur-Marne pendant
la durée de l'occupation allemande.
Depuis mon retour, je n'ai rien entendu dire de particulier
sur son compte dans les milieux israélites de Châlons-sur-Marne.
D'ailleurs, presque tous ceux qui sont restés
sur place ont été déportés en Allemagne
d'où un seul est revenu à la date d'aujourd'hui.
Châlons-sur-Marne
le 3 août 1945 » (61).
Mais ce qui a sans doute impressionné le plus le président
NOGUÈRES, le Procureur et les jurés de la Haute
Cour, a été la très longue déposition de Richard
POUZET, entendu à la demande de BOUSQUET à Rochefort-sur-Mer où il reprenait des forces à
son retour de déportation. Secrétaire
général de la préfecture, il
avait été un de ses plus proches collaborateurs dans la
Marne, et son témoignage a donné beaucoup
de crédit au système de défense élaboré
par BOUSQUET consistant à mettre
en valeur son action dans ce département. En ce qui concerne le
rôle joué ultérieurement par l'ancien préfet
de la Marne au secrétariat général à la
Police, Richard
POUZET a déclaré :
« Il
ne m'appartient pas de juger de son attitude [...] Je n'ai pas pu l'observer d'assez près, mais
je ne veux pas douter qu'elle ait été dictée
par sa constante préoccupation de freiner au maximum l'emprise
allemande et de sauvegarder de son mieux les intérêts
français, sans cesse plus menacés par l'activité
haineuse de l'occupant. C'est d'ailleurs ce qui entraîna, à
mon avis, sa disgrâce, son renvoi et son remplacement par un
individu tout acquis aux Allemands. Alors qu'il avait quitté la vie publique
et que j'étais redevenu moi-même un simple particulier,
traqué certes, mais pouvant enfin me livrer sans contrainte
à l'action résistante, j'eus l'occasion de revoir Bousquet
à plusieurs reprises, en particulier au lendemain de la publication
dans Je suis partout d'un article infect de Marques-Rivière
intitulé je crois " Bousquet le maquisard " (62). Je lui témoignai à cette occasion
ma sympathie ; il ne me cacha pas qu'il considérait cet
article inspiré par la milice, comme un véritable appel
au meurtre. À partir de cet instant son arrestation par
les Allemands ne faisait plus de doute ; elle devait intervenir
quelques jours après le débarquement, le 9 juin si j'ai
bonne mémoire.
Je ne l'ai plus revu depuis, mais j'en ai entendu
parler par les Allemands eux-mêmes, qui, lors de mes interrogatoires
auxquels ils me soumirent dans leur chambre de tortures de la rue
des Saussaies, me firent, parmi tant d'autres griefs mineurs, articulés
par eux contre moi, celui d'avoir connu Bousquet et d'avoir continué
dans la Marne son action jugée peu conforme à l'esprit
de collaboration. Il est vrai que ce fut là l'un de mes moindres
péchés, mais cette simple indication pouvant cependant
éclairer la justice française, je n'hésite pas
à la lui livrer.
Lecture
faite persiste et signe.
Richard Pouzet » (63)
[Secrétaire général de la Marne, Richard Pouzet était en contact avec la résistance marnaise, et couvrait la fabrication à la préfecture de faux papiers d'identité destinés aux prisonniers évadés et aux réfractaires du STO, qu'il aidait à échapper aux réquisitions de main d'œuvre. Il a encouragé le préfet Bousquet, dont il était un des principaux collaborateurs à la préfecture, à protéger les élus républicains, les francs-maçons et les juifs. Mis en disponibilité par le gouvernement de Vichy en février 1944, il a été pressenti pour exercer les fonctions de préfet de la Libération dans la Marne. Arrêté le 4 août 1944 par la Gestapo pour son activité de résistant, il a fait partie d’un transport qui est parti de Pantin le 15 août 1944 et qui est resté bloqué dans un tunnel bombardé par l’aviation alliée. Les déportés ont été transférés dans un autre train que la résistance a essayé en vain de stopper le 17 août 1944 près de Dormans. Richard Pouzet a décrit dans le détail et avec émotion la traversée du département de la Marne. Arrivé le 20 août à Buchenwald, où il a reçut le matricule 77 061, il a ensuite été transféré à Dora, et a été affecté à des travaux de terrassement au kommando d’Ellrich. Au début d'avril 1945, il est évacué lors d'une marche de la mort à Ravensbrück, puis le 28 avril dans une baraque de l'usine d’explosifs chimiques de Malchow, où il a été libéré le 2 mai 1945. Rapatrié en France dans un état d'extrême faiblesse, il a été soumis à une longue convalescence avant de poursuivre sa carrière dans la préfectorale. En août 1945, alors qu'il se reposait chez lui à Rochefort-sur-Mer, il a été entendu comme témoin à la demande de René Bousquet inculpé devant la Haute Cour de Justice. Sa déposition, très favorable à l'ancien préfet de la Marne, dressait un tableau élogieux de l'action de Bousquet dans la Marne de 1940 à 1942. Après la guerre, il a repris du service, comme préfet de la Mayenne, préfet de la Sarthe, puis comme secrétaire général de la Seine, et il est devenu vice-président de l'assemblée du Corps préfectoral. Son témoignage, publié dès 1946 sous le titre Dora-Propos d'un bagnard à ses enfants, a reçu le prix Louis Paul Miller de l’Académie française en 1950.]

La Marne
au procès Bousquet
La Haute
Cour de Justice est bel et bien entrée
dans le jeu de l'ancien secrétaire général à
la Police de Vichy, qui entendait exploiter au maximum l'atout précieux
que pouvait représenter l'évocation de son action dans la Marne. Cela a été confirmé par la façon dont
s'est déroulé le procès de René
BOUSQUET. En effet, dès l'ouverture du procès le
21 juin 1949, aussitôt après avoir
donné lecture d'un curriculum vitae de l'accusé tout
à fait à son avantage, le président
NOGUÈRES a ouvert le chapitre relatif à la
Marne en ces termes :
« Bousquet
ne répond pas devant vous des actes qu'il aurait pu commettre
comme Préfet, car, à ce titre, il aurait échappé
à votre compétence. Mais il est d'autant plus nécessaire que
son attitude comme Préfet vous soit connue, que s'il a commis
en cette qualité des actes tombant sous le coup de la loi,
il en répondrait en vertu de la connexité prévue
par l'Ordonnance constitutive de la Haute Cour de Justice » (64).
Il a lu un court résumé de ce qu'on
trouvait dans le dossier sur le comportement de BOUSQUET dans ce département, en relevant que les renseignements reçus,
concernant son rôle administratif en tant que préfet,
étaient « unanimement
favorables à l'accusé ». Curieusement, dans ce résumé très
bref, il a privilégié avec insistance les
témoignages très favorables de Marguerite
BELLO, la secrétaire de BOUSQUET à Châlons-sur-Marne, que ce dernier avait installée
à la délégation parisienne de son cabinet en
1942 (65),
et ceux de Jean
LEGUAY qui, après avoir succédé à BOUSQUET à la sous-préfecture de Vitry-le-François, puis
comme secrétaire général de la préfecture
de la Marne, était devenu son délégué
auprès des autorités allemandes dans les territoires
occupés, poste qu'il occupait au moment de la Rafle du Vél d'Hiv les 16 et 17 juillet 1942. (66).
Le président NOGUÈRES a donné ensuite la parole à l'accusé. Selon Jean
PIVERD qui a suivi le procès pour L'Union de Reims, BOUSQUET a fait preuve pendant deux heures d'« une
indiscutable éloquence » et a retracé, « non
sans une émotion que l'on sentait sincère »,
ce qu' a été de
1939 à 1942 son
action dans la Marne, dans un long et vibrant exposé
qui s'est achevé par ces mots : « En
tout cas, je voudrais simplement que la Haute Cour retienne que, jusqu'au
18 avril 1942, mon attitude devant l'occupant fut une attitude de
dignité. Nous verrons tout à l'heure si cette attitude
a changé à partir du 18 avril 1942 » (67).
Quant
au procureur général, après avoir écouté BOUSQUET,
il a déclaré qu'il n'avait pas de question à poser et
il a ajouté :« Le
Ministère Public, en ce qui concerne le passage de BOUSQUET
à la Préfecture de la Marne, n'a rien à lui reprocher. J'ai entendu avec plaisir ses explications, et elles
n'ont fait que me confirmer dans mon opinion première » (68).
L'action
de BOUSQUET comme
préfet de la Marne qui, par la volonté de
l'intéressé et avec l'accord complaisant du président
ainsi que du procureur général, ne devait être
que rapidement évoquée, a été
mise à l'honneur. Elle occupe une cinquantaine de pages dans la transcription du procès, alors que la partie consacrée
à ce que fut l'attitude de BOUSQUET à l'égard des Juifs, ne représente
qu'une vingtaine de pages.
Après le chapitre marnais, « le
procès singulier de René Bousquet » (69) a suivi
son cours, en
faisant l'impasse sur la politique de répression et de persécution
raciale dont BOUSQUET avait été cependant le principal responsable avec
LAVAL.
Dans
la Marne dont il avait été préfet,
et malgré les interventions qu'il avait accepté ponctuellement
d'entreprendre en faveur de Juifs marnais qui avaient sollicité
sa protection lorsqu'il était devenu secrétaire général
à la Police, plus
de trois cents juifs ont été finalement déportés
et une dizaine seulement sont rentrés (70).
Au terme d'un procès qui ne dura que trois
jours au cours desquels BOUSQUET a poursuivi « sans
presque désemparer, son long monologue tendant avec succès
à se disculper » (71), il a été
acquitté « du
chef d'atteinte aux intérêts de la défense nationale »,
déclaré « convaincu
du crime d'indignité nationale » frappant
automatiquement tous ceux qui avaient accepté de participer
aux gouvernements de l'époque vichyste, et condamné
à la peine minimale de « cinq
ans de dégradation nationale » ; mais
il en a été « immédiatement
relevé » selon
la formule consacrée qui permettait de blanchir les collaborateurs, « pour
avoir participé de façon active et soutenue à
la résistance contre l'occupant ».
ARRÊT
Vu l'arrêt rendu le TREIZE JANVIER
mil neuf cent quarante neuf par la Chambre d'accusation de
la Haute Cour de Justice lequel ordonne la mise en accusation
et le renvoi devant la Haute Cour de Justice de : BOUSQUET
René, né le 11 mai 1909 à MONTAUBAN (
Tarn-et-Garonne ) de Georges Adrien Emile et de LORTAL Adrienne
Marie Laure, Préfet, Ancien secrétaire Général
à la Police au Ministère de l'Intérieur,
domicilié à Paris ( 16° ) 12 avenue Camoëns.
Vu l'acte d'accusation dressé par
Monsieur le Procureur de la République contre le sus
nommé.
Vu l'exploit en date du 16 février
1949 portant signification de l'acte d'accusation.
Vu l'original d'assignation en date du 14
juin 1949 portant citation à l'accusé Bousquet
René à comparaître devant la Haute Cour
de Justice le VINGT ET UN JUIN mil neuf cent quarante neuf.
LA HAUTE COUR DE JUSTICE constituée
conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre
1944, modifiée par les lois du 15 septembre 1947 et
19 avril 1948.
Après avoir entendu Monsieur le Procureur
Général en ses réquisitions, l'accusé
BOUSQUET René, Monsieur le Bâtonnier RIBET son
conseil en ses observations, l'accusé ayant eu la parole
le dernier et après en avoir délibéré
conformément à la loi et en Chambre du Conseil.
LA
HAUTE COUR DE JUSTICE,
Considérant
que pour si regrettable que soit le comportement de BOUSQUET
en divers moments de son activité comme Secrétaire
Général à la Police et notamment lorsqu'il
a accepté d'aider à l'action de la mission DESLOGES,
il n'apparaît qu'il ait sciemment accompli des actes
de nature à nuire à la défense nationale
dans le sens de l'article 83 du Code Pénal et qu'il
échet en conséquence de prononcer son acquittement,
Considérant d'autre part qu'en acceptant
de remplir dans le Ministère constitué par LAVAL
au mois d'avril 1942 le poste de Secrétaire Général
à la Police qui est un de ceux qui le rende justiciable
de la Haute Cour, il s'est rendu coupable du crime d'indignité
nationale,
Mais considérant qu'il résulte de l'information
et des débats la preuve qu'en de nombreuses circonstances
BOUSQUET a, par ses actes, participé de façon
active et soutenue à la résistance contre l'occupant,
PAR
CES MOTIFS,
Acquitte
BOUSQUET René du chef d'atteinte aux intérêts
de la défense nationale,
le déclare convaincu de crime d'indignité
nationale, le condamne à la peine de CINQ ANS de DEGRADATION
NATIONALE de ce chef, le relève de la dite peine en
application de l'article 3 par. 4 de l'ordonnance du 26 décembre
1944.
Fait et prononcé au Palais de Justice,
à Paris, le Jeudi vingt trois juin mil neuf cent quarante
neuf, à 20 heures, en audience publique de la Haute
Cour de Justice, où siégeaient : Monsieur Louis
NOGUERES Président de la Haute Cour de Justice, Messieurs
MONTILLOT et KUEHN Vice-Présidents, membres de la Haute
Cour de Justice; Madame Renée PREVERT, Messieurs BESSAC,
GUILBERT, HULIN, DEPREUX, MAZIER, HUGUES, GERVOLINO, BARBIER,
DAMAS, TOUBLANC et BAYLET Jurés de jugement, également
membres de la Haute Cour de Justice.
Et ont signé le présent arrêt,
Monsieur Noguères Président de la Haute Cour
de Justice et Me Fanchon greffier d'audience (72).
|
La nouvelle a fait l'objet d'un maigre entrefilet
dans Le
Monde du 25
juin 1949. Le procès de BOUSQUET devant la Haute Cour de Justice n'a suscité aucune réaction dans la Marne, et le verdict de
clémence dont il a bénéficié n'y a entraîné aucune
protestation de la part des mouvements de résistance qui
contrôlaient L'Union,
dont le chroniqueur judiciaire avait pourtant fait honnêtement
son travail de journaliste tout au long des trois jours qu'a duré
le procès. Il est vrai que le directeur-gérant, Pierre
BOUCHEZ, avait témoigné en faveur de BOUSQUET en 1945,
que le député socialiste de la Marne, Lucien
DRAVENY (73),
était un ami personnel de BOUSQUET, et que le Mouvement républicain populaire (MRP), parti démocrate chrétien issu de la Résistance, qui disposait de deux députés dans la
Marne, dont l'ancien sous-préfet de Reims à la Libération, Pierre
SCHNEITER, devenu ministre de la Santé publique,
réclamait déjà depuis quelque temps une
amnistie.
Dans L'Aube des 5
et 7 mars 1949, l'éditorialiste du journal Georges
BIDAULT – professeur agrégé d'histoire qui avait enseigné en poste au lycée de garçons de Reims de 1926 à 1931 – Compagnon de la Libération, fondateur du MRP, chef du gouvernement provisoire de juin à décembre 1946, et qui devient en octobre 1949, président du Conseil à la tête d'un gouvernement de « Troisième Force » sans les gaullistes ni les communistes, tout en soulignant que l'épuration avait
été nécessaire, considérait qu'il y avait
eu sans doute des disparités, et que l'heure
était maintenant venue pour les résistants de se montrer
cléments, d'oublier et de dire ce qui pouvait être oublié (74).
Au moment même où se déroulait
le procès BOUSQUET, François
MITTERRAND, secrétaire d'État à
la présidence du Conseil et porte-parole du gouvernement QUEUILLE,
a présenté au Parlement un projet
d'amnistie très discuté, qui a été finalement
adopté en
décembre 1950 et promulgué en
janvier 1951.
Écarté de la haute fonction publique, René
BOUSQUET a poursuivi une brillante carrière
à la Banque d'Indochine et dans la presse. Le Conseil d'État, après avoir refusé
de le rétablir dans ses droits de préfet, a consenti en 1957 à
lui rendre sa Légion d'honneur, et l'ancien secrétaire
général à la Police de Vichy a même été amnistié le 17
janvier 1958 (75). Il a pu se lancer dans la politique à l'occasion
des élections
législatives de 1958, et a été candidat
dans la troisième circonscription de la Marne, c'est
à dire dans les arrondissements de Châlons-sur-Marne
et de Vitry-le-François où il a tenté de reconstituer
un réseau d'influence avec l'aide de ses fidèles amis marnais. Dans sa profession de foi, il expliquait qu'il revenait
dans la Marne, « attiré
par des sentiments d'amitié et de fidélité »,
et « parce
que des amis de diverses obédiences politiques » lui avaient demandé à nouveau de mettre son nom et ses
efforts à la disposition des Marnais « pour
tenter de réaliser une action de conciliation républicaine » (76). Son suppléant était Hector
BOUILLY, conseiller général radical-socialiste
de Saint-Remy-en-Bouzemont. Mais l'époque des notables radicaux-socialistes
était révolue, et ce fut un échec. René
BOUSQUET, avec seulement 4 461 voix, a rassemblé moins de 10
% des suffrages, tandis que la
Marne élisait deux députés gaullistes, un divers droite et un MRP.
Après la mort de son ami Jean
BAYLET, survenue en
1959, BOUSQUET a siégé au conseil d'aministration de La
Dépêche du Midi, dont il a animé un temps
la direction aux côtés de sa veuve Évelyne,
et qui a fait campagne en faveur de François
MITTERRAND, candidat à la présidence de la
République opposé au général de
GAULE en 1965 (77).
En
septembre 1989, l'association Les
Fils et Filles des déportés juifs de France (FDJF), présidée par Serge KLARSFELD, la Fédération
nationale des déportés et internés, résistants
et patriotes (FNDIRP) et la Ligue
des droits de l'homme, ont déposé une plainte pour
crime contre l'humanité contre René BOUSQUET, qui a été finalement inculpé en mars
1991, au terme d'une longue procédure judiciaire. Cette procédure a été rendue possible grâce l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité votée en 1964 par le Parlement.
Elle s'appuyait sur trois télégrammes secrets datés d'août 1942, dont la Haute Cour de Justice n'avait pas eu connaissance. Dans ces télégrammes, René BOUSQUET donnait de nouvelles instructions concernant la déportation des enfants juifs, qui abaissaient de 18 ans à 5 et jusqu'à 2 ans l'âge au-dessous duquel les enfants juifs ne pouvaient pas être arrêtés par la Police française, ni dépoortés.
Elle revenait aussi sur les rapports noués par René BOUSQUET avec les chefs du Sipo-SD en France occupée dans le cadre de ce qu'on a appelé les « accords Bousquet-Oberg » (78), rapports de complicité qui scellaient l'implication du gouvernement de Vichy et de la Police française dans les arrestations de Juifs et la mise en œuvre de la Shoah en France, et qui avaient été complaisamment mis sous le boisseau lors de son procès devant la Haute Cour de Justice. Dans un compte-rendu de la rencontre le 2 juillet 1942 à Paris de René BOUSQUET avec Karl OBERG et son adjoint Herbert HAGEN, ce dernier relevait : « On s'est arrêté à l'arrangement suivant, puisqu'à la suite de l'intervention du Maréchal, il n'est pour l'instant pas question d'arrêter les juifs de nationalité française, Bousquet se déclare prêt à faire arrêter sur l'ensemble du territoire français, et au cours d'une action unifiée, le nombre de juifs ressortissants étrangers que nous voudrons. »
Mais ce que certains appelaient déjà
le « second
procès Bousquet », auquel l'ancien préfet
de la Marne se préparait (79) tout en le
considérant comme très improbable (80),
et qui risquait de se transformer en « procès
du procès de 1949 », n'a pas eu lieu
puisque René
BOUSQUET a été assassiné à
son domicile parisien, le
8 juin 1993.

Débats et polémiques d'aujourd'hui
Plus de soixante-dix ans après le procès Bousquet, la responsabilité du gouvernement de Vichy dans la mise en œuvre de la Shoah en France et le rôle joué par Bousquet à la tête du Secrétariat général à Police continuent de faire débat.
En 2022, Laurent JOLY dans La Rafle du Vel d’Hiv Paris, juillet 1942, ouvrage publié chez Grasset qui s’appuie sur de nouvelles sources, a bien mis en évidence l’implication personnelle et directe du secrétaire général à la Police René BOUSQUET dans l’organisation et la mise œuvre de la rafle du Vel d'Hiv, implication que BOUSQUET s’est efforcé de gommer en en renvoyant la responsabilité sur DARQUIER DE PELLEPOIX et le Commissariat aux Affaires juives.
C’est bien BOUSQUET qui a négocié les 3 et 4 juillet 1942 avec Karl OBERG, chef des SS et de la Police allemande en France, un accord visant à « arrêter le nombre de juifs exigé par l’occupant, c’est-à-dire 40 000 juifs et juives, 30 000 en zone occupée et 10 000 en zone sud non occupée, à condition qu’ils soient étrangers (ou d’origine étrangère) et que les forces de l’ordre de Vichy agissent en totale autonomie ».
C’est bien BOUSQUET en « donneur d’ordre » qui a fait exécuter la rafle du Vel d’Hiv, par la Police française, les gardiens de la Paix de la région parisienne, ce dont le maréchal PÉTAIN avait approuvé le principe. Au cours de la seule journée du 16 juillet 1942, « plus de 8 000 hommes et femmes, juifs polonais pour la plupart, et près de 4 000 enfants, le plus souvent français » ont été arrêtés, et les enfants séparés de leurs parents.
C’est bien BOUSQUET qui, avisé que le cardinal SUHARD, archevêque de Paris et fervent soutien du régime de Vichy, avait fait part de son intention de manifester auprès des autorités d’occupation « son émotion douloureuse et son inquiétude » au sujet des enfants séparés de leurs parents, s’est empressé d’aller neutraliser le cardinal. Ce dernier a déclaré peu de temps après la rafle du Vel d’Hiv : « Le secrétaire d’État m’a expliqué que nous n’avions pas à nous émouvoir de ces arrestations, car 90% des personnes arrêtées sont des indésirables ».
C’est bien BOUSQUET qui a déclaré en août 1942 au général GOUDOUNEIX, président de la Fédération des amicales des engagés volontaires étrangers, qui prenait la défense des Juifs ayant combattu pour la France au cours de la 1ère guerre mondiale et de la campagne de France de mai-juin 1940 : « La France ne s’en portera pas plus mal […] nous nous rendons parfaitement compte de ce que nous faisons. L’avenir démontrera que nous avions raison ».
C’est bien BOUSQUET qui a décidé, après la rafle du Vel d’Hiv, dont les résultats avaient été jugés très médiocres par les Allemands, de mettre en place en novembre 1942 au sein de la Police judiciaire à la Préfecture de police, un service spécial des Affaires juives (SSAJ), dont la mission était « de traquer les juifs pour le compte de la Gestapo ». ».
C'est aussi en 2022 que Robert BADINTER a établi et annoté avec Bernard LE DREZEN, une édition chez Fayard des minutes du procès Bousquet publiée sous le titre Le Procès Bousquet-Haute Cour de justice 21-23 juin 1949 (81), L'ouvrage reprend la sténographie du procès effectuée par René BLUET, qui est conservée aux Archives nationales.
J'avais pu moi-même consulter ces minutes aux Archives nationales dans les années 1980, et photocopier les pages concernant le passage de BOUSQUET dans la Marne au domicile de Maître NOGUÈRES. Son père, Louis NOGUÈRES, qui avait présidé la Haute Cour de Justice de 1949, en avait conservé une copie.
Dans sa préface, Robert BADINTER s'interroge sur ce qu'il considère comme un « déni de justice » et « une défaite de la justice » :
« Il advient que la justice transforme un innocent en coupable. Mais il est plus rare que l'institution judiciaire transforme un coupable en innocent. Ce fut pourtant le cas de René Bousquet [...]
Au-delà de l'intérêt historique de ce déni de justice que fut son procès, demeure une question essentielle : comment la Haute Cour de justice a-t-elle pu acquitter René Bousquet et lui délivrer un véritable brevet de Résistance ? C'est l'énigme que cet ouvrage présente [...]
Malgré la disparition des pièces du dossier adminitratif, un jour peut-être, la vérité sera établie sur les secrets de cette défaite de la justice. Peut-être des chercheurs retrouveront la clef disparue de l'affaire Bouquet. Je le souhaite. Mais je n'y crois guère.
»
Cette édition utile et bienvenue permet de découvrir le poids de la Marne et des Marnais dans le déroulement et l'issue du procès Bousquet, poids qui a longtemps été sous-évalué. Correspondant dans la Marne du Comité d'histoire de la 2e guerre mondiale, puis de l'Institut du temps présent (IHTP), j'ai pu consulter dès les années 1970 les archives du cabinet du préfet de la Marne, les archives policières et judiciaires conservées aux Archives départementales de la Marne. Aux archives nationales, j'ai eu accès aux minutes du procès Bousquet enfin publiées en 2022, mais aussi à son dossier individuel, aux rapports qu'il a adressés au ministère de l'Intérieur à Vichy de 1940 à 1942, aux archives du procès, aux auditions de témoins marnais entendus sur commission rogatoire, ou cités par l'inculpé, ainsi qu'aux attestations adressées par des Marnais au juge d'instruction.
La confrontation de toutes ces sources croisées m'a permis de retracer, d'analyser et de contextualiser le parcours de René BOUSQUET dans la Marne et en Champagne et de montrer comment ce parcours a été longuement exposé avec bienveillance et complaisance au cours de son procès en 1949, comment les jurés de la Haute Cour de Justice se sont laissés
convaincre par BOUSQUET qu'il avait été un
grand préfet de la Marne et que sa conduite dans
ce département avait été irréprochable, comment l'exaltation du parcours marnais de BOUSQUET a permis d'escamoter son implication directe et personnelle dans la rafle du Vél d'Hiv et la mise en œuvre de la Shoah en France.
J'ai eu l'occasion d'exprimer dans plusieurs colloques et dans ma thèse de doctorat soutenue en 1993 (82), ma conviction que la Marne et les Marnais constituent sans doute une des clefs de compréhension et d'explication de « l'énigme du procès Bousquet ».
En janvier 2023, a été publié aux Éditions L'Artilleur l'ouvrage Histoire d'une falsification. Vichy et la Shoah dans l'Histoire officielle et le discours commémoratif. Dans cet ouvrage, Jean-Marc BERLIÈRE, Emmanuel de CHAMBOST et René FIÉVET, réagissant au discours du président de la République Emmanuel MACRON à Pithiviers le 17 juillet 2022, dénoncent ce qu'ils considèrent comme « une surenchère mémorielle qui se traduit par un récit faux historiquement ». Ils entendent « remettre au premier rang l'écrasante responsabilité des nazis (Allemands et Autrichiens) dans le drame de la déportationdes juifs de France ».
Tout en affirmant qu'« 'il n'est pas question de défendre Vichy ou Laval, Bousquet, Pétain », Jean-Marc BERLIÈRE s'écarte de ce qu'il appelle « la version développée par Serge Klarsfeld axée sur le rôle exclusif de René BOUSQUET dans les négociations avec les Allemands ». Il considère que « Bousquet n'a fait qu'obéir aux instructions de Laval » et que « le marchandage juifs français contre juifs étrangers fut bien au cœur de la négociation entre Vichy et les Allemands fin juin, début juillet 1942 ».